Tag: no-auto-post

L’hôtel Mezzara deviendra le musée Guimard !
Après plus de vingt ans d’engagement, Le Cercle Guimard voit son projet devenir réalité : l’hôtel Mezzara accueillera bientôt le musée Guimard, dédié à l’un des maîtres de l’Art nouveau. Vingt-deux ans après la création du Cercle Guimard, et dix-neuf ans après notre première exposition à l’hôtel Mezzara (Guimard, album d’un collectionneur), notre association franchit aujourd’hui une étape déterminante vers la création du musée Guimard. Nous sommes fiers de vous annoncer que notre équipe — Le Cercle Guimard, Hector Guimard Diffusion, avec les co-financeurs FABELSI et la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) — a remporté l’appel à candidatures pour un bail emphytéotique de cinquante ans de l’hôtel Mezzara, chef-d’œuvre d’Hector Guimard classé monument historique. Le courrier officiel nous a été adressé le 23 juin 2025.

Hall de l’hôtel Mezzara, état actuel. Photo F. D.
Depuis que cette propriété de l’État a été déclarée « d’inutilité au service public », il y a dix ans, notre association a déployé toute son énergie et mobilisé toutes ses ressources pour faire de l’hôtel Mezzara le futur musée Guimard. Le tournant stratégique de notre action a eu lieu en 2017 avec l’organisation de l’exposition Hector Guimard, précurseur du design, conçue pour démontrer le potentiel de l’hôtel Mezzara en tant qu’écrin muséal. Son retentissement médiatique a permis de faire connaître notre projet au public.
Grâce à l’architecte et historien belge Maurice Culot, nous avons rencontré en 2018 l’entrepreneur passionné de patrimoine Fabien Choné, qui a offert un nouveau souffle à notre démarche. Avec sa structure Hector Guimard Diffusion, nous sommes devenus co-porteurs du projet muséal privé, que nous avons depuis structuré et développé ensemble. Deux appels d’offres lancés par l’État ont été déclarés infructueux, avant que notre candidature ne soit enfin retenue lors du troisième.
Toutes ces années ont permis de professionnaliser Le Cercle Guimard, de constituer une collection, de créer un centre d’archives et une maison d’édition — Les Éditions du Cercle Guimard, dont le premier ouvrage a été consacré à l’hôtel Mezzara — de poursuivre les projets de rééditions et de numérisation, de développer la recherche sur Hector Guimard et ses créations, et d’installer le siège de l’association dans l’ancienne agence de l’architecte, au Castel Béranger.
Une période exaltante s’ouvre désormais : aux côtés de spécialistes de l’Art nouveau, d’artisans d’art, de restaurateurs, d’architectes et de partenaires culturels et institutionnels, nous allons concevoir un musée à la hauteur de l’un des plus grands architectes du tournant du XXe siècle.

Loggia de l’hôtel Mezzara, au second étage de la façade sur rue, vue extérieure. Photo F. D.
Nous remercions chaleureusement, en tout premier lieu, nos adhérents et les membres du conseil d’administration pour leur fidélité, leur engagement et leur patience tout au long de ces années de mobilisation.
Nous pensons avec reconnaissance à Jean-Pierre Lyonnet, premier président du Cercle Guimard, qui nous a quittés il y a plusieurs années, ainsi qu’à tous les anciens membres du bureau qui ont contribué activement au développement de l’association. Merci Arnaud, merci Bruno.
Nous avons également une pensée émue pour les premiers “hectorologues”, dont certains sont encore membres du Cercle : Henri Poupée, Roger-Henri Guerrand, Alain Blondel, Michèle Blondel, Yves Plantin, Laurent Sully Jaulmes et Ralph Culpepper.
Nous sommes bien sûr aussi très reconnaissants envers Philippe Thiébaut, conservateur général honoraire du patrimoine et Georges Vigne, conservateur du patrimoine, qui ont fait très notablement progresser les connaissances sur Hector Guimard par leurs recherches, leurs expositions et leurs publications.
Mais nous remercions aussi :
La DRFIP, la Direction de l’immobilier de l’État, le service local du Domaine de Paris, le ministère de la Culture, la DRAC Île-de-France, ainsi que les membres de la commission d’analyse des candidatures, pour la confiance qu’ils nous ont accordée.
La RATP pour son soutien actif à la valorisation de l’héritage de Guimard.
Les musées et institutions qui nous soutiennent et annoncent de belles collaborations :
Le musée d’Orsay
Le Musée des Arts décoratifs (MAD Paris)
La Cité de l’architecture et du patrimoine
La fondation Le Corbusier
Les Archives de Paris
Le musée de l’École de Nancy.
La Ville de Paris, et en particulier Karen Taïeb, adjointe à la Maire de Paris, dont le soutien constant et décisif fut essentiel, notamment en initiant en 2023 l’Année Guimard qui a largement contribué à faire connaître notre projet.
La mairie du 16e arrondissement pour son engagement en faveur du musée, et tout particulièrement :
Jérémie Redler, maire du 16e
Samia Badat-Karam, première adjointe
Bérengère Gréé, conseillère de Paris.
Le département de la Haute-Marne et la ville de Saint-Dizier pour leur mobilisation en faveur des fontes artistiques de Guimard, avec le concours de :
La fonderie GHM
Le musée municipal de Saint-Dizier et son conservateur Clément Michon
Élisabeth Robert-Dehault et tous les acteurs locaux engagés.
La Normandie et la ville de Cabourg, où Guimard construisit trois villas emblématiques (La Sapinière, La Bluette, La Surprise), avec le soutien de :
La Villa du Temps Retrouvé
Tristan Duval, Emmanuel Porcq, Roma Lambert.
Nos partenaires américains, qui ont largement contribué à la reconnaissance internationale de Guimard :
Le Driehaus Museum
L’Art Institute of Chicago
L’Alliance Française de Chicago
Le Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum de New York
Le Virginia Museum of Fine Arts
Delta Air Lines.
Et nous adressons également des remerciements appuyés à Barry Bergdoll, David Hanks, Sarah Coffin, Ingrid Gournay, David Dozier, Elisabeth Cummings.
En Catalogne, nous remercions Teresa Sala, Professeur d’Histoire de l’Art à l’Université de Barcelone et spécialiste du Modernisme catalan.
En Belgique, nous remercions le Horta Museum et son conservateur Benjamin Zurstrassen, ainsi que Françoise Aubry. Notre projet vise également à renforcer les liens entre Bruxelles et Paris autour de l’Art nouveau.

Loggia de l’hôtel Mezzara, au second étage de la façade sur rue, vue intérieure. Photo O. P.
Nous remercions également les professionnels qui ont contribué à la qualité et à la solidité de notre dossier de candidature :
Rydge Avocats, pour leur accompagnement juridique
KPMG, pour leur expertise financière et fiscale
Beaux-Arts Consulting, pour leur expertise stratégique et culturel
Thibierge Notaires, pour le volet notarial
REVA (Bruno Donzet et Maurice Masri), pour l’économie du projet
Picard Expertise, pour l’évaluation immobilière
Dozier Stratégie, conseils en partenariat et financement culturel.
Enfin, nous exprimons notre profonde gratitude à toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont soutenu ce projet : élus, chercheurs, musées, institutions, associations, journalistes, collectionneurs et passionnés — en France comme à l’étranger. À toutes les personnes qui, même brièvement, ont croisé notre chemin et apporté leur aide ou leurs conseils au bon moment, nous disons également merci. Ces dix années d’efforts nous ont permis de nouer de nombreux liens solides, souvent amicaux, que nous n’oublierons pas.
Le bureau du Cercle Guimard
Nicolas Buisson, Frédéric Descouturelle, Nicolas Horiot, Peggy Laden, Dominique Magdelaine, Olivier Pons

La Maison Moderne de Julius Meier-Graefe — Première partie
Grâce à notre adhérent suisse Michel Philippe Dietschy-Kirchner, nous sommes entrés en contact avec Bertrand Mothes qui est l’auteur d’une étude sur La Maison Moderne, fondée à Paris par le critique d’art allemand Julius Meier-Graefe. Souvent négligée au profit de sa concurrente plus connue La Galerie de l’Art Nouveau de Siegfried Bing, elle a pourtant édité des artistes décorateurs de premier plan, comme Maurice Dufrène. Ses liens avec Guimard sont ténus, indirects, mais non inexistants. Bertrand Mothes nous fait l’honneur de nous confier un résumé de son travail.
La dernière décennie du XIXe siècle est une période de changement radical dans le domaine des arts décoratifs en Europe. Artistes, mécènes, critiques, institutions participent activement à ce mouvement de renaissance des arts appliqués, certes selon des voies et des idées propres à chacun, mais toujours dans un objectif de rupture par rapport au pastiche historiciste dans lequel se sont enfermés les artistes décorateurs et les architectes durant la seconde moitié du siècle. Dans ce climat d’émulation, le rôle des marchands ne doit pas être négligé. En 1895, Siegfried Bing ouvre les Galeries de l’Art nouveau au 22, rue de Provence à Paris[1]. Si cette galerie est aujourd’hui la mieux connue et celle dont l’historiographie est la plus riche, il est important de prendre en compte l’environnement des galeries d’art parisiennes de la période, environnement dont fait partie La Maison Moderne. Cet établissement, fondé par le critique et historien d’art allemand Julius Meier-Graefe en 1899, s’inscrit face à l’Art Nouveau de Bing comme le second pôle du commerce des arts décoratifs novateurs dans la capitale française au tournant du siècle. Comme la Galerie de L’Art Nouveau, La Maison Moderne est une boutique où le Parisien peut venir meubler son habitation, acheter des œuvres d’art, des bibelots ou des accessoires de mode. Sa structure et son fonctionnement diffèrent cependant de ceux du 22 rue de Provence, et correspondent à l’état d’esprit du propriétaire des lieux. De même, la sélection des artistes — certains œuvrent pour les deux enseignes — est une manifestation des choix esthétiques de Julius Meier-Graefe.
L’âme de La Maison Moderne
Le premier élément à étudier pour comprendre la genèse de La Maison Moderne est la définition des buts de son créateur, Julius Meier-Graefe. En effet, la galerie est modélisée selon sa volonté, et c’est lui qui incarnera son âme durant toute la période où elle sera en activité. Fils d’Edward Meier, un des chefs de file de l’industrie sidérurgique en Allemagne, et de Marie Graefe qui décède en le mettant au monde[2], Julius Meier-Graefe est né le 10 juin 1867 à Reșița[3]. Sa famille déménage en Rhénanie et le jeune Julius grandit près de Düsseldorf. Il obtient l’Abitur en 1879 et débute des études industrielles en vue de reprendre les affaires paternelles[4], en 1888 à Munich puis l’année suivante à Zurich et à Liège. Il semble alors déjà attiré par le monde de l’art : il visite l’Exposition universelle de 1889 à Paris et part pour Berlin dès 1890. Il commence alors des études d’histoire de l’art sous l’enseignement d’Herman Grimm et quitte Berlin sans avoir été diplômé[5].

Edvard Munch, portrait de Julius Meier-Graefe, 1894. huile sur toile, haut. 100 cm, larg. 75 cm, collection: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, photo : Høstland, Børre, Creative Commons – Attribution CC-BY.
L’année 1893 voit les premières implications de Meier-Graefe dans le domaine artistique : il aide son ami Edvard Munch à organiser une exposition et publie son premier ouvrage, le roman Nach Norden (« Vers le Nord »). Il voyage cette même année en Angleterre où il rencontre les plus importants représentants de l’Aesthetic Movement et des Arts and Crafts que sont Oscar Wilde, William Morris, Edward Burne-Jones et Aubrey Beardsley[6]. En 1894, il participe à la fondation de l’association Pan et devient l’éditeur de la revue éponyme qui l’accompagne. Il partage le titre de rédacteur en chef avec l’écrivain Otto Julius Bierbaum. Meier-Graefe s’occupe de la rédaction des articles ayant trait aux beaux-arts et Bierbaum se charge de ceux qui sont consacrés à la littérature[7].
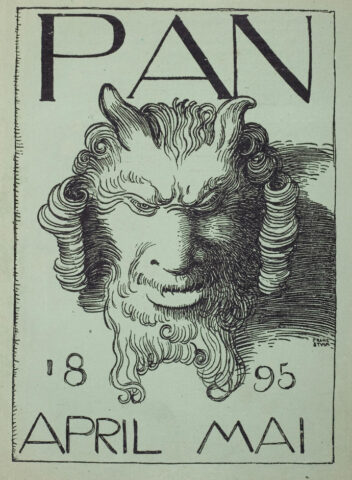
Franz von Stuck, Couverture de la revue Pan, avril-mai 1895. Coll. Université de Heidelberg. Droits réservés.
Il commence alors à écrire sur les arts décoratifs. Selon lui, la peinture a perdu son contact avec la société et il est nécessaire de se tourner vers les arts appliqués pour pouvoir espérer faire renaître l’art[8]. Meier-Graefe souhaite ainsi adjoindre un salon d’art à l’association Pan. Il veut faire de ce salon un endroit neuf, en rupture avec les expositions organisées alors et qui ne contentent plus le public, et se propose de réunir dans des intérieurs cohérents tous les arts, sans distinction entre beaux-arts et arts appliqués. Son but est alors de rallier artistes et spectateurs et de créer un milieu « moderne et harmonieux »[9]. Cette idée de salon d’art semble avoir émergé dans son esprit après son voyage avec Siegfried Bing en Belgique au printemps 1895. Ils visitent à Bruxelles la Maison d’Art de la Toison d’Or. Cette galerie, fondée en 1894 par la Société Anonyme l’Art, est installée dans l’hôtel particulier d’Edmond Picard, au 56 avenue de la Toison d’Or, et est dirigée par son fils William Picard. Le but de la Société Anonyme l’Art, qui est de stimuler la production des arts appliqués, se retrouve dans le procédé de présentation choisi qui est alors totalement nouveau : l’aménagement de l’hôtel est conservé et les objets – des œuvres d’art et d’artisanat contemporain destinées à la vie quotidienne – sont exposés dans les pièces. Cette manière de procéder diffère de l’ordonnancement habituel dans les galeries de l’époque qui consiste à simplement disposer les objets en vente sur des étagères dans des lieux sans âme et sans décoration. Bing et Meier-Graefe sont impressionnés par son aspect novateur[10]. Immédiatement après leur passage à la Maison d’Art, Meier-Graefe et Bing rendent également visite à Henry Van de Velde qui vient d’amorcer la construction de sa nouvelle maison, le Bloemenwerf, à Uccle. Dans ses mémoires, Van de Velde évoque alors « un voyage qui devait les renseigner sur le réveil des métiers d’art en Angleterre et dans divers pays du continent. De Bruxelles, ils devaient gagner l’Angleterre, reviendraient par la Hollande pour se rendre au Danemark, en Allemagne, en Autriche et en Tchécoslovaquie[11]. »

Vue du Bloemenwerf, maison d’Henry Van de Velde, construite en 1895 à Uccle dans la banlieue de Bruxelles. Droits réservés.
Van de Velde poursuit en exposant les intentions et les propositions de Meier-Graefe, qui compte nourrir son réseau de connaissances et trouver de nouveaux sujets d’articles afin de participer au développement des revues d’art en Allemagne. Ainsi Meier-Graefe propose à Van de Velde de figurer parmi les collaborateurs étrangers de la revue Pan. Les deux voyageurs sont alors, semble-t-il, convaincus de la nécessité de travailler avec Van de Velde et ne tarissent pas d’éloges sur son goût en matière d’aménagement intérieur[12]. Au moment du départ, Bing exprime son envie de reprendre contact avec Van de Velde en vue d’une éventuelle collaboration lorsqu’il sera de retour à Paris. C’est à la fin de ce voyage que Meier-Graefe encourage Bing à transformer sa galerie parisienne, enthousiasmé par l’exemple édifiant que constitue la Maison d’Art comme galerie novatrice.
À la fin de l’année, Meier-Graefe quitte l’association Pan à la suite d’une discorde liée à la publication, dans le numéro de septembre-novembre 1895 de la revue, d’une lithographie d’Henri de Toulouse-Lautrec, Mademoiselle Lender, en buste, jugée immorale par certains membres du comité de rédaction[13].

Henri de Toulouse-Lautrec, Mademoiselle Marcelle Lender en buste, 1895, lithographie en couleurs sur papier, Vente Tajan, Paris, 3 mai 2022, lot 43. Droits réservés.
Il part alors vivre à Paris dans les mois qui suivent, tout en continuant à collaborer avec des revues allemandes. À partir de cette date, Meier-Graefe écrit peu au sujet de la peinture et se focalise sur les arts décoratifs. En parallèle à cette activité d’écriture il devient à la fin de l’année 1895 conseiller artistique de Siegfried Bing dans sa galerie L’Art nouveau et y organise des expositions[14].

La galerie de L’Art nouveau Bing, à l’angle de la rue Chauchat et de la rue de Provence, réhabilitation par l’architecte Louis Bonnier en 1895. Photo Édouard Pourchet. Droits réservés.
Le rôle de Meier-Graefe au sein de l’entreprise de Bing le met au centre d’un réseau d’artistes, enrichissant celui déjà constitué en Allemagne. Cependant, son action n’est pas exempte de critiques négatives de la part d’acteurs principaux de la scène artistique française comme Auguste Rodin, Octave Mirbeau ou Edmond de Goncourt, qui l’accusent de vouloir renverser le « bon goût » et la tradition des arts décoratifs français. Meier-Graefe et L’Art nouveau sont cependant défendus par des critiques éminents, tels Camille Mauclair, Gustave Geffroy, Thadée Nathanson ou Roger Marx[15]. Au bout de six mois de collaboration, Meier-Graefe quitte la galerie de Bing. Les deux hommes continuent cependant de se fréquenter.
Julius Meier-Graefe retourne alors à l’écriture. Il décrit dans un article publié dans Das Atelier en 1896, ce qu’il considère comme dépassé dans le domaine de l’aménagement intérieur. Pour lui, la maison d’Edmond de Goncourt, meublée dans le goût du XVIIIe siècle, ne correspond plus au besoin d’un intérieur de la fin du XIXe siècle :
« Une personne moderne ne peut pas vivre dans un bric-à-brac du Second Empire. Arracher quelque chose à une autre époque et la placer dans un nouvel environnement peut être aussi désastreux que les imitations barbares des vieux modèles dans les arts décoratifs[16]. »
Meier-Graefe critiquera également l’aspect « muséal » de cette demeure lors de la vente aux enchères de son contenu en 1897[17]. Cette idée d’anachronisme concernant le décor intérieur et l’ameublement est constante chez Meier-Graefe, qui en fait un argument en faveur de la modernité. Il considère qu’« habiter un salon du plus pur style Régence, équivaut, pour un citoyen de la Troisième République, à s’affubler d’une perruque à marteau et d’un habit à rubans » et qu’un collectionneur meublant son intérieur en style ancien « se donne souvent aussi le ridicule du « Bourgeois Gentilhomme » [18] ».
C’est un autre article de Meier-Graefe, publié en juin 1896, qui fait figure de profession de foi et d’affirmation de son engagement pour le soutien des arts décoratifs modernes[19]. Il y développe son point de vue qui divise l’art entre « milieu extérieur » et « milieu intérieur ». Selon lui, le XIXe siècle a été le siècle du « milieu extérieur » dédié à un art réaliste, et son époque réagit à cette conception artistique avec un art « fantastique » – terme à comprendre aujourd’hui comme « symboliste » – qui aurait pour but d’être « utile ». Il place les arts appliqués au centre de ce renouveau de l’art et considère que la modernité pourra gagner le public via le domaine « neutre » des arts décoratifs. Il fait alors partie des personnes les mieux à même d’accompagner ce développement de l’art décoratif étant donné l’intérêt qu’il y porte mais également grâce à son savoir dans ce domaine et à son réseau de connaissances qui s’étend à toute l’Europe. Il partage ce point de vue avec de nombreux artistes qui commencent à délaisser la peinture et la sculpture afin de se consacrer à l’art « utile », Henry Van de Velde en tête.
Meier-Graefe continue d’écrire et se dote en 1897 du meilleur outil disponible pour véhiculer ses idées, une revue dont il sera le directeur : Dekorative Kunst. Cette revue en langue allemande est cofondée et éditée par le Munichois Hugo Bruckmann. Les articles sont en majorité écrits par Meier-Graefe lui-même, qui signe sous un grand nombre de pseudonymes différents[20]. Formée sur le modèle anglais de The Studio, la revue est internationale par son mode d’édition : publiée en Allemagne mais avec des bureaux installés à Paris. Sa vocation est également de dépasser les frontières comme l’indique le prospectus de lancement. Meier-Graefe y explique que l’œuvre d’art abstraite est devenue une fin en elle-même et ne s’adresse plus qu’à une minorité d’amateurs, alors que le domaine de l’intérieur et de la maison est abandonné à l’offre de fabricants sans scrupules qui se bornent à fabriquer de mauvaises répliques de styles anciens. Une réaction contre cet état de fait serait en marche et la nouvelle revue, consacrée uniquement à l’art décoratif moderne, participerait à ce renouvellement en préparant le terrain. Cet effort dirigé vers les arts appliqués modernes uniquement se démarque des autres revues, créées ou rénovées à la même période, qui se consacrent à l’art moderne autant qu’à l’art ancien, comme la Revue des Arts Décoratif et Art et Décoration, en France, The Studio, en Angleterre et Deutsche Kunst und Dekoration, en Allemagne.
Meier-Graefe ne se contente pas d’écrire sur les arts décoratifs, il met en application ses idées au sein de sa nouvelle revue avec la contribution d’artistes belges : la page de titre du premier numéro de Dekorative Kunst est ainsi dessinée par Henry Van de Velde ou Théo Van Rysselberghe[21]. Meier-Graefe fait appel pour les autres éléments de diffusion de sa revue à un troisième artiste belge, Georges Lemmen, qui dessine deux affiches et un papier à lettres. Meier-Graefe pousse son idée jusqu’à commander à Van de Velde l’aménagement des bureaux de rédaction de la revue au 37 rue Pergolèse, dans le 16e arrondissement[22].
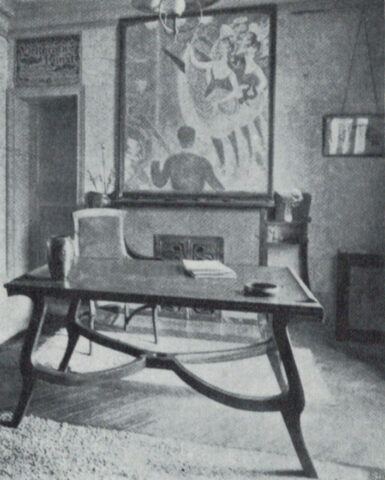
Salle de rédaction de la revue Dekorative Kunst à Paris, 37 rue Pergolèse, reproduit dans Henry Van de Velde, Sembach, Klaus-Jürgen, éd. Hazan, 1989. Au-dessus de la porte, on voit une affiche de Georges Lemmen avec le titre de la revue, et au-dessus de la cheminée, Le Chahut de Seurat (act. au musée d’Orsay). Droits réservés.
Il semble que Meier-Graefe soit déjà à l’origine de la collaboration entre le décorateur belge et Siegfried Bing en 1895[23]. Suite aux réactions négatives suscitées par ses aménagements intérieurs à L’Art nouveau — pour Rodin « Van de Velde est un barbare »[24] — Van de Velde semble ne plus apprécier Paris[25], mais Meier-Graefe, convaincu de son succès possible en France, fait tout pour l’y faire reconnaître.
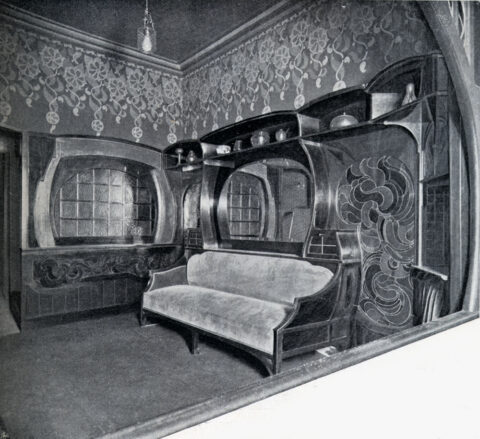
Salon aménagé par Henry Van de Velde pour l’ouverture de la Galerie de l’Art Nouveau Bing en 1895. Cliché reproduit dans l’ouvrage de Gabriel P. Weisberg, Les Origines de l’Art Nouveau, la maison Bing, éditions du Musée des Arts décoratifs, 2004. Droits réservés.
Au vu du succès rencontré par Dekorative Kunst et afin de propager encore plus largement ses idées, Meier-Graefe fonde la revue L’Art décoratif, pendant en français de la publication originelle. Le premier numéro est disponible en octobre 1898[26]. Il est entièrement consacré à Henry Van de Velde à qui Meier-Graefe fait appel pour le dessin de la couverture[27] ainsi que pour un nouvel aménagement des bureaux de la revue.
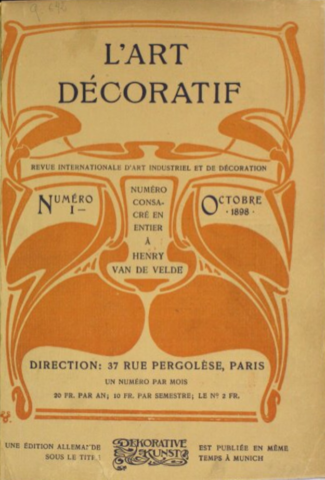
Henry Van de Velde, couverture du premier numéro de la revue L’Art Décoratif, octobre 1898. Bibliothèque de I’Institut national de l’histoire de l’art, collections Jacques Doucet. Droits réservés.

Julius Meier-Graefe et son épouse dans son bureau de la rédaction de la revue L’Art Décoratif, 37 rue Pergolèse à Paris, vers 1898-1899. Au mur à droite, Madone de Edvard Munch. Photo Bibliothèque royale de Belgique, Archives et Musée de la littérature, reproduit dans Henry Van de Velde Passion Fonction Beauté, publié à l’occasion de l’exposition éponyme au musée du Cinquantenaires à Bruxelles, 2013, éditions Lanoo, Tielt, 2013. Droits réservés.
Le sous-titre de L’Art décoratif, Revue internationale d’art industriel et de décoration est à lui seul un résumé du combat que Meier-Graefe a entrepris l’année précédente dans le monde germanophone et qu’il souhaite engager dans le monde francophone. Sa ligne de conduite est précisée dans la préface du premier numéro. Il ambitionne de trouver une manière rationnelle d’organiser la production et la diffusion des objets d’art modernes. Il veut rompre avec la tradition française qui met en valeur la « chose rare »[28]. Il déplore la situation des industries d’art de l’époque, qui pousse les artistes décorateurs à ne répondre qu’à des commandes de collectionneurs fortunés et n’incite pas les industriels possédant les infrastructures nécessaires à la fabrication d’objets en grande quantité à faire appel à des artistes pour dessiner leurs modèles, produisant uniquement des objets copiant les styles anciens. Meier-Graefe veut changer cet état de fait et souhaite réconcilier les artistes avec l’industrie « qui peut seule rendre le beau accessible au grand nombre[29] ». Dès le troisième numéro de L’Art décoratif , sa volonté de contribuer au commerce de l’art transparaît : un éventail de Georges de Feure tiré à cent exemplaires est proposé aux lecteurs de la revue, qui doivent s’adresser à la rédaction afin de commander l’objet[30]. Il s’agit de la première action de Meier-Graefe en tant que marchand d’art.
Le besoin d’une nouvelle galerie
Un changement radical se fait sentir dans l’action de Meier-Graefe. Même s’il quitte l’Art nouveau de Bing pour se concentrer sur ses activités d’écriture, il continue à considérer celle-ci comme étant la structure idéale pour la diffusion du style moderne à Paris. Cependant, au cours des dernières années du siècle, celui-ci amorce un changement dans le concept décoratif qu’il souhaite mettre en avant à L’Art nouveau. À peine un an après l’ouverture de la galerie, les bénéfices ne semblent déjà pas être à la hauteur de ses espérances, comme le souligne Paul Signac : « Les affaires ne marchent pas du tout ; il ne sait ni ce qu’il veut, ni ce que les clients veulent. Il est aux abois et je pense qu’il ne tardera pas à passer à d’autres exercices[31] ». Bing commence dès lors à favoriser des artistes ayant une conception plus « française » des arts décoratifs[32]. Ce « retour » à la « tradition française » du meuble voit son aboutissement lors de l’Exposition Universelle de 1900 où le pavillon de Bing présente des œuvres de Georges de Feure, Édouard Colonna et Eugène Gaillard.
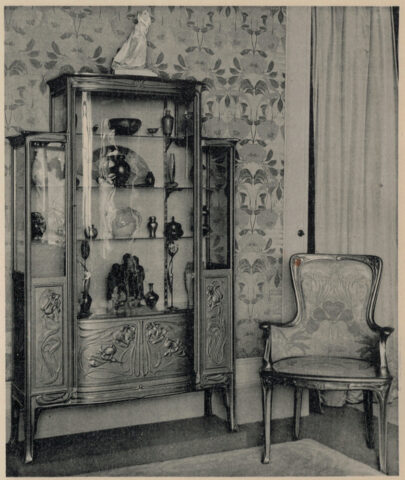
Vitrine et fauteuil en bois doré de Georges de Feure dans le pavillon Bing à l’Exposition Universelle de Paris en 1900. Portfolio Meubles de style moderne Exposition universelle 1900. Coll. part.
Meier-Graefe, lui « ne permettra aucune sorte de compromis, au moins pour le moment[33] ». Il a de plus déjà pris conscience des enjeux économiques et financiers que peut avoir une entreprise comme L’Art Nouveau. Les entreprises de Louis Majorelle et de Gustave Serrurier-Bovy sont alors des modèles d’établissements florissants aux procédés distincts de ceux de Bing. Même si celui-ci installe son propre atelier afin de créer des objets de luxe pour sa galerie, Meier-Graefe considère qu’il a alors « sous-estimé l’énorme croissance de ce marché de produits nouveaux » et qu’il ne tient pas compte du contexte concurrentiel propre aux galeries de mobilier parisiennes[34].
Ces différents facteurs conduisent Meier-Graefe à envisager la création de sa propre galerie d’art privée, qu’il dirigera, et où il exposera uniquement les œuvres d’artistes correspondant à sa vision de l’art décoratif moderne. En 1899, Meier-Graefe a déjà longuement réfléchi au problème et ses idées sont arrivées à maturité. Le projet est lancé dans le courant de l’année. Grâce aux « ressources de son sentiment instinctif et de ses connaissances[35] », Meier-Graefe commence à réunir une « équipe » d’artistes chargés de choisir les œuvres qu’il va vendre dans sa galerie mais également comment et par qui elle sera aménagée. À partir de cette date, il abandonne progressivement la direction éditoriale de Dekorative Kunst et de L’Art décoratif pour se consacrer entièrement à son projet[36]. Il peut de plus débuter son affaire grâce à un fort apport d’argent hérité de son père décédé en 1899. L’absence d’archives ne nous permet cependant pas de savoir si Meier-Graefe a pu bénéficier d’un soutien financier autre que son héritage et son investissement personnel lors de la création de sa galerie[37]. Son changement d’activité et son implication de plus en plus importante sont loués dans la préface des Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle publiée en 1901 par La Maison Moderne :
« Voici dix ans ce fut son plaisir de soutenir, dans les revues, avec une chaleur d’âme passionnée, la doctrine de l’égalité des arts […] ; mais M. Meier-Graefe ne s’est pas contenté de l’action contemplative et d’ordinaire inefficace dévolue au critique ; il a entendu faire la preuve de ses dires, passer de la théorie à la pratique, de la propagande au fait.[38] »
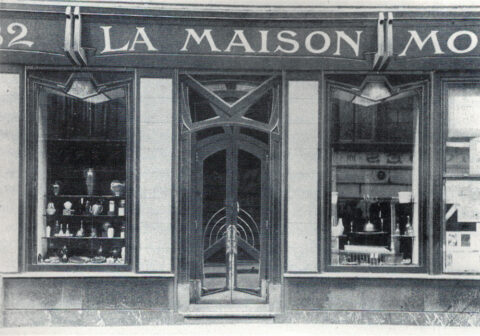
Devanture de La Maison Moderne, 82 rue des Petits-Champs à Paris, Deutsche Kunst und Dekoration, 1900, reproduit dans Henry van de Velde, Ein europäischer Kunstler seiner Zeit, Sembach/Schulte, catalogue des expositions éponymes 1992-1993, éd. Weinand-Verlag, Köln, 1992. Droits réservés.
L’ouverture de la galerie est rapportée par les revues dont il est encore le directeur. Le numéro de septembre 1899 de L’Art décoratif comporte une page rédigée par Meier-Graefe lui-même (sous un pseudonyme) annonçant l’ouverture prochaine de La Maison Moderne, « une nouvelle maison de production et de vente d’objets d’art usuels[39] ». Le numéro suivant précise la date de cette ouverture prévue pour la deuxième quinzaine d’octobre, et annonce qu’un vernissage aura lieu où seront conviés les lecteurs abonnés à la revue[40]. L’ouverture au public est cependant reportée, comme en témoigne le numéro de novembre 1899, « par suite de travaux d’aménagement que les entrepreneurs n’avaient pas prévus[41] ». Il s’agit de la dernière mention d’une ouverture prochaine de la galerie. La lettre envoyée par Van de Velde à sa femme Maria, datée du 15 novembre 1899 et mentionnant l’ouverture de la galerie, nous permet d’estimer plus précisément la date de cet événement qui a dû avoir lieu entre le 1er et le 15 novembre 1899. Van de Velde explique que l’ouverture de La Maison Moderne n’a pas été un événement mondain aussi fameux que celle de L’Art nouveau quatre ans plus tôt, sans toutefois s’en inquiéter : « Cette ouverture n’est pas sensationnelle, tant s’en faut mais néanmoins je crois au succès de l’entreprise[42] ». Malgré le peu d’enthousiasme généré par la création d’une nouvelle galerie, Meier-Graefe et ses collaborateurs sont alors convaincus de leur potentiel novateur et de la réussite future de leur action.
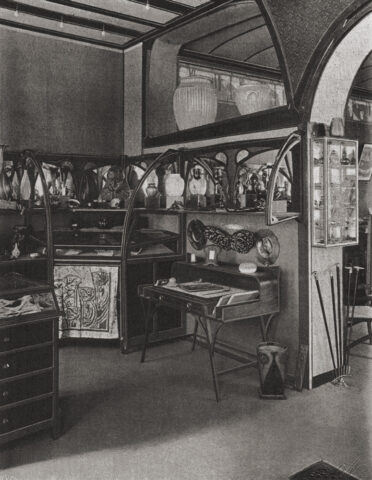
Aménagement intérieur de La Maison Moderne à Paris, Deutsche Kunst und Dekoration, 1900, reproduit dans Henry Van de Velde Passion Fonction Beauté, publié à l’occasion de l’exposition éponyme au musée du Cinquantenaires à Bruxelles, 2013, éditions Lanoo, Tielt, 2013. Droits réservés.
La Maison Moderne est, pour son créateur, une entreprise sans précédent : opposée aux salons et aux expositions officielles par la multiplicité des objets exposés et par leur présence en plusieurs exemplaires mais également opposée aux grands magasins grâce à l’indiscutable qualité artistique des objets proposés à l’achat, elle est aussi différente des boutiques dépendantes d’ateliers comme chez les frères Daum ou chez Louis Majorelle. La Maison Moderne fait partie du même type d’enseigne que la galerie de Bing, mais là encore, Meier-Graefe considère qu’une grande différence — autre que stylistique — les sépare. Contrairement à Bing qui choisit de plaire à une clientèle très aisée, Meier-Graefe veut inclure son établissement dans « une nouvelle catégorie de « galeries d’art moderne » qui répondrait aux besoins d’un nombre de plus en plus important de personnes pour lesquelles les objets vendus dans les boutiques existantes sont difficilement accessibles[43] ». Le public visé est donc bien plus large que celui de Bing. La raison mise en avant pour ce choix est la volonté de mettre l’art à la portée du plus grand nombre. Selon le rédacteur de la préface des Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, « la création de la Maison Moderne n’a pas eu d’autre origine que la volonté bien arrêtée de satisfaire un idéal qui avait été celui de William Morris, chez nos voisins d’Outre-Manche, et que, jusqu’en 1898, nul n’avait réussi à réaliser parmi nous[44] ». Cette volonté sociale mise en avant à l’ouverture de la galerie peut également s’expliquer par le fait qu’un commerce vendant des objets de qualité à prix raisonnable peut s’attendre à réaliser un plus grand nombre de ventes qu’une galerie comme celle de Bing, et donc à être viable économiquement. En effet, l’aspect financier de La Maison Moderne est un élément important à prendre en compte : si les idées de Meier-Graefe sont honorables et sa volonté de remplir les espaces d’habitation des ménages modestes sont louables, il lui faut pour réussir son entreprise une prospérité financière certaine. L’idéal social propre au mouvement Art nouveau est ainsi soumis à la réussite économique, sans laquelle aucune création et diffusion d’objets nouveaux n’est possible. Cette bonne santé financière encouragerait de plus les artistes les plus renommés à vouloir collaborer avec la galerie. Ces principes directeurs sont dès le départ présents dans la ligne de conduite de la galerie et sont explicités dans les articles qui accompagnent son ouverture[45]. Dans la préface des Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, les principes de fonctionnement et la variété des objets vendus sont mis en avant. Max Osborn explique un an après l’ouverture la place prise par la galerie dans le milieu du marché de l’art parisien et le rôle de son directeur :
« L’un des phénomènes caractéristiques les plus récents de l’époque actuelle, où l’art et l’artisanat sont enfin réunis après une trop longue séparation, c’est le bazar des arts décoratifs, établissement hybride qui tient le milieu entre la galerie d’art et le grand magasin, proposant à la fois des produits de luxe et des objets d’usage courant, et dont le propriétaire est une combinaison insolite de connaisseur, d’artiste, de critique d’art, de mécène, et d’homme d’affaires au sens le plus noble du terme[46] ».
Max Osborn met également en évidence le côté paradoxal de la situation des arts décoratifs parisiens : les deux enseignes les plus importantes sont dirigées par des Allemands qui tentent suivant leur propre voie d’« enraciner » l’Art nouveau en France. Van de Velde mentionne dans ses mémoires la force de volonté dont fait preuve Meier-Graefe à l’égard de sa conception des arts décoratifs mais exprime des doutes sur sa capacité à pouvoir mener un projet de cette envergure :
« La Maison Moderne devait se différencier des galeries Art Nouveau de Samuel Bing par l’intransigeance de son programme ; il s’agissait d’y rassembler cette partie du public qui se sentait attirée par une évolution de la peinture et de la sculpture vers des formes sûres, vers des qualités essentielles. Julius Meier-Graefe était de taille à réaliser un tel programme. Il ne manquait certes pas d’ambition, mais de moyens financiers et de la persévérance nécessaire pour se vouer seul à cette mission[47] ».
Les craintes de Van de Velde sont aussi justifiées par l’ampleur que veut donner Meier-Graefe à sa galerie. S’il ouvre son premier établissement à Paris, il souhaite également créer des antennes dans toute l’Europe œuvrant à la diffusion d’un art industriel moderne[48].

Aménagement intérieur de La Maison Moderne à Paris, Deutsche Kunst und Dekoration, 1900, reproduit dans Henry Van de Velde Passion Fonction Beauté, publié à l’occasion de l’exposition éponyme au musée du Cinquantenaires à Bruxelles, 2013, éditions Lanoo, Tielt, 2013. Droits réservés.
L’initiative de Meier-Graefe est alors très novatrice en France et La Maison Moderne doit être le tremplin d’une nouvelle alliance entre art, industrie et commerce. Il tente de constituer alors le seul trio capable d’offrir à une critique et à un public réticent des objets et des ameublements abordables, un trio qui serait constitué de l’artiste, du fabricant et du marchand[49]. Une fois sa galerie ouverte et ce jusqu’à sa vente, Meier-Graefe va progressivement se désengager de la direction de Dekorative Kunst et de L’Art décoratif, même si le partage de bureaux administratifs de la rue des Petits-Champs entre la galerie et les périodiques ainsi que la fréquence d’articles publiés par lui dans les deux revues indiquent que ce désengagement ne sera jamais total. S’il se présente volontiers comme directeur de La Maison Moderne et de L’Art décoratif, il lui est difficile de concilier ouvertement la direction d’une galerie d’art moderne avec la rédaction d’articles dans des revues militant pour la même cause[50]. Il réussit à mener une action concertée grâce à l’utilisation de son nom réel à la tête de La Maison Moderne et à l’emploi de pseudonymes pour la publication de ses articles.
Si la fondation de Dekorative Kunst puis de L’Art décoratif ont placé Meier-Graefe sur le devant de la scène artistique parisienne, la création de La Maison Moderne le distingue comme l’un des acteurs principaux du marché de l’art au début du XXe siècle. Il dispose alors de tous les moyens nécessaires pour diffuser ses idées grâce aux écrits publiés et aux objets proposés à la vente. De plus sa qualité de directeur de galerie lui permet de sélectionner les artistes avec lesquels il souhaite collaborer et constitue par ce biais un réseau de création à l’échelle européenne pouvant contribuer à alimenter le climat d’émulation qui règne alors dans la capitale française. Cependant, son positionnement en tant que défenseur d’un art décoratif moderne, déterminé à « déclarer la guerre au goût français et à la situation en France », fait de La Maison Moderne une entreprise risquée, qui doit convertir au plus vite le public parisien au goût moderne sous peine de disparaître.
Bertrand Mothes
Notes
[1] Cat. exp. Les origines de l’Art nouveau: la Maison Bing, Anvers, Fonds Mercator, Paris, Les Arts décoratifs, Amsterdam, Van Gogh Museum, 2004.
[2] Lee SORENSEN, « Julius Meier-Graefe », Dictionary of Art Historians, [http://www.dictionaryofarthistorians.org/meiergraefej.htm].
[3] Ville de Banat, aujourd’hui en Roumanie.
[4]Kenworth MOFFETT, Meier-Graefe as Art Critic, Munich, Prestel-Verlag, 1973, p. 9.
[5] Lee SORENSEN, « Julius Meier-Graefe », Dictionary of Art Historians, [http://www.dictionaryofarthistorians.org/meiergraefej.htm].
[6] Cat. exp. Alexandre Charpentier (1856-1909). Naturalisme et Art Nouveau, Paris, Musée d’Orsay, N. Chaudun, 2007, p. 126.
[7] Jean-Michel LENIAUD, L’Art nouveau, Paris, Citadelles & Mazenod, 2009, p. 453-454.
[8] Cat. exp. Art nouveau : Symbolismus und Jugendstil in Frankreich, Stuttgart, Arnoldsche, 1999, p. 150.
[9] Catherine KRAHMER, « Meier-Graefe et les arts décoratifs, un rédacteur à deux têtes » dans Alexandre KOSTKA, Françoise LUCBERT (dir.), Distanz und Aneignung, Relations artistiques entre la France et l’Allemagne 1870-1945, Berlin, Akademie Verlag, 2004, p. 232.
[10] Cat. Exp Georges Lemmen 1865-1916, Bruxelles, Crédit Communal, Gand, Snoeck-Ducaju & Zoon, Anvers, Pandora, 1997, p. 51.
[11] Henry VAN DE VELDE, Récit de ma vie. 1, Anvers, Bruxelles, Paris, Berlin (1863-1900), texte établi et commenté par Anne VAN LOO et Fabrice VAN DE KERCKHOVE, Bruxelles, Versa, Paris, Flammarion, 1992, p. 263.
[12] La conversation a lieu dans le salon de musique de la maison de la belle-mère de Van de Velde, qu’il vient de réaménager pour Irma Sèthe, sœur de sa femme Maria, avec un papier peint à motif de dahlias.
[13] Roger CARDON, Georges Lemmen (1865-1916), Anvers, Petraco-Pandora, 1990, p. 448.
[14] Les origines de L’Art nouveau : la Maison Bing, op. cit., note 1, p. 236.
[15] MOFFETT, op. cit., note 4, p. 28.
[16] Julius MEIER-GRAEFE, « L’Art Nouveau. Das Prinzip », Das Atelier, 1896, n °5, p. 2-4 ; traduction par Edwin Becker dans Les origines de L’Art nouveau : la Maison Bing, op. cit. note 1, p. 129-131.
[17] MOFFETT, op. cit., note 4, p. 28.
[18] Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle. Reproductions photographiques des principales œuvres des collaborateurs de la Maison Moderne. Commentées par R. [Raoul] AUBRY, H. [Henri] FRANTZ, G.-M. JACQUES [pseud. Julius MEIER-GRAEFE], G. [Gustave] KAHN, J. [Julius] MEIER-GRAEFE, Gabriel MOUREY, Y. [Yvanhoé] RAMBOSSON, E. [Émile] SEDEYN, Gustave SOULIER, G. [Georges] BANS, avec neuf hors textes par Félix VALLOTTON Les Métiers d’Art. Paris, Édition de La Maison Moderne, 1901, p. 11 [Préface].
[19] Julius MEIER-GRAEFE, « Dekorative Kunst », Neue Deutsche Rundschau, juin 1896, p. 543-560.
[20] Sur les pseudonymes de Meier-Graefe, voir KRAHMER, op. cit. note 9, p. 248-249.
[21] Catherine Krahmer attribue le dessin de la couverture à Van de Velde (KRAHMER, op. cit. note 9, p. 233) et Roger Cardon l’attribue à Van Rysselberghe (CARDON, op. cit. note 13, p. 445-446).
[22] CARDON, op. cit. note 13, p. 176.
[23] VAN DE VELDE, op. cit. note 11, p. 267.
[24] VAN DE VELDE, op. cit. note 11, p. 277.
[25] LENIAUD, op. cit. note 7, p. 129.
[26] VAN DE VELDE, op. cit. note 11, p. 341.
[27] La composition de Van de Velde sera utilisée comme couverture de L’Art décoratif jusqu’au n° 24 de la revue, en septembre 1900.
[28] KRAHMER, op. cit. note 9, p. 239.
[29] Julius MEIER-GRAEFE [n. s.], « Préface », L’Art décoratif, octobre 1898, n °1, p. 2.
[30] L’Art décoratif, décembre 1898, n° 3, n. p.
[31] Lettre de Paul Signac à Charles Angrand, 30 décembre 1896, archives privées, citée dans Paris-Bruxelles, Bruxelles-Paris symbolisme, art nouveau : les relations artistiques entre la France et la Belgique, 1848-1914, cat. exp., Paris, Réunion des musées nationaux, Anvers, Fonds Mercator, 1997, p. 393.
[32] Nancy J. TROY, Modernism and the Decorative Arts in France : Art Nouveau to Le Corbusier, New Haven et Londres, Yale University Press, 1991, p. 32.
[33] « Meier-Graefe lässt sich, wenigstens vorläufig, auf solche Kompromisse nicht ein » (Max OSBORN, « La Maison Moderne in Paris », Deutsche Kunst und Dekoration, novembre 1900, vol. VII, p. 102).
[34] Stephen ESCRITT, L’Art nouveau, Paris, Phaidon, 2002, p. 316.
[35] Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, op. cit., note 18, p. IV [Préface].
[36] Art nouveau : Symbolismus und Jugendstil in Frankreich, op. cit.,note 8, p. 151.
[37] TROY, op. cit., note 32, p. 46.
[38] Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, op.cit., note 18, p. I [Préface]. Cette reconnaissance de l’action de Meier-Graefe est à modérer : il semble qu’il soit lui-même l’auteur de la préface des Documents sur l’Art Industriel au vingtièème siècle ainsi que celui du commentaire de la section « Ameublement », étant mentionné sur la page de garde comme l’un des contributeurs à l’ouvrage alors qu’aucun des textes signés ne l’est de son nom. Il est cependant indiscutablement l’auteur du commentaire sur les objets en métal et objets d’éclairage, signé sous son pseudonyme G.-M. Jacques.
[39] R. [pseud. Julius MEIER-GRAEFE], « Chronique de l’art décoratif, La « Maison Moderne » », L’Art Décoratif, septembre 1899, n° 12, p. 277.
[40] R. [pseud. Julius MEIER-GRAEFE], « Chronique de l’art décoratif, La « Maison Moderne » », L’Art Décoratif, octobre 1899, n° 13, p. 51.
[41] R. [pseud. Julius MEIER-GRAEFE], « Chronique de l’art décoratif, La « Maison Moderne » », L’Art Décoratif, novembre 1899, n° 14, p. 96
[42] Paris-Bruxelles, Bruxelles-Paris, op. cit., note 31, p. 392.
[43] TROY, op. cit., note 32, p. 43 ; ESCRITT, op. cit., note 34, p. 318.
[44] Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, op. cit., note 18, p. I [Préface].
[45] R., op. cit., note 3_9, p. 277.
[46] OSBORN, op. cit., note 33, p. 99.
[47] VAN DE VELDE, op. cit., note 11, p. 357.
[48] KRAHMER, op. cit., note 9, p. 240.
[49] Rossella FROISSART PEZONE, L’art dans tout. Les arts décoratifs en France et l’utopie de l’Art Nouveau, Paris, CNRS Éditions, 2004, p. 69.
[50] [50] KRAHMER, op. cit., note 9, p. 237.
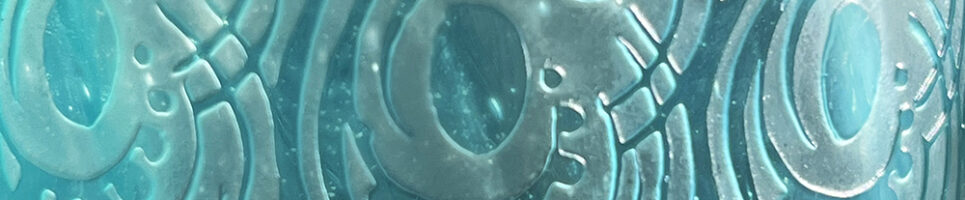
Un rare vase en cristal de Guimard
Pisté depuis des années, ce vase exceptionnel est tout récemment entré dans les collections de notre partenaire pour le projet de musée Guimard. Des négociations au long cours ont abouti à l’acquisition de cet objet rare, le premier de son genre à être identifié et décrit. Contrairement à d’autres domaines des arts décoratifs où Guimard a abondamment créé, il a en effet très peu produit pour la verrerie.

Vase Guimard de la Cristallerie de Pantin, haut. 40,2 cm, diamètre extérieur au niveau de l’ouverture : 5,2 mm, diamètre extérieur à la base : 12,7 cm, poids, 1,437 kg. Coll. part. Photo F. D.
La forme générale est celle, assez banale pour la verrerie de style Art nouveau, d’un « vase bouteille » pouvant se décomposer en trois parties : une base très aplatie soulignée par un ressaut, un fût très légèrement conique et un rétrécissement sommital avant l’inflexion de l’ouverture vers l’extérieur. Cette forme, pourvue de côtes tournoyantes, semble inédite chez Guimard qui n’a pas tenté de reproduire les silhouettes de ses modèles conçus pour le bronze ou pour la céramique. Mais comme nous le verrons plus loin, sommes-nous certains que Guimard soit l’auteur de cette forme ?
Ce vase est longtemps resté dans la famille du vendeur, mais il n’a pas été possible d’en connaitre les conditions d’achat originelles. Il est en bon état, malgré quelques griffures et la marque d’un léger dépôt calcaire montrant qu’il a été utilisé à une époque comme vase à fleurs.
Il a été produit à la Cristallerie de Pantin[1], comme l’indique la signature gravée en intaille à son culot, autour du logo « STV » reprenant les initiales du nom exact de la cristallerie : Stumpf, Touvier, Viollet & Cie.
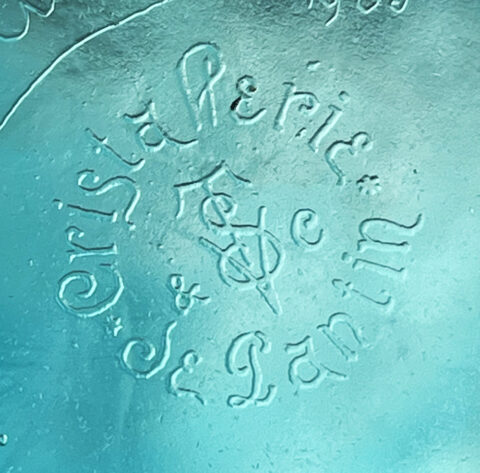
Signature de la Cristallerie de Pantin au culot du vase. Coll. part. Photo Justine Posalski.
Haut de 40,2 cm et pesant 1,437 kg, il a un volume de 0,480 litre. Ces deux dernières données permettent de calculer sa densité : 2,99, très proche de celle du cristal au plomb classique (3,1).

Calcul du volume du vase Guimard de la Cristallerie de Pantin. Coll. part. Photo Fabien Choné.
La question de la nature exacte de son matériau se posait, même si le vase provient d’une cristallerie, car nous avons établi que les verrines des candélabres des accès du métro produites par cette même cristallerie à partir de 1901 étaient en verre, sans ajout de plomb. Le Cercle Guimard en a récemment acheté un exemplaire.

Verrine d’un candélabre du métro Guimard. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.
Le culot du vase est également porteur de la signature manuscrite et cintrée de Guimard. Elle est caractérisée par la continuité du graphisme en un seul trait joignant le prénom et le nom et se terminant par le long paraphe revenant les souligner. On note que son exécution à la pointe est un peu plus hésitante que celle du logo de la cristallerie pour lequel l’ouvrier affecté à cette tâche répétitive disposait d’un pochoir.

Signature de Guimard au culot du vase de la Cristallerie de Pantin. Photo Justine Posalski.
Le millésime « 1903 » figure également sous la signature et nous renvoie à l’époque du pavillon que Guimard a édifié au sein de la nef du Grand Palais pour l’Exposition de l’Habitation cette année-là. À cette occasion il a fait éditer la série de cartes postales Le Style Guimard reproduisant ses principales œuvres architecturales.

Le pavillon « Le Style Guimard » au sein de l’Exposition de l’Habitation au Grand Palais en 1903. Carte postale ancienne n° 1 de la série Le Style Guimard. Coll. part.
Dans la liste des collaborateurs qui figure sur le prospectus joint à l’emballage de la série de ces cartes postales, on retrouve la mention de la Cristallerie de Pantin, au 66 rue d’Hauteville, lieu de son dépôt parisien.
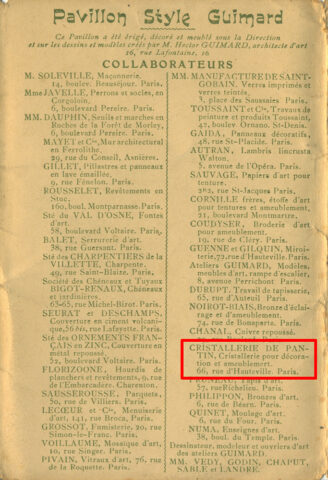
Vue partielle du prospectus de l’emballage de la série des cartes postales Le Style Guimard. Coll. part.
La cristallerie figurait dans cette liste de collaborateurs, d’une façon certaine pour les verrines du portique d’accès de métro qui encadrait l’entrée du pavillon de Guimard, et sans doute aussi pour un autre produit exposé : probablement des vases, comme le suggère le descriptif que Guimard a associé au nom du fournisseur : « cristallerie pour décoration et ameublement ». Mais les vues de l’intérieur du pavillon que nous connaissons ne montre pas malheureusement pas ces vases. D’ailleurs, rien n’indique qu’à cet instant les cristaux présentés dans le pavillon étaient déjà le fruit d’une collaboration entre l’architecte et la Cristallerie de Pantin. Guimard a pu tout simplement choisir des produits de la cristallerie sur catalogue afin de décorer les meubles exposés. L’année suivante, en revanche, nous avons acquis la certitude que cette collaboration a abouti. Dans l’opuscule que Guimard a édité à l’occasion du Salon d’automne de 1904, il a détaillé son envoi par catégories. Le numéro 4 des « Objets d’art Style Guimard » est décrit de la façon suivante : « Vase Style Guimard en cristal aigue marine. Prix : 65 francs ».
Cette dénomination « aigue-marine » n’a pas été inventée par Guimard qui, au contraire, s’est inséré dans une production de la Cristallerie de Pantin qui avait démarré quelques années plus tôt. Elle fait bien sûr référence au nom de la pierre fine, une variété de béryl, de couleur bleu clair, évoquant la mer. Ces nuances bleutées, difficiles à obtenir, ont été recherchées de façon empirique par différentes cristalleries françaises. Émile Gallé à Nancy a ainsi obtenu avec un monoxyde de cobalt une couleur d’un bleu très léger nommée « clair de lune », dévoilée à l’Exposition universelle de 1878. À la Cristallerie de Pantin, pour obtenir un verre légèrement opacifié à irisations intermédiaires turquoises, le jaune du dioxyde d’urane et le vert d’un oxyde de chrome ont été mêlés au bleu de cobalt.
La première mention de production de cristaux « aigue-marine » par la Cristallerie de Pantin que nous connaissons a fait l’objet d’une page du catalogue de la Maison Moderne[2] paru en 1901.
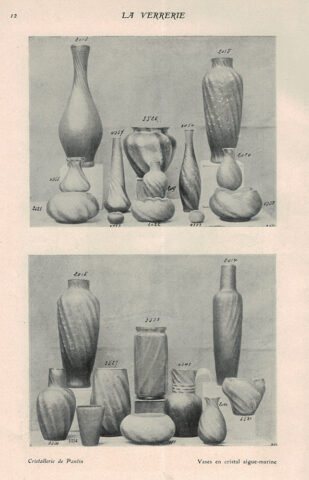
Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle (catalogue de La Maison Moderne), Paris, Edition de La Maison Moderne, 1901, p. 12, « Crisallerie de Pantin/Vases en cristal aigue-marine ». Coll. part.
Sur les deux photographies de cette page, vingt-deux vases de différentes formes et d’une couleur qui ne peut être que bleutée présentent tous des côtes tournoyantes, souvent régulièrement ponctuées de reliefs comme le sont les surfaces des coquillages, autre manière de rappeler l’inspiration marine de la série. Le ou les auteurs de ces formes modernes ne sont pas mentionnés, signe qu’il s’agit probablement d’employés de la cristallerie[3].
Le vase en cristal de Guimard ne nous était pas complètement inconnu puisque les documents de la donation Adeline Oppenheim-Guimard conservés à la Bibliothèque des Arts Décoratifs permettent d’en identifier au moins deux exemplaires décorant un meuble probablement présenté au Salon d’Automne.

Coll. Bibliothèque des Arts Décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.
Au sein du même ensemble documentaire, un autre modèle de vase torsadé, avec une base plus piriforme et un col plus effilé, est très proche du n° 4357 de la page du catalogue de la Maison Moderne (cf. supra). L’intervention de Guimard n’y est pas pour autant attestée.

Coll. Bibliothèque des Arts Décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.
Autre exemple de vase qui pourrait provenir de la Cristallerie de Pantin, le modèle en cristal translucide présenté dans la vitrine du grand salon de l’hôtel Guimard reprend le même type de torsades.

Détail de la vitrine du grand salon de l’hôtel Guimard. Coll. part.
On notera qu’aucun de ces vases ne présente de décor floral surajouté imitant le style des verreries nancéiennes Gallé et Daum. Il s’agit peut-être d’une demande expresse de la Maison Moderne, exigeant une certaine sobriété plus conforme à la ligne belge de Van de Velde qu’elle défend. Car, en dehors de la Maison Moderne, la Cristallerie de Pantin a produit de nombreux modèles de vases « aigue-marine » à décor floral que l’on retrouve de temps à autre sur le marché de l’art.

Vase « aigue-marine » à décor floral gravé à l’acide de la Cristallerie de Pantin, galerie en ligne les_styles_modernes, vente sur eBay Pays-Bas, mai 2025, haut. 24,8 cm, diam. 10,3 cm, poids, 796 g. Photo les_styles_modernes, droits réservés.

Vase « aigue-marine » à décor floral gravé à l’acide de la Cristallerie de Pantin, galerie en ligne les_styles_modernes, vente sur eBay Pays-Bas, mai 2025, haut. 24,8 cm, diam. 10,3 cm, poids, 796 g. Photo les_styles_modernes, droits réservés.
Comme ces vases, celui de Guimard possède lui aussi un décor gravé à l’acide, mais qui lui est propre et qui témoigne des recherches qu’il a menées pour renouveler son style semi-abstrait en s’éloignant progressivement des arrangements harmoniques de lignes courbes ou capricieuses qui le caractérisaient autour de 1900.

Détail du décor du vase Guimard de la Cristallerie de Pantin. Coll. part. Photo F. D.
Encore une fois, il n’est pas simple de décrire ou d’interpréter ce décor qui laisse l’imagination de l’observateur trouver ses propres références. Si une inspiration végétale parait toujours présente avec des tiges et des fleurs fortement stylisées et répétées dix fois sur la circonférence, un motif s’inspirant de la clef de sol n’est pas impossible.
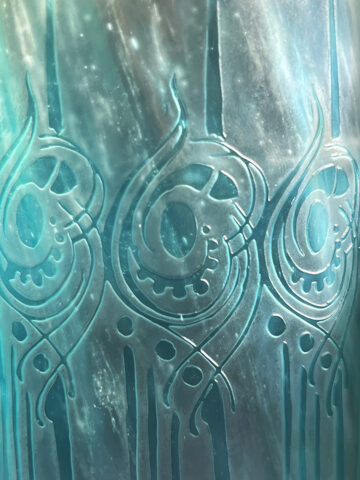
Détail du décor du vase Guimard de la Cristallerie de Pantin. Coll. part. Photo F. D.
Certains des dessins aquarellés de projets de frises, non datés, donnés par sa veuve Adeline Oppenheim au Musée des Arts Décoratifs présentent quelques similitudes stylistiques.

Guimard, détail d’un projet pour une frise, aquarelle sur papier. Coll. Bibliothèque des Arts Décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.
D’autres éléments du décor comme les filets bleus ou la coloration jaune en partie haute nous permettent d’avancer des hypothèses quant au processus de fabrication du vase. Comme pour toute fabrication, le verrier cueille dans le four une paraison avec sa canne creuse et lui donne une première forme ébauchée par soufflage et balancement. Puis il roule la paraison sur le « marbre » (une table en fonte dépolie) pour lui adjoindre des poudres d’os calcinés et d’arséniates qui y ont été préalablement disposés et qui donneront au verre un aspect satiné sur toute la hauteur du vaisseau ainsi qu’une coloration jaune au niveau de son quart supérieur. De plus, des filets bleus également torsadés, visibles en partie supérieure et en partie inférieure du vase, ont été préparés à l’avance, posés puis recouverts d’une nouvelle couche de verre reprise dans le four. Il s’agit donc d’un décor intercalaire et non de la technique habituelle des filets vénitiens qui sont plaqués en surface.

Col du vase Guimard de la Cristallerie de Pantin avec les filets bleus intercalaires. Coll. part. Photo F. D.

Base du vase Guimard de la Cristallerie de Pantin avec les filets bleus intercalaires. Coll. part. Photo F. D.
Le vaisseau de verre étant toujours au bout de la canne (du côté de la future ouverture), la base est ébauchée par gravité et tamponnement contre le marbre. Puis il est introduit dans le moule bivalve et soufflé de façon à être plaqué sur les parois. C’est à ce moment que l’essentiel des reliefs tournoyants est donné. Une fois le moule ouvert, le vaisseau est repris sous la base à l’aide d’une petite masse de verre en fusion au bout d’une barre de fer (le pontil). Du côté opposé, le col reçoit une torsion (comme en témoigne la disposition des bulles d’air qui suivent ce mouvement) avant d’être détaché de la canne en le coupant aux ciseaux et en le façonnant à la pince.

Col du vase Guimard de la Cristallerie de Pantin. Coll. part. Photo Justine Posalski.
Après un léger refroidissement qui assure sa stabilité, le vaisseau est enrobé d’une couche mince d’un verre d’un bleu plus intense que le verrier va cueillir dans un second four. Le vase est alors détaché du pontil qui lui laisse une cicatrice sous la base. Après un refroidissement progressif, il reçoit un traitement à l’acide fluorhydrique du verre bleu plaqué en surface. Pour dégager le décor qui sera conservé en bleu, on a préalablement protégé sa surface par un vernis (à cette époque du bitume de Judée), tandis que les surfaces non protégées sont éliminées par l’acide jusqu’à faire apparaitre le verre sous-jacent. Sous la base, la trace du pontil est effacée par meulage et polissage pour pouvoir y graver le logo de la cristallerie et la signature de Guimard comme nous l’avons vu plus haut. En revanche, au niveau de l’ouverture, les irrégularités de surface qui subsistent montrent que le verre n’a pas été retravaillé par meulage.

Col du vase Guimard de la Cristallerie de Pantin. Coll. part. Photo F. D.
Si ce vase est parvenu si tardivement à la connaissance des spécialistes de Guimard, c’est tout d’abord en raison de sa rareté. Son exécution encore imparfaite, visible notamment par son bullage assez conséquent, semble indiquer qu’il a fait partie d’une série qui a été des plus réduite. L’autre raison est que son attribution à Guimard n’est pas évidente au premier regard. Il est même probable qu’en l’absence de signature[4] et malgré son décor naturaliste abstrait, ce vase n’aurait pas sans doute pas suscité le même intérêt de notre part, ni les recherches qui en ont découlé pour retrouver les rares indices permettant de le localiser au sein de l’œuvre de Guimard. En même temps qu’il a eu la volonté de simplifier le Style Guimard en le résumant à un simple décor sur un objet pouvant s’accommoder finalement de tous les styles d’intérieurs, il est tout à fait probable que Guimard ait aussi fait le choix d’une forme de vase déjà existante à la Cristallerie de Pantin — forme qui n’était d’ailleurs pas nécessairement déjà commercialisée — et qu’il l’ait « guimardisée », reproduisant en cela la même démarche qu’avec les produits de certains autres fabricants comme nous l’avons démontré pour les vases en grès édités par Gilardoni & Brault[5].
Frédéric Descouturelle et Olivier Pons,
avec l’aide de Justine Posalski et de Georges Barbier-Ludwig.
Notes
[1] La cristallerie a été fondée en 1847, au 84 de la rue de Paris à Pantin et reprise en 1859 par E. Monot, ancien ouvrier de la cristallerie de Lyon. Elle a rapidement prospéré, devenant la cinquième cristallerie française puis, après la guerre de 1870 (et le passage de la cristallerie de Saint-Louis en territoire allemand), la troisième (après Baccarat et Clichy). La cristallerie usinait industriellement une gamme complète de produits qu’elle exposait dans son magasin parisien de la rue de Paradis. Son dépôt était également à Paris, au 66 rue d’Hauteville. La raison sociale a évolué : « Monot et Cie », puis « Monot Père et Fils et Stumpf », puis « Stumpf, Touvier, Viollet & Cie » après le retrait de Monot en 1889. Elle a été absorbée en 1919 par la verrerie Legras (Saint-Denis et Pantin Quatre-Chemins).
[2] Fondée par le critique d’art Julius Meier-Graefe à la fin de l’année 1899, cette galerie consacrée à l’art décoratif moderne entrait en concurrence avec celle plus connue de Siegfried Bing, L’Art Nouveau. Deux articles lui seront très prochainement consacrés par Bertrand Mothes.
[3] Pour d’autres produits, le catalogue indique le nom des auteurs des modèles. Dans ce cas, on peut penser que le contrat passé entre la galerie et l’auteur spécifiait que le nom de ce dernier devait être mentionné.
[4] Un autre exemplaire de ce vase a été répertorié et figure dans l’ouvrage « Le génie verrier de l’Europe » (G. Cappa, éd. Mardaga, 1998). Contrairement à notre vase à la couleur « aigue-marine » dominante, celui-ci se caractérise par un cristal incolore doublé de métallisations dégradées faisant davantage la part belle aux nuances « rosathea » et « jaune » tandis que la tonalité « aigue-marine » se concentre sur un petit tiers inférieur. Cet exemplaire ne présentant pas de signature, il est possible qu’il s’agisse d’un prototype.
[5] Cf. notre article sur la « guimardisation » des vases en grès édités par Gilardoni & Brault.

De quelle couleur étaient les verrines rouges des entourages de métro de Guimard ?
En raison de la circulation d’informations contradictoires, on nous presse de toute part de donner notre opinion sur ce point crucial. Nous nous exécutons bien volontiers, d’autant plus que nous avions négligé d’apporter des nuances à l’opinion par trop tranchée que nous avions émises dans les deux ouvrages parus en 2003 et 2012 et qui ont établi une étude sérieuse sur le métro de Guimard[1]. La découverte récente d’une photographie en couleurs prise dans les années 60 est venue à point pour conclure notre article.
Pour définir les pièces de verre de forme mouvementée qui terminent les candélabres des entourages découverts des accès du métro de Paris de Guimard, nous avons adopté le terme employé à l’époque par la CMP (Compagnie du Métropolitain de Paris), celui de « verrine », plutôt que celui de « globe » qui renvoie à une image de sphère[2]. En raison de la faible luminosité de leur ampoule électrique entièrement recouverte par la verrine, il s’agit bien d’une fonction de signalisation nocturne et non d’éclairage. Cette dernière fonction, qui n’avait pas été prévue par Guimard, puisqu’elle n’avait pas été demandée[3], a été progressivement assurée par des lampes non recouvertes installées par la CMP sur les édicules et sur certains entourages découverts. Les entourages des accès supplémentaires[4], qui servaient alors uniquement à la sortie, n’avaient ni signalisation lumineuse, ni éclairage.
Originellement, ces verrines étaient en verre. Pour une étude plus complète, nous renvoyons le lecteur à notre dossier Hector Guimard, Le Verre pp. 20 à 23, publié en format pdf, en 2009, et toujours accessible sur notre site. Nous en redonnons ci-après certains éléments.
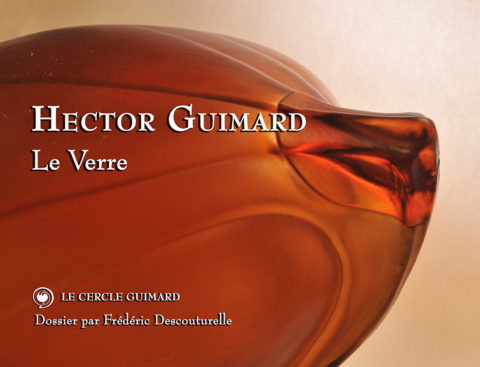
Nous connaissons le fournisseur de ces verrines grâce à quelques rares archives. La première est un document comptable de la CMP, du 12 septembre 1901, répertoriant les noms des différents fournisseurs et les frais engagés auprès de chacun d’entre eux pour le premier chantier de Guimard, c’est-à-dire la construction des accès en surface de la ligne 1 et de deux tronçons supplémentaires des futures lignes 2 et 6. Intitulé « Travaux des édicules/M. Guimard Architecte », ce document répertorie en fait les frais engagés à la fois pour les édicules et pour les entourages découverts. À l’avant-dernière ligne du document, on trouve : « Stumpf, Verrines […] 900 ».
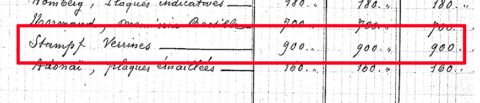
Détail d’un décompte des dépenses des accès de surface du premier chantier du métro de Paris. Document RATP.
Cette entreprise, plus connue sous le nom de « Cristallerie de Pantin », s’appelle alors Stumpf, Touvier, Viollet et Cie depuis 1888. Elle a été fondée à La Villette en 1851 par E. S. Monot puis transférée en 1855 à Pantin. Elle a rapidement prospéré, devenant, après la guerre de 1870 (et le passage de la cristallerie de Saint-Louis en territoire allemand), la troisième cristallerie française (après Baccarat et Clichy). Elle sera absorbée en 1919 par la verrerie Legras (Saint-Denis et Pantin Quatre-Chemins).
Le montant de 900 F-or correspond à 30 verrines à 30 F-or pièce, soit 13 paires de verrines pour les 13 entourages découverts du premier chantier, plus 4 pièces supplémentaires en cas de bris. Ce prix à l’unité est confirmé par un autre document comptable de la CMP concernant la ligne 2, non daté, établissant à 60 F-or le prix des deux verrines de chacun des entourages du tronçon allant des stations Villiers à Ménilmontant. Il y est bien précisé que ce prix est identique à celui fixé pour les entourages du premier chantier. Cet engagement de la Cristallerie de Pantin auprès de Guimard et de la CMP sur le maintien du prix des verrines pour les entourages de la ligne 2 fait également l’objet de trois documents (un manuscrit et deux dactylographiés) de novembre 1901 à janvier 1903.
Il y a eu 103 entourages Guimard sur le réseau et donc un nombre double de verrines mises en place sur leurs candélabres. Elles étaient encore en place en 1960 au moment du tournage du film de Louis Malle Zazie dans le métro d’après le roman de Raymond Queneau.

Catherine Demongeot pour Zazie dans le Métro en 1960, photo promotionnelle ou photo de plateau pour une scène non incluse dans le film. Les verrines présentent à leur pointe le bouchon caractéristique des modèles en verre. Coll. part.
Les prêts précoces (ensuite transformés en dons) d’entourages Guimard, complets ou non, ont permis la préservation de leurs verrines. C’est ainsi que le portique de l’entourage découvert de la station Raspail, installé en 1906, est entré en 1958 au Museum of Modern Art de New York. Il en est de même pour l’entourage de la station Bolivar, installé en 1911 et entré en 1960 dans les collections du Staatliches Museum für Angewandte Kunst à Munich (non exposé).

Portique de l’entourage découvert de la station Raspail au Museum of Modern Art de New York. Le portique comprend des verrines en verre rouge. Droits réservés.
Le musée national d’art moderne de Paris a lui aussi obtenu en 1961 un entourage complet, l’un des deux de la station Montparnasse (installés en 1910). Reversé au musée d’Orsay, il est visible à l’occasion d’expositions thématiques.

Portique d’entourage découvert du musée d’Orsay, prêt (puis don) de la RATP en 1961 au musée national d’Art Moderne de Paris, provenant de la station Montparnasse (1910) à l’exception de l’enseigne en lave émaillée (avant 1903). Les verrines sont en verre. Photo D. Magdelaine.
Peu après, en 1966, la RATP a fait don d’un entourage Guimard complet (sans porte-enseigne) à la compagnie de métro de Montréal. Cet entourage de sept modules en longueur et cinq en largeur a été composé à partir d’éléments puisés dans les réserves et résultant des démontages de certains accès. Il comprenait deux verrines en verre.

L’entourage découvert Guimard destiné à la station Victoria du métro de Montréal, entreposé avant son expédition en 1966. Photo RATP.
C’est donc plus tard, à une date qu’il est encore difficile de préciser, que la RATP a remplacé les verrines en verre par des équivalents en matériau de synthèse, de couleur rouge, moins chers, moins fragiles, mais bien moins beaux. Cependant, symptôme du long désintérêt de la RATP pour cette période de son histoire, les verrines qui avaient ainsi pu être récupérées lors de ces échanges ont par la suite mystérieusement disparu de ses réserves, si bien qu’elle n’en possédait plus une seule à la fin du XXe siècle.
Par chance, à l’occasion des travaux de restauration de l’accès de la station Victoria à Montréal, la compagnie de métro STP a eu la sagesse de remplacer elle aussi ses verrines en verre, déjà un peu endommagées, et d’en redonner une à la RATP en 2003[5]. Il s’agissait de la première verrine que nous avions l’occasion d’examiner de près, admirant la netteté de ses lignes, l’aspect satiné de sa surface et sa couleur qui varie en fonction de son éclairage et de l’épaisseur du verre, allant du rouge sombre à l’orange clair.

Verrine en verre d’un entourage découvert de Guimard, provenant de l’entourage découvert offert en 1966 à Montréal et redonnée à la RATP en 2003. Photo F. D.
Nous avons aussi eu connaissance de l’existence de verrines en verre[6], également rouges, sur une copie d’entourage Guimard en bronze se trouvant aux États-Unis. Cette présence inattendue, attestée par un rapport d’état[7] rédigé en 2002, confirme l’existence d’une filière de sorties frauduleuses de pièces du métro de Guimard vers les États-Unis.

Copie d’entourage en bronze disposé autour d’un bassin à Houston dans les années 2000. Photo Artcurial.
Pour la fourniture des verres spéciaux destinés aux vitres et aux toitures des édicules et des pavillons, nous disposons du contrat liant la CMP, la Compagnie de Saint-Gobain et le verrier Charles Champigneulle. Ce contrat précise bien la couleur des verres prescrits. En revanche, pour la fourniture des verrines, nous n’avons pas trace d’un contrat initial qui nous aurait sans doute permis de connaître la couleur originellement envisagée par Guimard. Au vu de la couleur des verrines en verre connues, toutes rouge orangé, nous avions logiquement pensé qu’elles l’étaient toutes. Cette opinion était confortée par le fait que sur certains clichés anciens en noir et blanc, en tenant compte du reflet de la lumière, les verrines semblent bien être foncées, ce qui est compatible avec une couleur rouge.

Entourage découvert de la station Rome, mis en place en 1902. Photo Charles Maindron (1861-1940) photographe de la CMP. Tirage au gélatino-chlorure d’argent développé le 5 juin 1903. École Nationale des Ponts et Chaussées, Direction de la documentation, des archives et du patrimoine.
Cependant cette opinion a été remise en cause par plusieurs faits.
Le premier, auquel nous aurions dû prêter une plus grande attention, est le cliché autochrome (donnant donc les couleurs réelles) de la station Porte d’Auteuil daté du premier mai 1920 et conservé dans la collection du musée départemental Albert-Kahn. Nous n’avions pas pu reproduire ce cliché dans le livre Guimard, L’Art nouveau du métro en raison de l’opposition du musée à sa publication. Depuis, ayant été inclus dans une exposition, il a été rephotographié par des visiteurs et se trouve ainsi accessible à tous grâce à Wikipédia.

Entourage découvert de la station Porte d’Auteuil. Photo Heinrich Stürzl, d’après une plaque autochrome de Frédéric Gadmer, cliché pris le 1er mai 1920. Collection musée départemental Albert-Kahn (inv. A 21 126). Source Wikimedia Commons.
On voit clairement sur ce cliché que les verrines ne sont pas rouges mais blanches. Pour l’instant et à notre connaissance, nous ne disposons pas d’autres clichés autochromes d’époque. À notre sens, les cartes postales colorisées telles que celles de la série « Le Style Guimard » éditées en 1903 à l’initiative d’Hector Guimard, ne peuvent servir de référence fiable puisque le procédé consiste, à partir d’un cliché en noir et blanc, à en atténuer le contraste et à y superposer des aplats de couleurs transparents qui, s’ils sont souvent vraisemblables, sont parfois différents de la réalité.

Carte postale ancienne « Le Style Guimard » publiée en 1903. Coll. part.
Ensuite, l’existence d’un entrefilet paru en 1907 dans le quotidien conservateur Le Gaulois remet définitivement en cause cette certitude d’une exclusivité de la couleur rouge des verrines. Cet article de presse nous avait échappé en 2003 et en 2012. Nous devons sa découverte à un auteur dont nous ne citerons pas le nom.
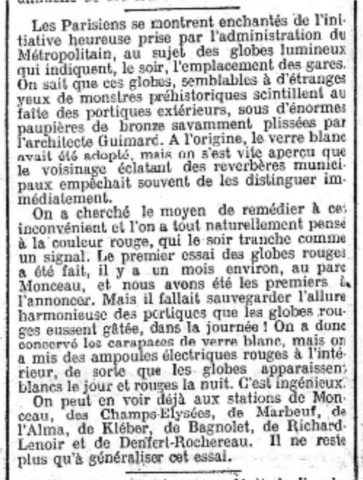
Anonyme, « Échos de partout », Le Gaulois, 18 septembre 1907.
Cet article donne tout d’abord la raison pour laquelle la couleur rouge a été préférée à la blanche : une signalisation nocturne plus efficace. Il semble aussi régler la question de la mutation en établissant qu’en août 1907 la CMP a procédé à un essai de verrines rouges sur l’entourage découvert de la station Monceau (ligne 2) et qu’un mois plus tard, en septembre 1907, sept stations supplémentaires en étaient pourvues. Dans le même temps, sur les autres entourages de Guimard, la CMP avait obtenu une couleur rouge en plaçant des ampoules rouges dans les verrines blanches. Notons au passage que l’auteur justifie cette mesure provisoire par la « [sauvegarde] de l’allure harmonieuse des portiques que les globes rouges eussent gâtés, dans la journée ». Cette justification est d’autant plus étrange que le rouge, agissant comme une couleur complémentaire du vert des fontes, est plus satisfaisant à l’œil que le blanc. Le journaliste aurait-il recopié un « élément de langage » communiqué par la CMP ?
En 1907, les verrines rouges étaient donc destinées à remplacer progressivement les blanches. Et pourtant, il est fort probable que l’entourage de la station Rome, photographié de façon certaine en 1903, comportait déjà des verrines rouges comme on le voit sur cet agrandissement du cliché de Charles Maindron (cf. plus haut).
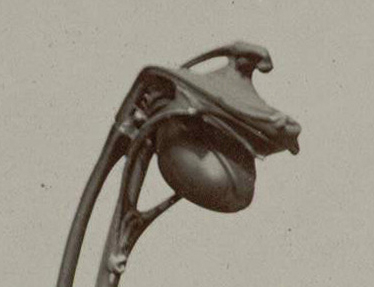
Entourage découvert de la station Rome (détail), mis en place en 1902. Photo Charles Maindron (1861-1940) photographe de la CMP. Tirage au gélatino-chlorure d’argent développé le 5 juin 1903. École Nationale des Ponts et Chaussées, Direction de la documentation, des archives et du patrimoine.
Et au contraire, ce sont bien des verrines blanches qui apparaissent sur la plaque autochrome de l’entourage de Porte d’Auteuil (cf. plus haut). Dans ce cas, il s’agit pourtant des tout derniers entourages Guimard à avoir été posé par la CMP, sur la ligne 10 en 1913[8]. Il aurait donc logiquement dû recevoir des verrines rouges. Mais à un moment où il était sans doute question d’abandonner définitivement la mise en place d’accès Guimard, il est probable que ce sont des verrines blanches provenant des échanges antérieurs qui ont été utilisées.
Pour conclure cette petite étude, nous avons enfin eu l’occasion de découvrir l’image d’une verrine blanche grâce au fonds photographique que notre ami Laurent Sully Jaulmes a légué au Cercle Guimard. Elle n’est qu’un détail d’un cliché très étonnant pris en Allemagne en 1967 et sur lequel nous reviendrons un jour. La verrine était à cette occasion utilisée comme lustre.
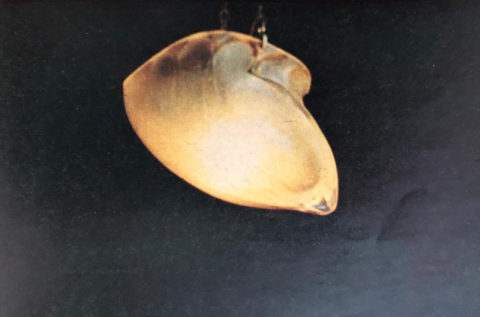
Verrine blanche utilisée comme lustre. Photo Laurent Sully Jaulmes (détail), 1967. Centre d’archives et de documentation du Cercle Guimard.
Nous ne désespérons donc pas de voir arriver sur le marché de l’art dans les prochaines années des verrines en verre car nous ne pouvons pas croire que la quasi intégralité de celles qui ont été originellement mises en place ont été détruites par la suite. Au contraire, un nombre suffisant d’entre elles doit encore être stocké chez des particuliers. Avec le renouvellement des générations, elles vont immanquablement ressurgir, ce qui nous permettra sans doute d’admirer de plus près ces magnifiques vaisseaux de verre, qu’ils soient rouges ou blancs.
Frédéric Descouturelle
Notes
[1] Descouturelle Frédéric, Mignard André, Rodriguez Michel, Le Métropolitain de Guimard, éditions Somogy, 2003 ; Descouturelle Frédéric, Mignard André, Rodriguez Michel, Guimard, L’Art nouveau du métro, éditions de La Vie du Rail, 2012.
[2] Un des premiers dessins d’entourage à fond arrondi, le projet n° 2, non validé par les autorités, montrait des verrines de forme globulaire, enserrées dans une mâchoire de fonte, cf. notre article Un porte-enseigne défaillant sur les entourages découverts du métro.
[3] Pour les entourages découverts, le concours de 1899 (auquel Guimard n’avait pas participé) prescrivait la présence d’un poteau indicateur, sans faire mention d’une source lumineuse. Cependant, la plupart des candidats en avait intégré une à leur proposition.
[4] Entourages bas à cartouches implantés sur le réseau à partir de 1903-1904.
[5] L’autre verrine a été confiée au Musée des beaux-arts de Montréal.
[6] L’une des verrines est alors remisée et remplacée par un équivalent en matériau de synthèse.
[7] Ce constat d’état, effectué chez le propriétaire de la copie d’entourage à Houston, a été rédigé le 27 juin 2002 et signé par Steven L. Pine, decorative arts conservator attaché au musée des Beaux-Arts de Houston, spécialiste de la conservation des métaux. Il fait référence à un précédent constat du l6 juin 1999.
[8] Il partageait d’ailleurs avec l’entourage de la station Chardon-Lagache une singularité dans l’accrochage des écussons, signe, peut-être, d’un changement dans les équipes de montage.

Les visites du mois de novembre
Le Cercle Guimard vous propose deux nouvelles visites guidées et commentées dont un parcours inédit pour ce mois de novembre 2023 :
« Hector Guimard, architecte d’art »
Le samedi 25 novembre à 10h

Le Castel Béranger (1895-1898), façade sur la rue Jean-de-La-Fontaine et angle avec le hameau Béranger, photographie de André Mignard.
&
« Paris et l’architecture du commerce : des galeries aux grands magasins »
Le dimanche 26 novembre à 10h

Coupole des Galeries Lafayette, Jacques Gruber, 1912, photographie de Maréva Briaud.
Les visites guidées sont au tarif unique de 20 euros par personne.
Pour réserver :
Merci de cliquer sur l’horaire qui vous convient :

Nancy-Paris, Paris-Nancy -1
Après avoir évoqué l’exposition Vallin qui s’est tenue à la villa La Garenne à Liverdun pendant l’été 2022, nous débutons une série de trois articles montrant quelques influences réciproques entre les artistes de l’École de Nancy et ceux de l’Art nouveau parisien, en nous concentrant sur l’architecture.
L’histoire des interactions entre le style naturaliste de l’École de Nancy et les styles plus linéaires de l’Art nouveau parisien et de l’Art nouveau belge a déjà été en grande partie étudiée[1]. Elle est faite d’allers-et-retours entre les angles de ce triangle isocèle, angles distants de 320 km. Si les bruxellois ont eu l’initiative en matière d’architecture, il est exact que les nancéiens se sont précocement illustrés dans les arts décoratifs par la qualité et le volume de leur production. Les relations entre ces trois foyers de création étaient cependant dissymétriques, reproduisant aussi la force économique et politique de chacun de ces pôles, car si la réussite locale était possible à Nancy et plus encore à Bruxelles, la reconnaissance et le passage à une dimension financière supérieure passait alors par Paris. Le bruxellois Henry Van de Velde et les nancéiens Émile Gallé et Louis Majorelle l’avaient parfaitement compris puisqu’ils s’y étaient implantés aussi rapidement qu’ils l’avaient pu. Si la greffe n’a pas pris pour Van de Velde, contraint de s’exiler en Allemagne, elle a réussi sur le plan commercial pour Gallé, aidé par ses relations mondaines et littéraires avec le milieu intellectuel parisien et plus encore pour Majorelle grâce à ses relations amicales et professionnelles nouées lors de son passage à l’École des Beaux-Arts de Paris. C’est également à l’ENBA de Paris qu’ont été formés les nancéiens Victor Prouvé et Jacques Gruber, avant qu’ils ne s’illustrent dans le domaine de l’art décoratif. Quant à Camille Gauthier, l’un des plus brillants représentants de la seconde génération de l’École de Nancy, il a été élève de l’École nationale des arts décoratifs à Paris à partir de 1891 avant d’être embauché chez Majorelle en 1893. La question de cette formation professionnelle était d’ailleurs âprement débattue à Nancy, où malgré la transformation progressive, mais fort lente, d’une école municipale de dessin en une véritable école des beaux-arts, la nouvelle génération des architectes nancéiens, celle qui a été active dans les années 1900, s’est faite à l’École nationale des Beaux-Arts de Paris où elle a bien souvent conservé des relations. Ces architectes en retiraient un prestige que n’avaient pas leurs devanciers, formés au sein des cabinets d’architectes installés et à l’École Professionnelle de l’Est.
L’influence nancéienne chez Guimard
Connu à Paris à partir de l’Exposition universelle de 1878, célèbre à partir de l’exposition La Pierre, le Bois, la Terre, le Verre organisée par l’Union Centrale des Arts décoratifs en 1884, et enfin sacré à l’Exposition Universelle de 1889, Émile Gallé a largement contribué à une utilisation renouvelée de la plante par les arts décoratifs. Il faut en partie mettre au crédit de cette influence les nombreuses représentations florales que l’on va ensuite trouver dans l’Art nouveau parisien, par exemple chez Lalique, mais aussi, et de façon presque inattendue, dans la première partie de la carrière d’Hector Guimard. Jusqu’en 1895, ce dernier pratiquait un style encore éclectique mais si reconnaissable et novateur que l’on peut le qualifier de proto-Art nouveau. On le retrouve en particulier dans ses créations de panneaux de céramique architecturale et on se référera pour cela au troisième et quatrième articles de notre série sur l’entreprise de céramique Muller.

Tympan de la fenêtre du 2ème étage de la façade droite de l’hôtel Jassedé de Guimard, 41 rue Chardon-Lagache à Paris, 1893. Deux panneaux cloisonnés en faïence émaillée. Photo F.D.
Si l’impulsion stylistique venait bien de Nancy, on assiste ici à un retraitement complet de la composition de ces panneaux, qui s’éloigne de l’utilisation descriptive de la botanique qu’en faisait Émile Gallé. Au contraire, Guimard est parvenu en très peu de temps à opérer des stylisations parfaitement maîtrisées de motifs floraux qui n’avaient rien à envier à ceux qui ont été présentés un peu plus tard en 1897 dans le portfolio La Plante et ses applications ornementales d’Eugène Grasset et de ses élèves. L’empreinte nancéienne la plus visible sur une œuvre de Guimard se trouve sur les fontes ornementales de l’école du Sacré-Cœur, 9 avenue de la Frillière, Paris XVIe, en 1895. Les chapiteaux des colonnettes divisant en trois les grandes baies du premier étage ont un motif très reconnaissable de feuille et de fleur du chardon, une plante qui n’a pas de lien direct avec l’iconographie du cœur sacré de Jésus.

Chapiteau des colonnettes en fonte de fabricant inconnu soutenant le linteau des fenêtres du premier étage de l’École du Sacré-Cœur, 9 avenue de la Frillière à Paris, 1895. Photo F.D.
Or cette plante n’est autre que l’emblème de la ville de Nancy depuis le XVe siècle, figurant sur son blason en compagnie de la devise non inultus premor. Elle est ainsi devenue un motif naturaliste d’identification que les nancéiens ont abondamment et continuellement utilisé dans toutes les branches de l’art décoratif.

Grande broche au chardon en argent par Ferdinand Kauffer, modèle créé vers 1886. Phototypie parue dans La Lorraine Artiste en 1894, reproduit dans Martin, Étienne, Bijoux Art nouveau Nancy 1890-1920, éditions du quotidien, 2015.

Projet pour le portique d’entrée de l’École de Nancy à l’exposition d’art décoratif de Turin en 1902 (non réalisé) par Émile André. Dessin aquarellé, Musée de l’École de Nancy.
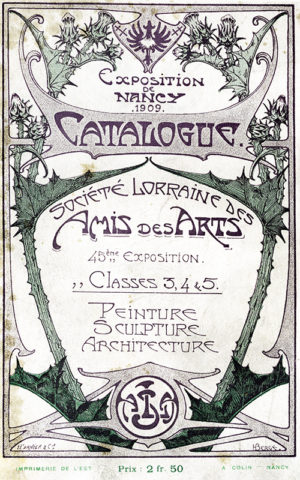
Catalogue de l’exposition de la SLAA à l’Exposition Internationale de l’Est de la France en 1909, dessin par Henri Bergé. Coll. part.
Plus intéressants encore, les piliers inclinés en fonte, qui soutiennent le premier étage de l’école du Sacré-Cœur, ont été décorés par des motifs qui ne sont plus cette fois descriptifs mais qui évoquent très clairement le bourgeon et l’indentation des feuilles du chardon.

Pilier en fonte de fabricant inconnu soutenant le linteau du préau de l’École du Sacré-Cœur, 9 avenue de la Frillière à Paris, 1895. Photo F.D.
Dès sa période à proprement parler Art nouveau, celle qui débute en 1895 avec le Castel Béranger, Guimard a abandonné la représentation naturaliste et botanique pour n’en garder que l’esprit. Il a ainsi adhéré à l’esthétique prônée par le bruxellois Victor Horta, tout en inventant — et en réinventant constamment — son propre style, bientôt copié par une foule de suiveurs. Pourtant, Guimard n’a pas totalement banni la plante de sa création. Elle a pu ressurgir ponctuellement, mais toujours sous une forme non identifiable botaniquement. On retrouve ainsi des indentations appliquées à la base des piliers postérieurs des édicules A (1900)[2].

Pilier arrière de l’édicule A à claire-voie de la station Abbesses. Photo F.D.
Des feuilles et des fruits sculptés sur le linteau de la porte d’entrée du 43 rue Gros (1909-1911).
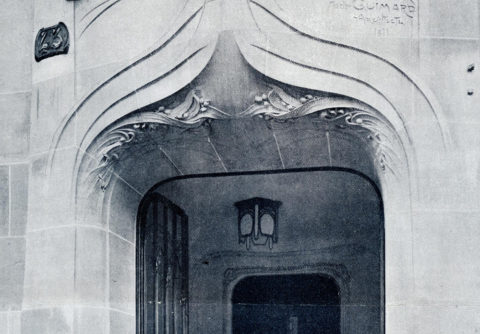
Porte d’entrée de l’immeuble du 43 rue Gros à Paris par Guimard (1909-1911). La Construction Moderne, 9 février 1913. Coll. part.
Le plafonnier du vestibule est visible sur la photo précédente. Il fait partie des Lustres Lumière créés par Guimard à partir de 1909. Sur ses plaques en bronze, on voit aussi des feuilles ou des brins d’herbe entrecroisés.

Élément en bronze des lustres Lumière. Photo F.D.
Plus tard, en 1922, sur les piédroits de la sépulture Grunwaldt, au cimetière nouveau de Neuilly-sur-Seine, le décor sculpté mêle les branches de laurier et de palme, deux espèces communes au répertoire des cimetières. Avec ces deux plantes qui sont également utilisées dans le décor rapporté de ce petit monument, il s’agit de symboliser la gloire du défunt.

Décor végétal sculpté sur un piédroit de la sépulture Grunwald, 1922. Photo F.D.
L’influence de l’Art nouveau parisien et de Guimard à Nancy
Pour sa part, Guimard n’a jamais rien construit, ni décoré à Nancy. Plus encore, à ce jour aucune archive ne nous permet même de dire qu’il a visité la ville et cependant son influence sur place est bien réelle. Elle s’est réalisée par l’intermédiaire de confrères architectes parisiens qui ont su composer avec le naturalisme en vogue à Nancy. Le premier d’entre eux est bien sûr son ami Henri Sauvage qui a construit à Nancy la villa du fabricant de mobilier Louis Majorelle. Ce choix d’un jeune architecte parisien, alors inexpérimenté, est tout à fait significatif, tant Majorelle a été à la fois une tête de pont du style nancéien à Paris et une tête de pont du style parisien à Nancy. Émule de Gallé dans le domaine de l’ébénisterie à partir de 1895, il n’a donné à son style une dimension véritablement personnelle que peu de temps avant L’Exposition Universelle de 1900 en se rapprochant du style parisien. Cette orientation a sans doute d’ailleurs été favorisée par le travail du jeune Camille Gauthier, formé à l’École nationale des arts décoratifs et embauché chez Majorelle de 1893 à 1900. Elle a aussi été inspirée par certains modèles parisiens comme cette coiffeuse de Charles Plumet et Tony Selmersheim, dont les pieds se dédoublent pour venir soutenir une console.
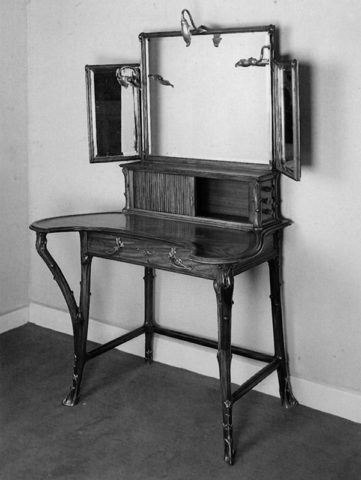
Coiffeuse par Charles Plumet et Tony Selmersheim, 1898. Musée de l’École de Nancy. Photographie extraite de l’ouvrage Majorelle par Roselyne Bouvier. La Bibliothèque des arts, 1997. Photo A. Fellmann.
Cette disposition des pieds, pourvus d’épines sur la coiffeuse Plumet /Selmersheim (et donc clairement désignés comme des tiges végétales à la façon des nancéiens) a largement été reprise un peu plus tard sur une partie du mobilier présenté par Majorelle à l’Exposition Universelle de 1900. Ses meubles présentaient alors une ligne dynamique plus continue (plus « parisienne ») soulignée par une tige de nénuphar en bronze doré.

Bureau aux nénuphars par Majorelle. Exposition Universelle de Paris en 1900. Portfolio Meubles de style moderne Exposition Universelle de 1900, Charles Schmid éditeur. Coll. part.
Majorelle a également collaboré avec le parisien Henri Sauvage en 1898 pour trois salons du Café de Paris (41 avenue de l’Opéra).

Plafond de l’un des trois salons meublés et décorés par Louis Majorelle au Café de Paris en 1898. Portfolio allemand Modern Bautishler-Arbeiten, pl. 53, août 1902.

Cheminée de l’un des trois salons meublés et décorés par Louis Majorelle au Café de Paris en 1898. Portfolio allemand Modern Bautishler-Arbeiten, pl. 53, août 1902.
Cette réalisation parisienne de Majorelle a préludé à la construction de sa villa à Nancy conçue par le même architecte en 1901-1902 avec l’intervention de deux autres parisiens : le céramiste Alexandre Bigot et le jeune peintre Francis Jourdain, fils de l’architecte Frantz Jourdain, autre ami d’Hector Guimard.

Façade Nord de la villa Majorelle à Nancy, extrait de l’article de Frantz Jourdain dans L’Art décoratif, août 1902. Bibliothèque numérique limédia.
Il est facile de reconnaitre dans cette façade Nord de la villa Majorelle une nette influence de la façade postérieure de la villa Berthe construite par Guimard au Vésinet en 1896.
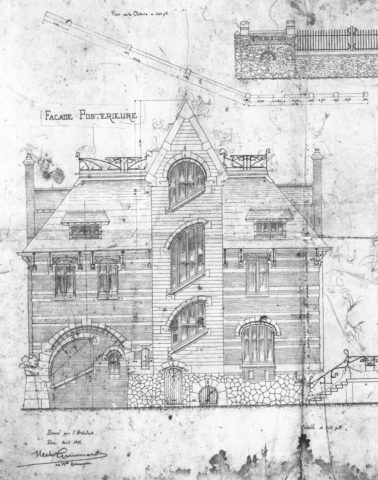
Plan de la façade postérieure de la villa Berthe au Vésinet, daté avril 1896.
Un autre architecte parisien, Jacques-René Hermant est intervenu relativement précocement à Nancy pour y construire la maison Victor Luc en 1901-1902.

Maison Victor Luc, 25 rue de Malzéville à Nancy, par Jacques-René Hermant, 1901-1902. Portfolio Nouvelles Constructions de Nancy, pl. XXV. Coll. part.
Sa façade symétriquement ordonnée en travées et niveaux recèle de beaux détails comme les chapiteaux des colonnes du porche, les céramiques de la corniche et les ferronneries aux courbes linéaires. À l’intérieur, une rampe d’escalier en grès émaillé de Gentil & Bourdet est l’une des réalisations les plus remarquables de cette entreprise parisienne dont l’un des protagonistes, François Eugène Bourdet, est un jeune architecte originaire de Nancy.

Maison Victor Luc, 25 rue de Malzéville à Nancy, par Jacques-René Hermant, 1901-1902. Détail du porche. Photo Nicholas Christodoulidis.
Ces deux dernières demeures ont influencé les architectes nancéiens et la Villa Majorelle est même devenue un des moteurs de l’architecture moderne nancéienne. Mais parallèlement à cette tendance parisienne, un autre courant, d’inspiration plus locale, était emmené par le tandem Vallin-Biet qui venait d’achever l’immeuble Biet. Pour cette tendance locale, la filiation avec le Moyen-âge et la Renaissance était aussi présente, mais la structure des bâtiments se voulait plus unitaire et plus organique. Comme nous le verrons dans un prochain article, Guimard et Vallin ont pu — séparément — exploiter certains thèmes comme la représentation de la déformation de la matière.
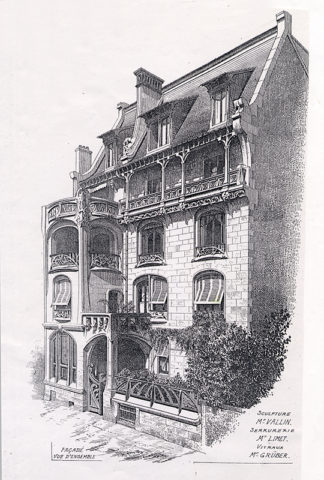
Immeuble Biet, 22 rue de la Commanderie à Nancy, 1901-1902. Portfolio Motifs d’architecture moderne, non daté (vers 1905). Coll. part.
Beaucoup d’architectes nancéiens, comme Émile André et Lucien Weissenburger ont ensuite prélevé des détails décoratifs dans l’une et l’autre des deux constructions. Sur la maison Houot ou sur la villa Fernbach d’Émile André, les appuis de fenêtres sont empruntés à la villa Majorelle de Sauvage.

Appui de fenêtre de la villa Majorelle à Nancy par Henri Sauvage, 1901-1902. Photo F.D.

Appui de fenêtre de la maison Houot, 92 bis quai de la Bataille à Nancy par Émile André, 1903. Portfolio Nouvelles Constructions de Nancy, pl. XXV. Coll. part.
Le même architecte, Émile André, a emprunté les péristyles des balcons des troisièmes étages de ses immeubles au 69 et 71 avenue Foch à Nancy à un autre architecte parisien précurseur du style Art nouveau : Charles Plumet.

Immeubles Lombard (à gauche) au 69 avenue Foch à Nancy (1902-1903) et France-Lanord (à droite) au 71 avenue Foch à Nancy (1902-1904), Émile André. Photo F.D.
Plumet avait développé ces péristyles sur plusieurs de ses immeubles parisiens à partir de 1897 (36 rue de Tocqueville) et les avait réutilisés à de nombreuses reprises.
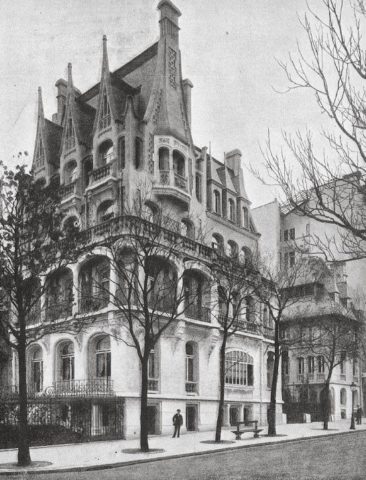
Hôtel particulier par Charles Plumet, à l’angle du 28 avenue Foch et du 90 avenue Malakoff à Paris, vue du côté de l’avenue Malakoff, 1900. Photo parue dans la revue allemande Die Architektur des XX. Jahrhunderts. Coll. part.
Toujours dans la villa Majorelle, le bâti des portes du rez-de-chaussée, vitrées sur les deux tiers de la hauteur, présente un intérêt particulier. À la base de la partie vitrée, un petit bois se détache obliquement de chaque montant latéral puis se verticalise et rejoint la traverse supérieure, évoquant un rejet né d’un tronc. De plus, cette partie vitrée est recoupée en partie supérieure par une simple ligne horizontale.

Porte de la salle à manger de la villa Majorelle par Henri Sauvage. Photo F.D.
Louis Majorelle a repris cette disposition sur une série de vitrines avec ou sans adjonction de décor naturaliste.
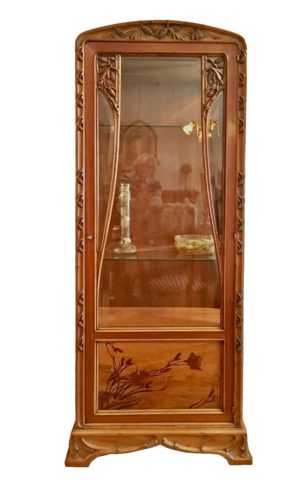
Louis Majorelle, vitrine aux pommes de pin, modèle n° 244, hauteur 1 m 90, vendu 900 F-or en 1914. Photo site internet Anticstore, Galerie Vaudémont, Nancy. Tous droits réservés.
Or cette disposition est directement reprise sur les portes de plusieurs vitrines de Guimard dont la plus ancienne est reproduite dans un article de Frantz Jourdain publié dans le premier numéro de la Revue d’Art (dont Guimard avait dessiné la couverture) en novembre 1899.

Petite table et vitrine par Guimard photographiées au Castel Béranger. Cliché paru dans la Revue d’Art n° 1 en novembre 1899.
Cette porte est plus visible sur cette vitrine plus tardive qui figurait dans l’hôtel Guimard.

Vitrine par Guimard ayant figuré dans l’hôtel Guimard 122 avenue Mozart. Coll. part.
D’autres influences du travail de Guimard existent à Nancy, même si elles ne sont pas en très grand nombre. Elles se sont plutôt faites par la publication de ses œuvres dans les revues ainsi que par le biais des voyages des nancéiens à Paris. C’est sans doute par l’un ou l’autre moyen que Joseph Hornecker, jeune architecte alsacien arrivé à Nancy à 1901 et associé à Henri Gutton a pu s’inspirer du Castel Henriette à Sèvres pour la Villa Marguerite, construite au parc de Saurupt à Nancy en 1904.
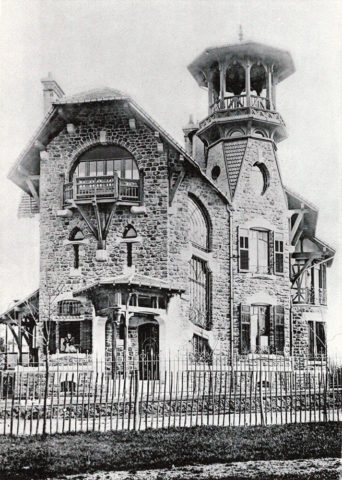
Villa Marguerite dans le parc de Saurupt. Portfolio Nouvelles constructions de Nancy. Coll. part.
En se promenant dans les rues de Nancy, on retrouve aussi des fontes ornementales de Guimard aux fenêtres d’une petite quinzaine de maisons ou d’immeubles dont une bonne part est due à l’architecte Lavocat. Mais il s’agit de commandes effectuées directement auprès de la fonderie de Saint-Dizier par un petit nombre d’architectes nancéiens avant la Première Guerre mondiale et donc sans intervention de Guimard.

Grand balcon GG et retour, immeuble 31 rue Anatole France à Nancy. Photo F.D.
Il n’est pas possible d’attribuer à l’influence du seul Guimard les nombreuses ferronneries de style linéaire que l’on peut aussi rencontrer à Nancy, comme celle de l’Immeuble Kempf, 40 Cours Léopold par Félicien et Fernand César (1903-1904), ou celles des maisons des 16 et 20 rue des Bégonias par Désiré Bourgon. Mais, outre la marquise de la villa La Garenne qui a fait l’objet d’un article précédent, il existe un exemple bien connu d’une transcription directe d’une œuvre de ferronnerie de Guimard : la porte du Castel Béranger copiée par le serrurier nancéien Lucien Collignon pour la porte de sa propre maison au 55 rue de Boudonville en 1905, soit huit ans après celle de Guimard.

Porte de la maison Collignon, 55 rue de Boudonville à Nancy. Photo tous droits réservés.
Plus anecdotique, sur le boulevard Lobau, le guichet et ses lettrages du bâtiment commercial du négociant en charbon Jules Kronberg sont aussi à mettre au crédit de l’influence qu’a eu le style de Guimard à Nancy. Cet « écart » est d’autant plus étonnant que Kronberg a été locataire et client de Vallin, domicilié presque en face.
Également dans le domaine de la ferronnerie, le jeune parisien Edgard Brandt (1880-1860) a eu une première période créative dans le style Art nouveau. En intervenant à Nancy, il a su s’adapter au style local. À la demande de l’architecte nancéien Joseph Hornecker, il a été chargé en 1907-1909 d’un important programme au nouveau siège de la banque SNCI (ferronneries extérieures, du hall et de la salle des coffres).

Hall de la banque nancéienne SNCI, architecte Joseph Hornecker, 1907-1909, ferronneries aux pommes de pin par Edgard Brandt.
Pour le même architecte nancéien et également en 1907, Brandt a exécuté la rampe de l’escalier d’honneur de la mairie d’Euville en Meuse. Ces deux réalisations, à la fois naturalistes (pommes de pin pour la SNCI) et symbolistes (chêne pour la mairie d’Euville) sont tout à fait dans le style nancéien et préludent à l’évolution progressive de Brandt vers un style moderne plus épuré puis vers l’Art déco.

Edgard Brandt, rampe aux feuilles et glands de chêne de la mairie d’Euville. Photo : Cédric Amey, sous licence Creative Commons.
En raison de la vigueur du foyer artistique nancéien, ces échanges stylistiques entre Nancy et Paris ne se sont donc pas faits au profit de la seule capitale et, comme nous le verrons dans un prochain article, le style nancéien a même opéré un vigoureux retour en force à Paris grâce aux grands magasins et en particulier à la puissante chaîne nancéienne des Magasins Réunis.
Frédéric Descouturelle
Merci à Fabrice Kunégel qui nous a signalé la similitude entre les menuiseries des portes intérieures de la villa Majorelle et celles de certaines vitrines de Guimard. Merci également à Koen Roelstraete pour ses recherches sur la vitrine aux pommes de pin de Majorelle.
Notes
[1] Grâce à de nombreux articles et à la passionnante exposition Paris-Bruxelles, Bruxelles-Paris de 1997 au musée d’Orsay et au musée des beaux-arts de Gand.
[2] Signalons pour la forme que les interprétations que nous pouvons donner des motifs de Guimard n’engagent que nous. Si nous pensons qu’elles peuvent être partagés par d’autres observateurs, nous ne voulons les imposer à personne. Comme nous l’avons écrit dans les livres consacrés en 2003 et 2012 au métro de Guimard, notre architecte n’a pas livré de notice explicative à son œuvre. Ses motifs semi-abstaits parlent à chacun de nous différemment en fonction de notre propre culture, voire de notre propre inconscient.
Comment commander ?
Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.
Recevoir les objets par colis
Prix du transport en sus.
Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».
Merci d'envoyer un message pour passer commande.
Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).
Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.
Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?
Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.
