Category: Hector Guimard

Guimard, briques après briques
Tout au long de sa carrière d’architecte, Guimard a porté attention aux variétés de briques disponibles sur le marché. Dans cet article nous donnerons un aperçu de leur utilisation qui pourra être prolongé par des études plus complètes portant sur les matériaux de construction auxquels il a eu recours pour ses bâtiments.
De façon très approximative, rappelons qu’au Nord de la Loire, dans les régions favorisées en pierre calcaire, la brique d’argile cuite a été peu employée jusqu’à la Renaissance, période pendant laquelle, à l’imitation des constructions italiennes, elle est devenue, malgré son coût de production, un matériau recherché servant même à l’édification de châteaux du XVIe au XVIIe siècle. Elle a vu son coût de production baisser du XVIIIe au XIXe siècle à la faveur de son industrialisation progressive. Dès lors, son utilisation croissante pour des constructions économiques a eu pour corollaire sa chute dans l’échelle de valeur des matériaux et sa relégation au statut de matériau pauvre. C’est contre cette tendance qu’à partir de la seconde partie du XIXe siècle, la brique a été progressivement remise à l’honneur grâce à une production plus soignée. Une variété de tons a été obtenue par la composition des pâtes plus ou moins riches en oxyde fer, ou par colorisation ou encore par l’émaillage de ses faces. Cet élargissement de l’offre de production accompagnait naturellement le mouvement en faveur de la polychromie des façades urbaines initiée par Jacques-Ignace Hittorff (1792-1867) puis par Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879).
La brique de terre cuite
Guimard, influencé par Viollet-le-Duc et soucieux à la fois d’originalité et d’économie, s’est donc largement servi de la brique dès ses premières villas construites avant le Castel Béranger dans le XVIe arrondissement ou dans la banlieue de l’Ouest parisien. Il a essentiellement utilisé des briques de couleur rose-orangée et rouge, parfois ponctuées de briques émaillées.

Hôtel Roszé, 1891, 34 rue Boileau, Paris XVIe, Photo F. D.

Hôtel Jassedé, 1891, 41 rue Chardon-Lagache, Paris XVIe, Photo F. D.
Elles alternent avec de la meulière et de la pierre de taille, plus rare, choisie pour certains éléments clés des façades : chapiteaux, sommiers, corniches, etc. Le tout donnant un mélange de teintes qui, joint aux céramiques particulièrement colorées, renforce l’aspect pittoresque de ces demeures.
L’hôtel Delfau, d’allure plus aristocratique, se singularise par une façade presque monochrome employant majoritairement une brique de couleur jaune paille qui se confond avec celle de la pierre de taille utilisée pour l’avant-corps et sa grande lucarne. Guimard a volontairement limité la brique rouge à de simples assises qui soulignent les corniches, de même qu’il a restreint au seul bleu la couleur des céramiques architecturales.

Hôtel Delfau, 1894, 1 ter rue Molitor, Paris XVIe, Photo F. D.
L’arrivée de l’Art nouveau en 1895 a peu modifié ce choix de matériaux. Un bâtiment économique comme l’École du Sacré-Cœur comportait simplement une quantité moindre de pierre de taille moins sculptée que sur le Castel Béranger. Pour le Castel Henriette, les moellons en opus incertum ont remplacé la pierre meulière.

École du Sacré-Cœur, 1895, 9 avenue de la Frillière, Paris XVIe, Photo F. D.

Étages supérieurs de la façade sur rue du Castel Béranger, 1895-1898, 14 rue Jean-de-La- Fontaine, Paris XVIe. Photo F. D.
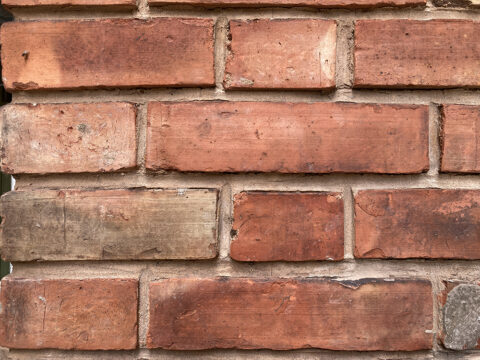
Détail de la façade sur cour du Castel Béranger, 1895-1898, 14 rue Jean-de-La-Fontaine, Paris XVIe. Photo F. D.
Généralement, les briques reçoivent sur l’une de leur panneresses (les faces longues et étroites) la marque de la briqueterie, imprimée en creux. Pour l’instant, nous n’avons relevé que le logo « CB » sur les briques de l’hôtel Roszé et celui de la briqueterie de Chambly (dans l’Oise) sur celles du Castel Val. Il est possible que dans la plupart des cas, Guimard ait donné pour consigne à l’entrepreneur de cacher les marques en exposant la panneresse opposée.

Détail de la façade sur rue de l’hôtel Roszé, 1891, 34 rue Boileau, Paris XVIe. Photo F. D.

Détail de la façade du Castel Val, Auvers-sur-Oise (Val d’Oise), 1902-1903. Photo F. D.
Pour la salle de concert Humbert de Romans (1898-1901), grâce au plan d’attachement conservé dans le fonds Guimard au musée d’Orsay, nous connaissons avec précision les types de briques employés pour la maçonnerie. Une brique de Sannois (blanche) de première qualité a été utilisée pour la façade principale et le patronage. Elle a été doublée par une brique de Belleville, également de première qualité.
Pour le Castel Béranger, sur de plus petites surfaces en façade sur rue et dans la cour, Guimard a aussi utilisé des briques en terre cuite émaillées, d’une couleur passant insensiblement du bleu clair au beige.

Détail de la façade sur cour du Castel Béranger, 1895-1898, 14 rue Jean-de-La-Fontaine, Paris XVIe, Photo F. D.
On peut penser qu’elles proviennent de la tuilerie Gilardoni & Brault car dans la liste des fournisseurs du Castel Béranger on trouve la mention de cette entreprise qui a par ailleurs fourni les céramiques émaillées artistiques posées en façade et certains rétrécissements de cheminées des appartements.
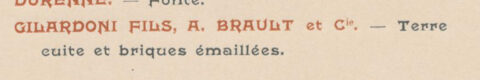
Hector Guimard, L’Art dans l’Habitation moderne/Le Castel Béranger (portfolio du Castel Béranger), liste des fournisseurs (détail), Librairie Rouam, 1898. Coll. Part.
On remarque que dans les tous cas où des briques de couleurs différentes ont été employées, Guimard n’a jamais créé de motifs alternant les couleurs comme on en voit sur quantités d’immeubles de cette époque, car ces dessins, nécessairement géométriques, auraient concurrencé ses propres décors. Pour créer des motifs courbes, il aurait fallu disposer de grandes surfaces planes et le résultat n’aurait pas forcément été heureux. Tout au plus s’est-il contenté de lits de couleurs différentes pour souligner des corniches ou pour simuler un sommier.

Détail de la façade sur la rue Lancret de l’immeuble Jassedé (1903-1905), Paris XVIe. Photo F. D.
Les appareillages employés sont peu nombreux. Il s’agit essentiellement de l’appareillage en panneresse et de l’appareillage à la flamande[1] qui fait alterner boutisses (la plus petite face) et panneresses sur chaque assise.
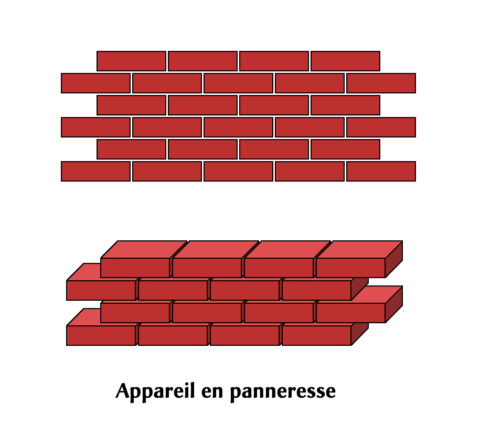 .
.
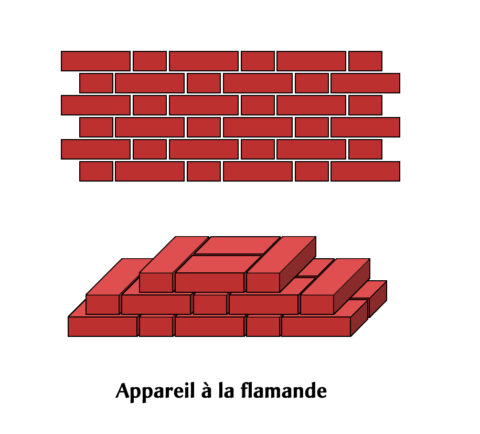
Appareils en panneresse et à la flamande. Dessins F. D.
Le petit calibre de la brique permet d’incurver aisément une paroi. Pourtant cette faculté n’a pas été tout de suite exploitée par Guimard qui, dans ses premiers bâtiments, s’en est tenu à des parois planes. Même quand il a cintré la travée centrale de la Villa Berthe au Vésinet (1895) ou l’oriel de La Bluette à Hermanville (1899), c’est à la pierre taillée — dont la mise en œuvre était plus coûteuse — qu’il a fait appel. Sans doute préférait-t-il alors que la surface plus douce de la pierre accompagne mieux le mouvement donné.

Façade principale de la Villa Berthe, Le Vésinet (Yvelines), 1896. Photo Nicolas Horiot.
Il faut attendre le Castel Henriette (1899) pour trouver quelques pans de briques cintrés. Pour la première fois, son plan a fait la part belle aux élévations courbes, mais ce sont alors essentiellement aux moellons en opus incertum qu’elles ont été confiées. Quelques années plus tard, le Castel Val à Auvers-sur-Oise (1902-1903) a été le plus bel exemple de façades cintrées utilisant la brique, un emploi que Guimard a réitéré peu après de façon plus discrète sur l’immeuble Jassedé, à l’angle de l’avenue de Versailles et de la rue Lancret (1903-1905).

Façade du premier étage du Castel Val, Auvers-sur-Oise (Val d’Oise), 1902-1903. Photo Nicolas Horiot.

Façade sur rue de l’immeuble Jassedé à l’angle de l’avenue de Versailles et de la rue Lancret, Paris XVIe, 1903-1905. Photo F. D.
La brique silico-calcaire
Vers 1904, Guimard a adopté la brique silico-calcaire. Ce matériau n’est pas obtenu par la cuisson d’une argile naturelle ou recomposée : il s’agit d’une pierre artificielle s’apparentant au ciment.

Briques silico-calcaires en appareillage à la flamande de la façade sur rue de l’hôtel Mezzara, 60 rue Jean-de-La-Fontaine, Paris XVIe, Photo F. D.
Même si son principe est plus ancien, elle n’a été fabriquée industriellement qu’à partir des dernières années du XIXe siècle[2]. Composé à 90% de sable siliceux, de chaux vive (calcaire calciné) et d’eau, le mélange est moulé en briques qui sont compressées puis durcies en chaudière à vapeur. En l’observant de près, on remarque la présence du sable grossier et de graviers la composant. De ce fait, alors que la brique de terre cuite est quasiment inaltérable, on constate, au bout d’un siècle, l’usure de ces briques dont les grains se détachent peu à peu.

Briques silico-calcaires sur une souche de cheminée de l’hôtel Mezzara, 60 rue Jean-de-La-Fontaine, Paris XVIe. Photo Nicolas Horiot.
D’autre part, sa densité importante la rend pondéreuse et son inertie thermique est médiocre. Cependant ce matériau a aussi de nombreuses qualités, notamment un coût peu élevé en raison d’une consommation énergétique faible lors de sa production, une résistance à la compression permettant de l’utiliser en murs porteurs, une résistance au feu et une bonne qualité acoustique.
Son utilisation par Guimard correspond au tournant stylistique qui l’a vu abandonner la polychromie un peu tapageuse de ses débuts au profit d’une recherche d’élégance qui passait aussi par une plus grande discrétion. La couleur gris-beige de la brique silico-calcaire se confond en effet suffisamment avec celle de la pierre de taille.
Comme il l’avait fait plus tôt avec la brique en terre cuite, Guimard a tout d’abord expérimenté ce nouveau matériau à côté des moellons pour des villas ou des maisons de banlieue comme le Castel d’Orgeval à Villemoisson-sur-Orge (1904) où elle met en valeur les baies et individualise des surfaces remarquables. Au contraire, elle apparait très discrètement sur la villa d’Eaubonne (c. 1907), puis un peu plus tard pour le Châlet Blanc à Sceau (1909) et enfin de façon importante pour la villa Hemsy à Saint-Cloud (1913).

Fenêtre au rez-de-chaussée de la façade sur rue de la villa au 16 rue Jean Doyen à Eaubonne (Val d’Oise), c. 1907. Photo F. D.
Mais ce sont à ses constructions urbaines, à partir de l’hôtel Deron-Levent (1905-1907), que la brique silico-calcaire semble le mieux convenir. Suivent l’immeuble Trémois de la rue François Millet (1909-1911), les immeubles « modernes » des rue Gros, La Fontaine et Agar, son hôtel particulier de l’avenue Mozart (1909-1912) et l’hôtel Mezzara de la rue La Fontaine (1909-1911), où la brique silico-calcaire est employée concurremment avec la pierre de taille dont la surface varie en fonction de l’effet de luxe recherché.

Façade sur rue de l’hôtel Mezzara, 60 rue Jean-de-La-Fontaine, Paris XVIe, soubassement en moellons, parement en brique silico-calcaire, appui et encadrement de fenêtre en pierre de taille. Photo F. D.
Avec la brique silico-calcaire, Guimard s’est également servi de différents appareillages. L’hôtel Guimard au 122 avenue Mozart (1909) dont la façade est particulièrement mouvementée est un bon exemple où se devine leur fonction structurelle permettant de réduire l’épaisseur des murs et d’alléger les maçonneries vers le sommet, de s’adapter aux plissements des façades et de renforcer ponctuellement certains murs.

Détail des deuxième et troisième étages de la façade de l’hôtel Guimard. Bibliothèque des arts décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.
Le corps principal de ses murs est constitué d’un appareil à la flamande, donnant des parois d’une épaisseur de 45 cm ou 22 cm. Pour réaliser les courbes et amorcer le plissement de la façade, un appareillage en boutisses a été utilisé, parfois complété par un appareillage alterné à multiples boutisses afin de renforcer la solidité des murs, notamment au niveau de certaines ouvertures. Dans les parties hautes, l’emploi d’un appareil à assises réglées en panneresses a permis d’alléger les maçonneries du dernier étage au niveau de la loggia, constituant des murs de seulement 11 cm d’épaisseur.

Détail des deuxième et troisième étages de la façade de l’hôtel Guimard. Bibliothèque des arts décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.
C’est aussi à partir de 1909 (hôtel Guimard, cour de l’immeuble Trémois, hôtel Mezzara) qu l’on voit apparaitre un modèle de briques à angle arrondi, en particulier au niveau des jambages des baies où elles adoucissent le passage d’un plan à l’autre.

Détail de la travée de gauche du premier étage de la façade sur rue de l’hôtel Mezzara, 60 rue Jean-de-La-Fontaine, Paris XVIe. Photo F. D.
Après-guerre, la brique silico-calcaire était toujours présente sur l’immeuble Franck, rue de Bretagne (1914-1919). Un peu plus tard, elle a cédé le pas à une brique en terre cuite de couleur jaune pour l’immeuble luxueux de la rue Henri-Heine (1926) où Guimard ne l’a employée qu’aux derniers étages, là où elle est moins visible.

Brique en terre cuite jaune et brique silico-calcaire au cinquième étage de la façade sur rue de l’immeuble Guimard du 18 rue Henri-Heine, Paris XVIe , 1926. Photo F. D.
Mais elle a fait son retour en force sur des immeubles économiques comme l’immeuble Houyvet, villa Flore (1926-1927), ou les immeubles de la rue Greuze (1927-1928) et sans doute sur sa villa La Guimardière à Vaucresson (1930).

Façades arrière et sur la villa Flore de l’immeuble Houyvet, Paris XVIe, 1926-1927. Photo F. D.

Allège et fenêtre du 5e étage de la façade sur la villa Flore de l’immeuble Houyvet, Paris XVIe, 1926-1927. Photo F. D.

Détail de la façade sur rue du premier étage du 38 rue Greuze, Paris XVIe, 1927-1928. Photo F. D.
Comme on peut le voir sur les photos précédentes, après la Première Guerre mondiale Guimard a introduit des effets de volume et donc de lumière en plaçant d’une manière différente certaines briques par rapport à la surface, par exemple en saillie, en retrait ou en oblique. Ces techniques sont bien connues depuis des siècles et employées pour souligner des lignes verticales ou horizontales, ou encore pour ponctuer une surface plane. Mais, de même qu’il s’était refusé à utiliser des motifs répétitifs d’alternances de couleurs de briques, il n’a pas non plus usé de la possibilité de jouer avec le relief des parois en briques pendant la première partie de sa carrière, considérant avec justesse que leur surface devait conserver une certaine neutralité et non venir lutter avec ses propres motifs décoratifs (sculptés dans la pierre ou modelés en céramique) qu’il réservait à des emplacements restreints. Cependant, rattrapé, emporté par l’évolution stylistique générale prônant, dans un premier temps, la géométrisation du décor avant son abandon progressif, Guimard s’est résolu à introduire ces effets de surface à mesure qu’il abandonnait ses motifs décoratifs personnels. Il n’est certes pas le seul à utiliser ce motif de la brique placée à 45° et dont l’angle vient affleurer la surface (ci-dessous).

Détail de la façade sur rue du deuxième étage de l’immeuble Guimard du 18 rue Henri-Heine, Paris XVIe, 1926. Photo F. D.
Mais peut-être est-il l’inventeur de ce motif original où une brique subit une rotation à 30° et la suivante lui est symétrique. Sur l’assise sus-jacente, la même séquence est décalée d’une longueur de panneresse.

Linteau d’une fenêtre du cinquième étage du 36 rue Greuze, Paris XVIe, 1927-1928. Photo F. D.
La brique amiantine
Aussi dénommée amiantolithe, la brique amiantine a été fabriquée en France à Choisy-le-Roy à partir de 1904 par la Société française de la brique amiantine avec de la fibre d’amiante importée du Canada.
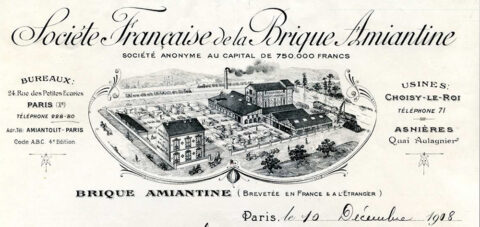
En-tête de la Société Françaises de la Brique Amiantine, lettre datée du 10 décembre 1908, photographie tirée de l’article de Pierre Coftier, « La brique amiantine de Choisy-le-Roy », L’actualité du Patrimoine, n° 8, déc. 2010. Droits réservés.
Grâce à l’ajout de ce minéral[3] on comptait alors augmenter la tenue au feu (déjà bonne) de la brique silico-calcaire, améliorer son faible pouvoir d’isolation et même obtenir un effet antifongique. Le produit qui pouvait être colorisé, était vu comme innovant par rapport à la simple brique silico-calcaire et s’en trouvait donc valorisé. Pour bien les différencier, la marque « Amiantine » était imprimée en relief dans une alvéole ménagée sur l’une des deux grandes faces des briques.
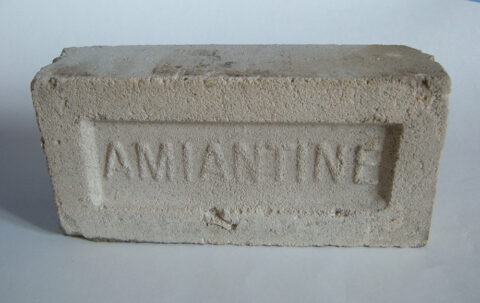
Grande face d’une brique amiantine. Photographie tirée de l’article de Pierre Coftier, « La brique amiantine de Choisy-le-Roy », L’actualité du Patrimoine, n° 8, déc. 2010. Droits réservés
Le site de Choisy-le-Roy a été racheté en 1922 par la société Lambert frères & Cie.
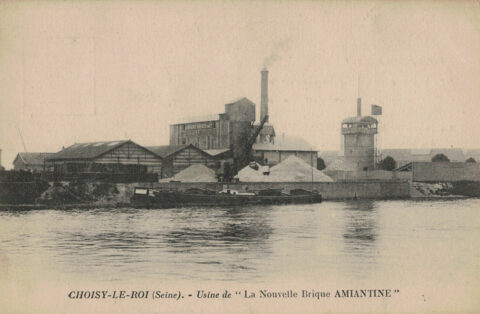
Usine Lambert Frère & Cie à Choisy-le-Roy, carte postale ancienne. Coll. part.
Guimard semble s’être servi de ses produits pour la première fois en 1925 lors de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes pour sa participation au Village Français[4] dans le cadre du groupe des Architectes Modernes dont il était le vice-président.
Auteur de la mairie du village, il a employé la brique amiantine[5] de façon plus extensive sur sa façade principale que sur sa façade postérieure. On retrouve d’ailleurs la mention de cette brique ainsi que celle de la cimenterie Lambert, réparties sur des groupes de trois panneresses, bien mises en évidence à quatre emplacements : deux sur la façade principale et deux sur la façade arrière. La Maison du Tisserand[6] de l’architecte Émile Brunet, mitoyenne de la mairie à droite, et sans doute encore d’autres constructions du village ont également utilisé ce matériau. Les tuiles de la mairie étaient en fibro-ciment patiné et avaient, elles aussi, été fournies par la cimenterie Lambert[7]. On touche ici un des aspects du Village français qui, à l’instar d’autres manifestations du même genre, ne pouvait équilibrer leur budget que grâce à la fourniture de matériaux à tarif préférentiel en échange d’une discrète mais efficace publicité.
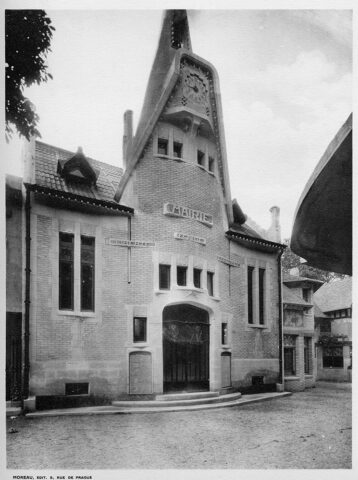
Façade principale de la mairie du Village français à l’Exposition Internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, 1926, pl. 2. Coll. part.
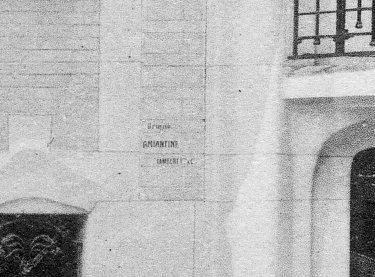
Façade postérieure de la mairie du Village français à l’Exposition Internationale des arts décoratifs et industriels modernes (détail), 1925, portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, 1926, pl. 3. Coll. part.
Preuve de l’intérêt constant de Guimard pour les nouveaux matériaux de construction et leur évolution, il a exposé dans la grande salle du rez-de-chaussée de la mairie « quelques-uns des matériaux ayant servi à son édification[8] ». On y trouvait par exemple deux types de briques dont nous ignorons l’emploi exact dans la mairie : « la brique double 6 x 2222, creuse, d’un emploi facile[9] » dont le fabriquant n’est pas connu, et aussi des briques produites par la « Société de Traitement des Résidus Urbains » dirigée par un certain Grangé. Dans un article consacré aux produits nouveaux de l’Exposition de 1925, la revue L’Architecture a donné quelques éclaircissements sur leur processus de fabrication :
« […]. Les briques et parpaings de la Société de Traitement industriel des résidus urbains, fabriqués par les procédés silico-calcaires avec les clinkers (mâchefer) provenant des incinérations des ordures ménagères de la ville de Paris, obtenus par la fusion et la vitrification à haute température (1.200°) des produits incombustibles contenus dans les ordures ménagères.[10] »
Pour inviter les acteurs du secteur du bâtiment à découvrir ses produits, Grangé a utilisé une carte publicitaire dont le verso est un dessin de la mairie du Village français par Alonzo C. Webb (1888-1975)[11], également paru dans La Construction Moderne.
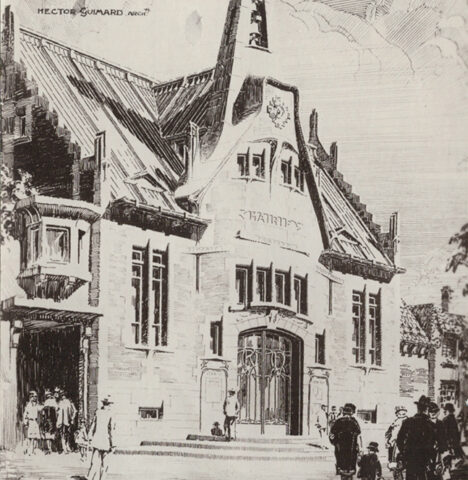
A.C. Webb, dessin de la façade principale de la mairie du Village français, carte émise par la Société de Traitement des Résidus Urbains invitant à visiter la salle d’exposition de la Mairie du Village Français, recto. Coll. part.
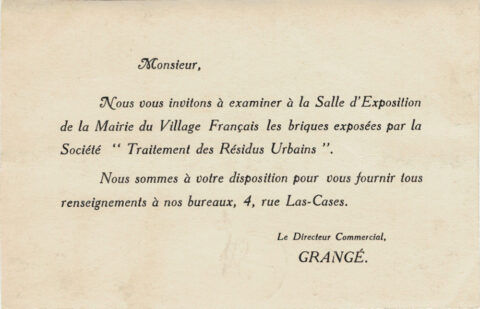
Carte émise par la Société de Traitement des Résidus Urbains invitant à visiter la salle d’exposition de la mairie du Village Français, verso. Coll. part.
Un autre fournisseur de Guimard en matériaux, exploitant de carrière à Thorigny-sur-Marne et fabricant de plâtres spéciaux, nous était connu par ailleurs. La revue L’Architecture a également mentionné ses produits exposés dans la grande salle de la mairie :
« […] Notamment les produits Taté, tout préparés pour enduits et ravalements imitant la pierre, classés en trois catégories et dont les noms, n’ayant qu’un rapport bien problématique avec les désignations indiquées entre parenthèses, sont les suivants : lithogène (prise lente), pétra stuc (prise accélérée), alabastrine (plâtre aluné d’albâtre). »
Pour la construction de la mairie, nous sommes certains de l’utilisation du « pétra-stuc » dont on devine le nom inscrit sur le socle, au-dessus du soupirail[12]. On parvient aussi à lire sur la photographie le nom de Taté.
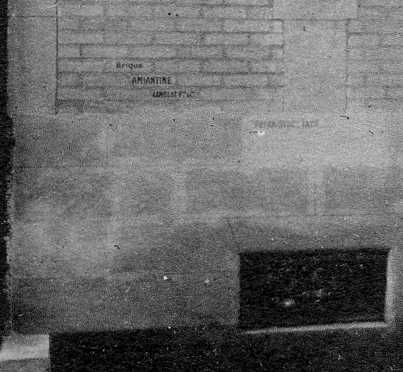
Façade principale de la mairie du Village français à l’Exposition Internationale des arts décoratifs et industriels modernes (détail), 1925, portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, 1926, pl. 2. Coll. part.
Ce « pétra-stuc » de couleur assez sombre utilisé en socle, est plus visible sur la photographie de la façade postérieure de la mairie.
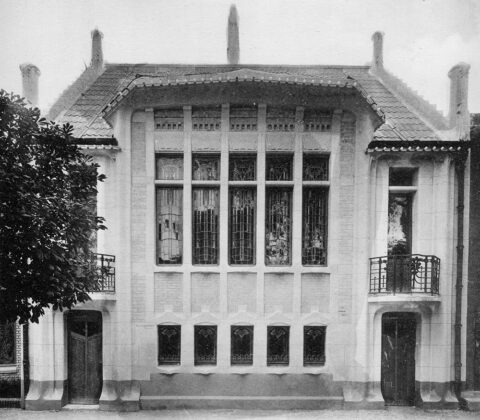
Façade postérieure de la mairie du Village français à l’Exposition Internationale des arts décoratifs et industriels modernes, 1925, portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, 1926, pl. 3. Coll. part.
L’utilisation de ce produit serait anecdotique si ce Taté n’avait nourri un vif ressentiment vis-à-vis de Guimard, sans doute pour une question financière. Mais au lieu de régler ce différend par voie judiciaire, auprès d’un tribunal civil ou d’un tribunal de commerce, apprenant que le Commissariat Général de l’Exposition des arts décoratifs avait proposé le nom de Guimard pour la croix de chevalier de la Légion d’honneur, Taté a envoyé à la chancellerie de l’Ordre une lettre de dénonciation[13] qui a eu pour effet de retarder sa nomination de quatre années.
Après l’exposition de 1925, Guimard a à nouveau eu recours à des produits contenant de l’amiante. À l’instar de son confrère Henri Sauvage, il s’est en effet servi des tubes de fibrociment, produits par la société Éternit. On les retrouve notamment sur les deux immeubles de la rue Greuze où ils ont une fonction essentiellement décorative en soulignant par leur volume la verticalité des bow-windows et des baies. Les plans montrent d’ailleurs qu’il s’agit de demi-cylindres.

Immeuble du 38 rue Greuze, Paris XVIe. Photo F. D.
Ces tubes en fibro-ciment semblent avoir une fonction plus structurelle au niveau des terrasses des 6e et 7e étages, analogue à leur utilisation deux ans plus tard par Sauvage qui a expérimenté leur utilisation pour les murs porteurs d’habitations individuelles construites avec des éléments préfabriqués.

Terrasse du 7e étage de l’immeuble du 38 rue Greuze, Paris XVIe. Photo F. D.
Enfin, ils sont aussi présents sur La Guimardière, la villa que Guimard s’est construit en 1930 à Vaucresson en utilisant des matériaux disparates provenant sans aucun doute de ses chantiers passés. Sans surprise, la brique est encore très présente pour cette ultime construction.

Villa La Guimardière à Vaucresson (Yvelines), Bibliothèque des Arts décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.
Frédéric Descouturelle
Merci à Nicolas Horiot pour les précisions apportées pour la salle Humbert de Romans et l’hôtel Guimard.
Notes
[1] On trouve dans la littérature des variations dans l’appellation des différents appareillages pouvant entretenir une confusion, notamment entre les appareillages à l’anglaise et à la flamande.
[2] Granger, Albert, Pierre et Matériaux artificiels de construction, Octave Douin éditeur, Paris, s. d.
[3] Les premiers décès dus à des fibroses pulmonaires causées par l’amiante ont été constatés autour de 1900, mais ce n’est que 30 ans plus tard que des cas de mésothéliomes (cancer de la plèvre) lui ont été imputés. Le lien n’a été formellement établi qu’à partir des années 1950 mais les méfaits de l’amiante ont ensuite été longtemps niés par toute la filière de production et par une bonne part des responsables politiques, entraînant une pollution à présent extrêmement coûteuse à éradiquer.
[4] Le Village Français a été l’un des sites de l’exposition les plus appréciés par le public, à défaut d’avoir été le mieux compris par les critiques puis par la suite le plus étudié par les historiens de l’art. Rationaliste et moderne sans être révolutionnaire, rural sans être régionaliste, il présentait, rassemblés en un village fictif, différentes maisons, commerces, et services, traités dans un style moderne privilégiant les nouveaux matériaux mais sans négliger les matériaux traditionnels. Cf. Lefranc-Cervo, Léna, Le Village français : une proposition rationaliste du Groupe des Architectes Modernes pour l’Exposition Internationale des arts décoratifs de 1925, Mémoire de recherche (2e année de 2e cycle) sous la direction de Mme Alice Thomine Berrada, École du Louvre, septembre 2016.
[5] Goissaud, Antony, « La Mairie du Village », La Construction Moderne, 8 novembre 1925.
[6] Goissaud, Antony, « La Maison du Tisserand », La Construction Moderne, 11 octobre 1925.
[7] « Parmi les exposants [à l’intérieur de la grande salle] on remarque naturellement la Maison « Lambert Frères » qui a fourni les briques amiantines et les tuiles des maisons du Village […] ». Goissaud, Antony, « La Mairie du Village », La Construction Moderne, 8 novembre 1925.
[8] « Les produits nouveaux à l’Exposition des Arts décoratifs et industriels modernes de 1925 », L’Architecture n° 23, 10 décembre 1925.
[9] Ibid.
[10] Ibid. On désigne couramment ces résidus de combustion sous le terme de mâchefer.
[11] Cf. la note qui lui est consacrée dans l’article sur la participation de Guimard à l’Exposition de 1925.
[12] Le rédacteur de La Construction Moderne l’a confondu avec une « pierre grise, fortement teintée », Goissaud, Antony, « La Mairie du Village » La Construction Moderne, 8 novembre 1925.
[13] Nous réservons la reproduction de cette lettre à un prochain article relatant les péripéties de cette affaire.

La participation d’Hector Guimard à l’Exposition des arts décoratifs de 1925 – Première partie
Nous profitons des célébrations du centenaire de l’Exposition internationale des arts décoratifs industriels et modernes qui s’est tenue à Paris en 1925[1] pour publier nos recherches sur la participation d’Hector Guimard à cet évènement. Cette contribution relativement modeste de l’architecte est un peu à l’image de sa carrière au lendemain de la Première guerre mondiale. Cette période a finalement été assez peu étudiée, mais l’Exposition de 1925 en constitue un des moments forts et sans doute l’un des plus intéressants. La participation de Guimard s’est concrétisée au sein d’un des secteurs de l’exposition appelé le Village français par la réalisation de trois œuvres : la mairie et deux monuments funéraires. La publication d’une étude complète sur le Village français étant en projet, nous avons choisi de mettre aujourd’hui en lumière certains aspects méconnus comme les intérieurs de la mairie et le cimetière. Nous évoquerons pour commencer le contexte qui a conduit à l’organisation de l’exposition, la place de Guimard et sa participation au débat d’idées à la veille de cet événement majeur pour les arts décoratifs et l’architecture.
Porté par l’Art nouveau dans les années 1890, le renouveau de l’architecture et des arts décoratifs européens engagé dès la fin du XIXe siècle est arrivé à maturité autour de 1910, puis se prolongeant dans les années 1920 par ce que l’on appellera rétroactivement le style Art déco, a connu un point d’orgue spectaculaire en France avec l’Exposition de 1925. La longue gestation de cette manifestation — débutée vingt ans plus tôt et décalée plusieurs fois en raison notamment du premier conflit mondial — est à la mesure de son succès (plus de 16 millions de visiteurs) et de son retentissement international propulsant la France à l’avant-garde des nations dans ce domaine.
L’ambition affichée des organisateurs étant de n’exposer que des œuvres nouvelles et modernes[2], aucune place n’avait été accordée aux styles anciens qui se sont retrouvés cantonnés dans des expositions à l’extérieur de la manifestation à l’instar de celle organisée au musée Galliera[3]. Même si certains observateurs reconnaissaient l’apport des artistes 1900 à l’art moderne, la rupture avec l’Art nouveau était donc déjà largement consommée. Parmi quelques affirmations célèbres, celle du peintre Charles Dufresne (1876-1938) résumait assez bien l’état d’esprit général de l’époque : « L’art de 1900 fut l’art du domaine de la fantaisie, celui de 1925 est du domaine de la raison »… À quelques exceptions près, les critiques étaient donc féroces envers l’Art nouveau, s’attardant souvent sur ses excès et oubliant un peu vite que l’architecture et les arts décoratifs célébrés avec faste en 1925 puisaient en partie leurs sources dans le renouvellement engagé trente ans auparavant. Il faudra attendre une décennie pour que l’on s’y intéresse à nouveau et que l’on envisage un début de réhabilitation puis de protection[4].
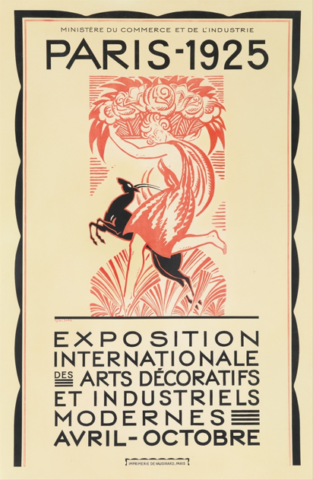
Affiche officielle de l’Exposition de 1925. Coll. part.
En 1925, parmi les noms des participants ayant profité de l’évènement pour émerger ou conforter leur carrière comme Mallet-Stevens, Le Corbusier, Roux-Spitz ou Patout, d’autres animaient déjà la scène artistique dans les années 1900. Signe d’une certaine reconnaissance, la présence en 1925 de Plumet, Sauvage, Dufrène, Follot ou encore Jallot était aussi la preuve de leur capacité d’adaptation et de renouvellement. Deux d’entre eux, Maurice Dufrène (1876-1955) et Paul Follot (1877-1942) se trouvaient même à la tête d’ateliers de décoration de grands magasins parisiens (La Maîtrise aux Galeries Lafayette pour le premier, Pomone au Bon Marché pour le second). Le succès des productions Art nouveau de qualité de ces deux grands noms de la décoration au tournant du siècle ne les avait pas empêchés d’opérer un virage dès le milieu des années 1900 vers un style plus dépouillé puis dans les années 1910 vers des compositions où les courbes avaient déjà presque disparu.
La situation d’Hector Guimard était un peu différente de celle de ses confrères. Bien qu’ayant fait évoluer son style vers plus de simplicité et de sobriété, il a toujours refusé de céder à la mode. A la veille de l’Exposition en 1923, il déclarait à un journal : « Soyons simplement nous-mêmes, imposons-nous la discipline de l’harmonie, sans croire que la Mode puisse et doive régenter l’Art[5]». Nous reviendrons un peu plus loin sur ce principe, sorte de fil conducteur des années 1920 qui explique en grande partie les choix opérés par l’architecte durant cette période.
Au début de cette nouvelle décennie, Guimard poursuivait donc une œuvre essentiellement architecturale, la perte de ses ateliers au lendemain du conflit mondial ayant fortement réduit ses travaux dans le domaine des arts décoratifs. L’activisme dont il faisait encore preuve au début des années 1920 lui avait cependant permis de conserver une certaine influence au sein d’organisations reconnues pour mettre en avant les idées nouvelles et très engagées dans la genèse de l’Exposition de 1925. Ainsi, même s’il n’occupait plus de responsabilités au sein de la Société des artistes décorateurs (SAD)[6], il en était encore adhérent au début des années 1920 et même exposant en 1923[7]. Rappelons également que lors de son voyage aux États-Unis en 1912, Guimard avait été missionné par la SAD. Il s’était alors présenté aux américains en tant que vice-président de l’association et en promoteur de « L’Exposition Internationale d’Architecture et de Décoration moderne », qui devait se tenir à Paris en 1915[8]…
C’était donc en connaisseur du sujet et porte-parole des idées modernes à l’approche de l’exposition qu’on le retrouvait en 1922 en tant que membre fondateur du Groupe des Architectes Modernes (GAM)[9], occupant le poste de vice-président aux côtés d’Henri Sauvage (1873-1932), sous la présidence de l’incontournable Frantz Jourdain (1847-1935).
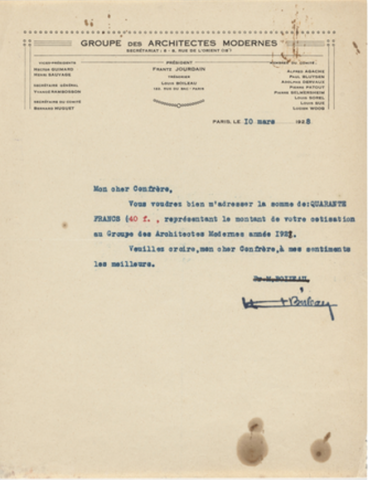
Lettre à entête du Groupe des Architectes Modernes réclamant la cotisation de 40 F à ses membres, datée du 10 mars 1928 et signée par Boileau. Coll. MOMA. Droits réservés.
Dans le même entretien de 1923, il en justifiait la création par le besoin de promouvoir les idées modernes qui ne manqueront pas de s’exprimer durant la manifestation à venir et, conscient que les pavillons construits n’auraient qu’une existence éphémère, par la nécessité de créer une annexe en dehors de l’Exposition de 1925 portée par l’État et la Ville de Paris « où l’architecture moderne s’exprimerait, comme les bijoux, le meuble, les étoffes, en matières définitives. Ces immeubles fourniraient aux décorateurs modernes un cadre vivant et aux industriels un premier débouché à leur production moderne sans lequel une réaction serait à redouter ». La plupart des pavillons construits pour l’exposition ont effectivement été détruits après la manifestation et ce projet d’annexe n’a pas vu le jour, pas plus que l’ambitieux projet intitulé « Hôtel de voyageurs/Maison américaine/Immeubles de rapport, constructions définitives pour les visiteurs de l’Exposition des arts décoratifs de 1925 » dont nous connaissons l’existence par trois plans signés de plusieurs architectes du GAM, dont Guimard, et qui devait prendre place boulevard Gouvion-St-Cyr à Paris (75017).
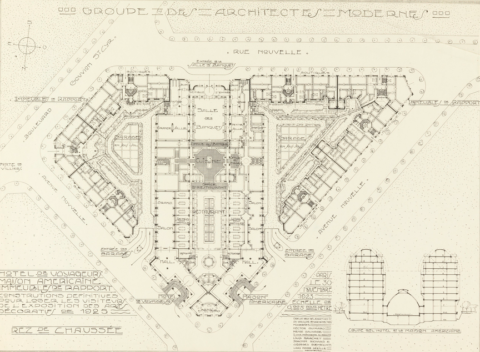
Plan du rez-de-chaussée du projet de bâtiments définitifs du Groupe des Architectes Modernes pour l’Exposition de 1925, daté du 30 novembre 1923. Cooper hewitt, Smithonian design museum. Droits réservés.
Le GAM s’est finalement vu confier la réalisation d’un ensemble appelé le Village français au sein de l’exposition. Cela pourrait être vu comme une compensation, voire une façon de le tenir à l’écart, mais le fait que plusieurs de ses membres aient été chargés de construire quelques-uns des bâtiments les plus importants de l’évènement confirme malgré tout l’influence de l’association sur l’exposition.
La mairie du Village français
Le Village français occupait un périmètre relativement restreint au niveau du Cours Albert 1er un peu à l’écart de l’esplanade des Invalides considérée comme l’épicentre de l’exposition. Regroupant une vingtaine de bâtiments construits par autant d’architectes du GAM[10], l’ensemble constituait une sorte de proposition architecturale destinée à représenter un village du début du XXe siècle.
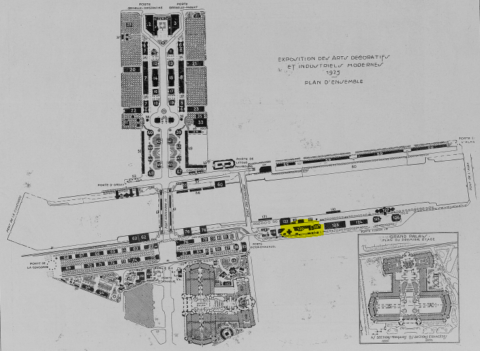
Plan d’ensemble de l’Exposition de 1925 implantée de part et d’autre de la Seine. L’emplacement du Village français est surligné en jaune. La Construction Moderne, 03 Mai 1925. Coll. part.
Outre les indispensables mairie, église et école, on y trouvait une auberge, une habitation « bourgeoise », une Maison de Tous, un bazar[11], divers bâtiments commerciaux ainsi que plusieurs constructions dites secondaires comme des transformateurs électriques, un groupe sanitaire ou encore un lavoir. Toutes ces œuvres sans exception avaient le point commun d’avoir été réalisées dans un goût moderne.
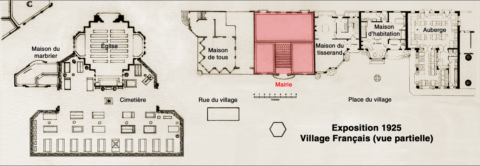
Plan partiel du Village français réalisé à partir des plans du portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, 1926. Photomontage F. D.
Pour des raisons économiques et de contraintes liées à son environnement, l’ambition du projet initial avait été révisé à la baisse. Les architectes avaient dû composer avec les plantations existantes, les branchements d’égouts, d’eau, de gaz, d’électricité, de télégraphe… De plus, la surface finalement allouée au projet n’ayant pas permis de construire des bâtiments indépendants, Dervaux n’avait eu d’autre choix que de rendre mitoyennes les constructions (aux exceptions notables de l’église et de l’école). La plupart d’entre elles étaient donc alignées dans le sens de la longueur, parallèlement à la Seine. Cette révision du projet initial avait eu pour effet immédiat de modifier l’appellation de l’ensemble qui était passée de « Village moderne » à « Village français », les architectes du GAM n’ayant pas pu faire preuve de suffisamment d’urbanisme. Il est à noter que cette double appellation a perduré, y compris durant la manifestation, certains auteurs ayant estimé que le petit village était d’un aspect suffisamment moderne pour qu’il puisse garder ce qualificatif.
La mairie de Guimard a été un des derniers édifices du village à être achevé (avec le transformateur électrique de Pierre Patout (1879-1965)) alors que l’exposition avait commencé depuis plus d’un mois[12]. Un certain nombre de cartes postales anciennes montre le bâtiment encore en chantier malgré les efforts des photographes pour le cacher ou le reléguer à l’arrière-plan…
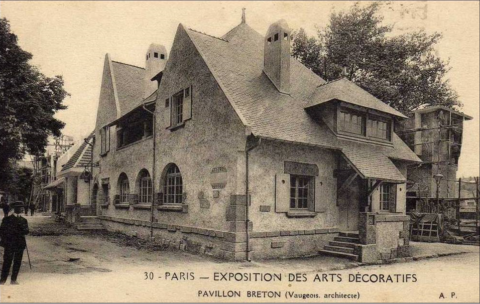
Vue du Village français. À l’arrière-plan à gauche, on aperçoit la mairie sous les échafaudages, de même que le transformateur de Patout sur la droite, carte postale ancienne. Coll. part.
Ce retard pris dans la construction d’un des principaux bâtiments de la petite cité explique probablement son inauguration tardive. Ce n’est que le lundi 15 juin 1925 que le Village français a été inauguré comme le montre une photo du journal Excelsior sur laquelle la mairie semble en effet dégagée des échafaudages.
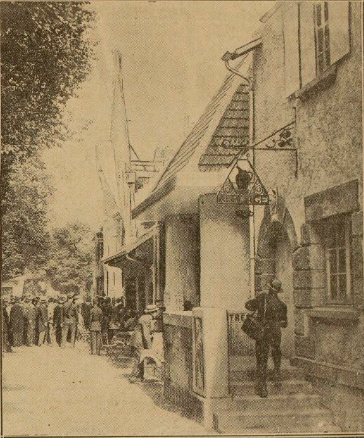
L’inauguration du Village français. Excelsior, 16 juin 1925. BnF/Gallica.
Tournant le dos au fleuve, la mairie de Guimard s’élevait en limite de la place du village, mitoyenne sur sa gauche de la Maison de Tous due au talentueux urbaniste D. Alfred Agache (1875-1959) et sur sa droite de la Maison du tisserand de l’architecte Émile Brunet (1872-1952). Agache avait parfaitement résumé l’esprit qui avait guidé le GAM dans la construction de cet ensemble : « (…) le « Village de France », que nous avons édifié afin de donner, en raccourci, un aperçu de ce que doit être l’agglomération rurale, pour répondre aux besoins de la vie moderne[13]».

La mairie du Village français, carte postale ancienne. Coll. part.
Actant le fait qu’ils n’avaient pu construire des bâtiments indépendants, les deux architectes avait profité de cette proximité immédiate pour aménager une ouverture permettant de circuler entre les deux édifices[14], estimant sans doute que les fonctions et les rôles des deux édifices étaient compatibles et complémentaires.
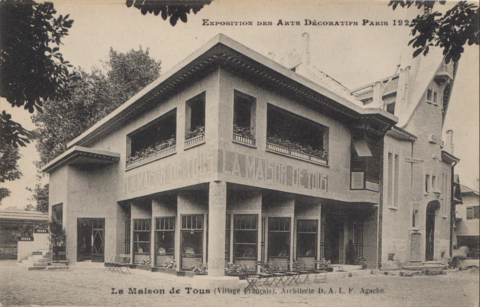
La Maison de Tous et la mairie du Village français, carte postale ancienne. Coll. part.
L’aspect extérieur du bâtiment est bien connu grâce à de nombreuses cartes postales anciennes sur lesquelles il est soit le sujet principal soit le sujet secondaire, les onze pinacles rythmant la toiture le rendant souvent incontournable sur les clichés. Le bâtiment apparait comme une synthèse des dernières œuvres d’avant-guerre de Guimard et de ses recherches du début des années 1920 pour développer un mode de construction économique appelé le Standard-Construction utilisé pour édifier le petit hôtel du Square Jasmin dans le XVIe arrondissement parisien.
Apportant une touche d’originalité à l’ensemble, le plus haut de ces pinacles s’élevait à l’aplomb de la travée centrale de la façade principale légèrement bombée et rythmée par de nombreuses ouvertures, mais en retrait d’un auvent en ciment venant couvrir l’horloge. Tel un signal, à la fois par sa hauteur et par sa fonction de carillon, il rivalisait symboliquement avec le clocher de l’église voisine construite par l’architecte Jacques Droz (1882-1955) et rappelait au visiteur l’importance de la vie républicaine dans un village moderne… Nous avons par ailleurs une idée assez précise de ses couleurs, les Archives de la Planète du musée départemental Albert-Kahn conservant de nombreux autochromes de la manifestation où la mairie apparait dans des tons clairs dus à un habillage de briques amiantines et de pierre blanche et grise[15].
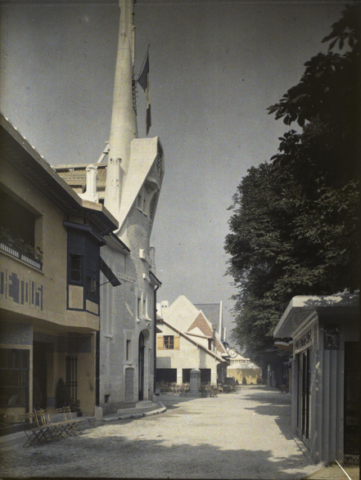
Vue du Village français. A gauche, la Maison de Tous et la mairie suivies de la place du village puis de l’auberge ; à droite, la poissonnerie, autochrome. Musée départemental Albert-Kahn, Département des Hauts-de-Seine.
Deux autres sources sont précieuses pour la connaissance de la mairie : le portfolio édité par Pierre Selmersheim[16] et l’article d’Anthony Goissaud dans La Construction Moderne[17]. Un troisième article inédit publié dans Le Moniteur des Architectes communaux[18] nous échappe encore mais nous espérons que cette publication permettra de le retrouver…

Façade principale de la mairie, portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, pl. 2, 1926. Coll. part.
Une carte postale éditée à des fins promotionnelles par Guimard (utilisée pour illustrer l’entête de cet article) complétait ce matériel éditorial. On y trouve au recto une illustration de l’artiste A. C. Webb (1888-1975)[19]. Le verso est quant à lui décliné en différentes versions en fonction de l’utilisation souhaitée (publicitaire avec la liste des collaborateurs de la mairie, promotionnelle vantant une technique de construction ou encore vierge pour la correspondance…).

Façade postérieure de la mairie, portfolio L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim, éditions Charles Moreau, pl. 3, 1926. Coll. part.
Les panneaux encadrant la porte d’entrée principale et destinés à l’affichage communal servaient ici à présenter les entreprises et les artistes ayant collaboré au chantier de la mairie. Parmi ces derniers, on y trouvait quelques noms plus ou moins célèbres comme la famille de ferronniers Schenck, fabricants de la rampe d’escalier en fer forgé, le vitrailliste Gaëtan Jeannin, auteur des vitraux de la salle des mariages ou encore le peintre René Ligeron dont nous reparlerons plus loin.
Enfin, un corpus de fontes du répertoire de modèles de Guimard édité depuis 1908 par la fonderie de Saint-Dizier ornait le bâtiment, notamment en façade postérieure où on retrouvait des balcons au premier étage et des panneaux garnissant les fenêtres du rez-de-chaussée.

Détail de la façade postérieure de la mairie ornée de fontes. Bibliothèque des arts décoratifs. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.
Aux extrémités des deux façades, les descentes d’eaux de la fonderie de Saint-Dizier se raccordaient à des chéneaux provenant de la fonderie Bigot-Renaux. Ces chéneaux, sans décor, recevaient des « ornements de chéneaux à angle sortant » provenant eux aussi de la fonderie de Saint-Dizier et dont il semble qu’ils aient eu ici leur seule utilisation.

Détail de la façade postérieure de la mairie ornée de fontes. Bibliothèque des arts décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.
La décoration fixe
Parmi les entreprises ayant eu un rôle important dans la décoration intérieure du bâtiment, figure la société ELO[20] dont les lambris en fibrociment recouvraient une partie des murs intérieurs. Cette société a connu une croissance importante dans les années 1920 au moment où les besoins en éléments de décoration bon marché en tout style étaient très demandés. La recherche d’économies étant un dénominateur commun à la plupart des constructions édifiées par Guimard, il n’est pas étonnant qu’il ait fait appel à cette société pour la mairie, l’enveloppe financière obtenue étant particulièrement restreinte[21]. Les lambris ELO ont donc rejoint la longue liste des nouveaux matériaux (et parfois des nouvelles techniques) employés par l’architecte tout au long de sa carrière. La possibilité de les modeler à son style était une qualité supplémentaire. On se souvient notamment de l’emploi des panneaux Lantillon en fibrocortchoïna qui recouvraient les plafonds du Castel Béranger, du Castel Henriette, de la Villa Berthe ou du pavillon Lantillon à Sevran, mais aussi de la pierre de verre Garchey également utilisée au Castel Henriette ou encore du ferrolithe employé sur la façade postérieure du Pavillon de l’Habitation en 1903[22].
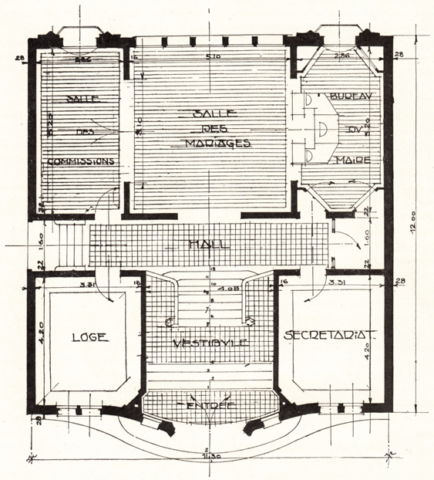
Plan de la mairie publié dans La Construction Moderne, 08 novembre 1925. Coll. part.
Une exposition consacrée aux nouveaux matériaux ou aux techniques employées pour la construction de la mairie occupait la grande salle du rez-de-chaussée accessible uniquement par deux portes en façade postérieure. On y retrouvait notamment les entreprises Taté pour le plâtre, la pierre et le marbre, Lambert Frères pour les briques amiantines ou encore la Société de Traitement industriel des résidus urbains[23].
Sur la photo de La Construction Moderne, nous devinons les lambris ELO tapissant une partie du mur derrière le bureau du maire.
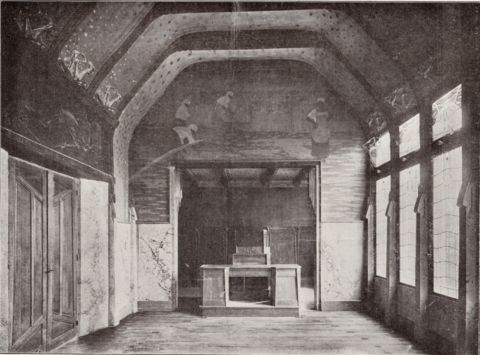
Salle des mariages avec au fond le bureau du maire et les vitraux de Jeanneau à droite. La Construction moderne, 08 novembre 1925. Coll. part.
Les collections publiques quant à elles conservent un autre cliché qui permet d’apprécier la sculpture du lambris au premier plan.

Salle des mariages et bureau du maire. GrandPalaisRmnPhoto. Droits réservés.
Enfin, le Cooper hewitt, Smithonian design museum détient le dessin original et quasi définitif du lambris. Fin et délicat mélange entre les mondes organique et végétal, le motif principal nous projette vingt ans en arrière, apportant une touche de sentiment chère à Guimard et propice aux interprétations…
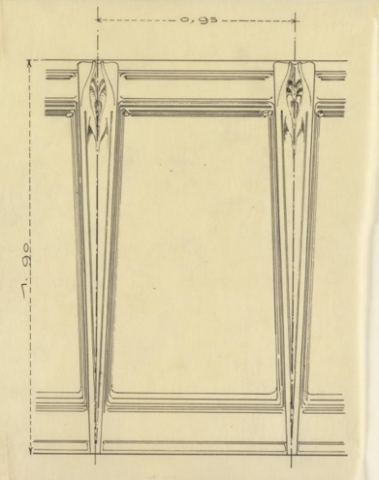
Dessin du lambris de la mairie. Cooper hewitt, Smithonian design museum. Droits réservés.
Un lambris que l’on retrouvera sous l’appellation « Lambris Guimard » dès l’année suivante sur les catalogues de la société ELO. Il s’agit probablement de la dernière tentative de diffusion commerciale d’un modèle par l’architecte.
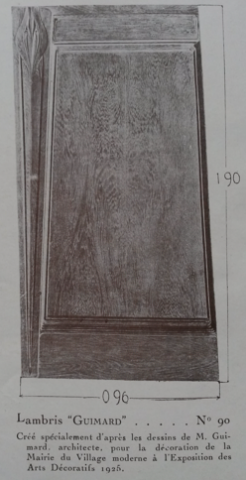
« Lambris Guimard », catalogue de la société ELO, 1926. Coll. part.
ELO est aussi probablement le fabricant de l’étonnant bas-relief aux vautours en imposte des portes de la salle des mariages signé par Raymond Andrieux. Même si les rapaces – aux côtés des fauves – font partie des sujets favoris des artistes de l’époque, on peut s’interroger sur les raisons d’un tel choix pour orner la salle des mariages.

Détail de la frise aux vautours de R. Andrieux décorant la salle des mariages. GrandPalaisRmnPhoto. Droits réservés.
Si Guimard a très certainement fait la connaissance de cet artiste quasiment inconnu par l’intermédiaire de la société ELO – à moins que ce ne soit l’inverse – il a pu vouloir saisir l’opportunité de mettre en avant un jeune artiste tout en adaptant à moindre coût une œuvre déjà existante. Les informations sur Raymond Andrieux sont très minces[24] mais nous avons retrouvé la trace d’une œuvre, aujourd’hui en collection privée, dont la ressemblance avec le bas-relief de la Mairie est particulièrement troublante.

Panneau ELO aux vautours signé R. Andrieux en bas à droite et portant au revers le tampon de la société ELO, larg. 1,37 m, haut. 1,15 m, prof. 0,18 m. Coll. part.
Notre enquête nous a conduit au Salon des artistes français de 1924 où Andrieux exposait un panneau dans la catégorie Arts décoratifs sous la légende : « Vautours, panneau en fibrociment »[25]. Cette œuvre a donc certainement servi de modèle au bas-relief de la salle des mariages, Guimard ayant probablement demandé au jeune artiste de s’inspirer de son œuvre de 1924 pour l’adapter en frise. Il est même possible que cette œuvre ait figuré au catalogue du fabricant mais les exemplaires que nous possédons n’en font pas mention.
Parmi les autres artistes ayant collaboré à la décoration intérieure du bâtiment figure René Ligeron (1880-1939)[26], dont les deux peintures représentant des scènes de la campagne française – un thème décoratif présent dans de nombreuses mairies – ornaient les murs des pignons de la salle des mariages. Grâce aux photos précédentes, nous connaissions la peinture intitulée Moissonneuses liant des gerbes. Une troisième vue inédite de la salle des mariages en cours de décoration donne un aperçu de la seconde œuvre intitulée Femme gardant des moutons, dans le même registre champêtre que la première.
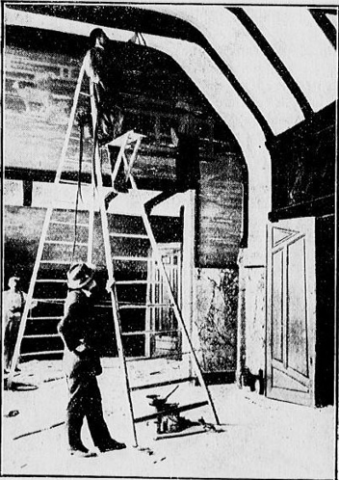
La salle des mariages de la mairie du Village français en cours de décoration, Recherches et Inventions n° 163, mars 1928. Coll. part.
Il n’est d’ailleurs pas impossible que le personnage de profil à la barbe grisonnante, coiffé d’un chapeau et se tenant à l’échelle soit Hector Guimard en personne venu superviser les travaux…
(à suivre)
Olivier Pons
Notes
[1] La manifestation s’est tenue du 28 avril au 08 novembre 1925. Par commodité, nous la nommerons l’Exposition de 1925 ou tout simplement l’exposition.
[2] Le règlement stipulait : « (…) sont admises à l’Exposition les œuvres d’une inspiration nouvelle et d’une originalité réelle exécutées et présentées par les artistes, artisans, industriels, créateurs de modèles et éditeurs et rentrant dans les arts décoratifs industriels et modernes. En sont rigoureusement exclues les copies, imitations et contrefaçons de styles anciens ». Règlement de l’exposition. Coll. part.
[3] « Exposition des Rénovateurs de l’Art appliqué de 1890 à 1910 », musée Galliera (Paris), du 06 juin au 20 octobre 1925.
[4] Cf. l’article de Léna Lefranc-Cervo : https://www.lecercleguimard.fr/fr/proteger-le-patrimoine-art-nouveau-parisien-initiatives-et-reseaux-dans-lentre-deux-guerres/
[5] Entretien donné à L’Information financière, économique et politique, 19 février 1923. BnF / Gallica.
[6] La Société des artistes décorateurs a été créée en 1901 à l’initiative de l’avocat René Guilleré et de quelques autres grands noms des arts décoratifs. Son but était de « favoriser le développement des arts décoratifs », article 2 des statuts de la SAD « approuvés par arrêté de M. le Préfet de Police en date du 6 Avril 1901 ». Coll. part.
[7] Le catalogue a oublié de citer son nom mais sa participation au SAD de 1923 est avérée par plusieurs articles. L’amour de l’Art du mois de janvier 1923 évoque par exemple les trois tombes présentées par Guimard dont « celle de la famille Henri », un monument inédit, sans doute toujours existant et que nous recherchons activement…
[8] Cf. l’article : https://www.lecercleguimard.fr/fr/le-premier-voyage-dhector-guimard-aux-etats-unis-new-york-1912/
[9] Cf. l’article de Léna Lefran-Cervo : https://www.lecercleguimard.fr/fr/entre-norme-et-liberte-larchitecture-du-point-de-la-vue-de-la-societe-des-architectes-modernes/
[10] Il avait été réalisé sous la direction des architectes Charles Genuys (1852-1928) et Gouverneur sur un plan d’ensemble dessiné par Adolphe Dervaux (1871-1945). Cf. Lefranc-Cervo, Léna, Le Village français : une proposition rationaliste du Groupe des Architectes Modernes pour l’Exposition Internationale des arts décoratifs de 1925, Mémoire de recherche (2e année de 2e cycle) sous la direction de Mme Alice Thomine Berrada, École du Louvre, septembre 2016.
[11] Le bazar a été construit sur les plans de l’architecte Marcel Oudin (1882-1936) pour la chaîne des Magasins Réunis. Spécialiste de la construction en béton armé, Oudin était devenu l’un des architectes de la famille nancéienne Corbin, propriétaire des Magasins Réunis dans l’Est de la France, mais aussi à Paris (Magasins Réunis République, À l’Économie Ménagère, Grand Bazar de la rue de Rennes).
[12] Sur une photo originale datée du 1er juin 1925, la mairie apparait encore sous les échafaudages.
[13] La Cinématographie française, 11 avril 1925. La Maison de Tous, qui devait s’appeler initialement Maison du Peuple – un nom jugé trop connoté – était sans doute une des plus constructions les plus séduisantes du Village tant dans sa réalisation architecturale que par les idées qui avaient présidé à sa conception et mériterait un article complet.
[14] Le Journal des débats politiques et littéraires, 17 juin 1925.
[15] Un article consacré à l’utilisation des briques par Guimard est en préparation et reviendra plus complètement sur les matériaux de la mairie du Village français.
[16] L’Architecture à l’Exposition des arts décoratifs modernes de 1925/Le Village moderne/Les Constructions régionalistes et quelques autres pavillons/Rassemblés par Pierre Selmersheim. éditions Charles Moreau, 1926.
[17] « La Mairie du Village français », A. Goissaud, La Construction Moderne, 08 novembre 1925.
[18] « La Mairie du Village français à l’Exposition », Le Moniteur des Architectes communaux, 1925, n° 2.
[19] Alonzo C. Webb (1888-1975) était un peintre et graveur américain qui a passé sa vie entre les États-Unis et l’Europe. Étudiant en architecture et beaux-arts d’abord à Chicago puis à New-York, il a rejoint l’Europe au lendemain de la Première guerre mondiale et s’est établi en France dans les années 1920 où il proposait des dessins de monuments anciens et de paysages soit pour des supports publicitaires soit pour illustrer des articles dans de grands journaux nationaux (dont L’Illustration). Guimard l’avait peut-être rencontré par l’intermédiaire de son épouse Adeline, Webb faisant partie de la petite colonie américaine de Paris. Après s’être spécialisé dans la gravure, il a rejoint Londres à la fin des années 1930 où il est décédé en 1975.
[20] Créée en 1902, la société ELO avait son siège et ses usines à Poissy (Yvelines) et des salles d’exposition situées 9 rue Chaptal à Paris dans le Xe arrondissement. Elle proposait des lambris décoratifs et des revêtements en fibrociment (un mélange d’amiante et de ciment) destinés à l’intérieur comme à l’extérieur grâce à des qualités de solidité, d’imputrescibilité et de résistance au feu. Fabriqués en grande série, les revêtements se proposaient d’imiter le bois autant que le bronze, la pierre, le cuir et même la céramique à des tarifs très inférieurs à ces matériaux (Journal Excelsior du 06 mai 1925).
[21] L’enveloppe allouée à la mairie était de 92 000 F. La Construction Moderne, 08 novembre 1925.
[22] Le ferrolithe était une sorte d’enduit imitant la pierre. Très résistant et réfractaire à l’humidité, il était surtout utilisé pour ravaler et recouvrir les murs extérieurs.
[23] L’Architecture n° 23, 10 décembre 1925.
[24] Raymond Andrieux était un artiste originaire de Lille, sociétaire de la Société nationale des Beaux-Arts en 1926 dans la catégorie sculpture. Un vide-poche décoré à nouveau d’un vautour, signé R. Andrieux est passé en vente aux enchères en 2016.
[25] Le Grand Écho du Nord de la France, 21 mai 1924. BnF/Gallica.
[26] (Jacques) René Ligeron est né à Paris le 30 mai 1880 et probablement décédé à Alger le 08 décembre 1939. Peintre voyageur, il était surtout connu pour son œuvre de gravure avec une prédilection pour les eaux-fortes. Élève de Lepeltier, Lefebvre et Robert-Fleury, il a exposé à partir de 1905 au Salon des artistes français essentiellement des paysages et quelques portraits. La presse de 1936 s’est fait l’écho d’une exposition dans une galerie parisienne, où étaient exposés ses derniers travaux, notamment des panneaux en bois noirci destinés à décorer une grande salle à manger dont un des fragments au décor japonisant vient d’être retrouvé.

Les tapis et les moquettes de Guimard
Dans la mesure où ses projets visaient à une décoration globale, Guimard s’est intéressé aux revêtements de sols, qu’il s’agisse de tapis ou de moquettes. Dès l’époque du Castel Béranger (1895-1898), il a fait exécuter plusieurs grands tapis par un fabricant dont le nom n’est pas encore connu avec certitude. La seule allusion bibliographique à ces tapis que nous connaissions est la planche de frontispice du portfolio du Castel Béranger publié à la fin de l’année[1] 1898 et sa légende (dans la table des planches) : « TITRE — composition pour tapis ».
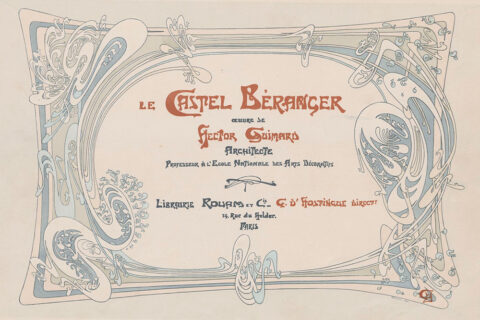
Planche de frontispice du portfolio du Castel Béranger, ETH-Bibliotheck Zürich.
En fait, leur dessin ne reprend qu’une partie de celui du frontispice : le coin inférieur gauche, reproduit par symétrie aux trois autres coins, ainsi que le motif central de la bordure inférieure, reproduit par symétrie à la bordure supérieure. Il est évidemment possible que Guimard ait au contraire enrichi et complexifié un carton initial de tapis pour composer le dessin du frontispice.
Ces tapis en laine qui sont très probablement les premiers modèles de style art nouveau à être apparus en France sont très rares. Ils n’étaient évidemment pas destinés aux locataires du Castel Béranger qui n’en avaient ni les moyens, ni la place dans des pièces aux dimensions assez modestes, mais à une clientèle d’amateurs fortunés. Deux d’entre eux ont été vendus sur le marché de l’art ces dix dernières années. L’un est de plus grandes dimensions : 4 m x 6 m.

Tapis par Guimard, fabricant inconnu, larg. 4 m, long. 6 m. Vente Sotheby’s Paris 24/11/2015, laine à points noués.
L’autre, plus petit, mesurant 3,45 m x 4,93 m, est une réduction du premier.

Tapis par Guimard, fabricant inconnu, larg. 3,45 m, long. 4,93 m. Vente Bonhams New York, 19/12/2024, lot 3w, laine à points noués. Coll. Hector Guimard Diffusion.
Tous deux sont en laine à points noués avec une coupe rase. Leur fond rouge orangé est encadré par des bordures jaune, orange clair et bleu pâle.

Tapis par Guimard, fabricant inconnu, larg. 3,45 m, long. 4,93 m. Vente Bonhams New York, 19/12/2024, lot 3w, laine à points noués. Coll. Hector Guimard Diffusion.
Le revers de ces tapis montre clairement la technique utilisée. L’effet de « pixellisation », due à l‘épaisseur des points, s’accommode difficilement des courbes de Guimard, mais il est atténué par les grandes dimensions de ces tapis.

Tapis par Guimard, fabricant inconnu, larg. 4 m, long. 6 m. Vente Sotheby’s Paris 24/11/2015, laine à points noués, restauration par Rugs & Tapestries, Padoue.
Aucun de ces deux exemplaires ne porte de mention du fabricant. Mais il est possible qu’il s’agisse de la maison Honoré Frères à qui la réalisation des tapis des trois escaliers du Castel Béranger[2] a été confiée en 1897. Leur aspect est connu par leur reproduction dans le portfolio du Castel Béranger où Guimard en a donné deux versions de coloration, l’une pour l’escalier du bâtiment sur rue (pl. 29), l’autre pour l’escalier du bâtiment sur cour (pl. 28). Sur ces reproductions colorisées, l’aspect de la surface est également compatible avec celle de tapis en laine à points noués. Étant donné leur largeur réduite et la finesse des motifs, leurs points étaient nécessairement de petite taille.
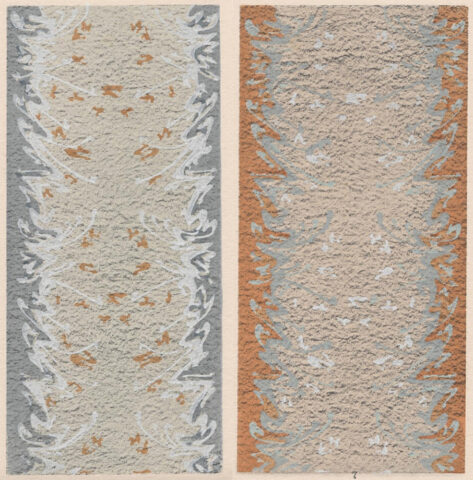
À gauche, tapis de l’escalier du bâtiment sur rue ; à droite tapis de l’escalier du bâtiment sur cour. Photomontage à partir des planches 28 et 29 du portfolio du Castel Béranger. Coll. Part.
Sur une même feuille de papier conservée dans le fonds Guimard déposé au musée d’Orsay, figurent deux dessins pour ces tapis, symétriques entre eux, avec la mention « Remis au Fabricant le 29 Mars 97 P. Honoré frères » ainsi qu’une signature simplifiée de Guimard.

Dessins pour les tapis des escaliers du Castel Béranger, mine graphite sur papier fort, haut. 0,342 m, larg. 0,244 m, mention au crayon : « Remis au Fabricant/le 29 Mars 97/P. Honoré frères » signature de Guimard. Don Association d’étude et de défense de l’architecture et des arts décoratifs du XXe siècle, 1995, GP 240, musée d’Orsay. © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Jean-Gilles Berizzi.
Mais il ne s’agit pas exactement du dessin des tapis reproduits dans le portfolio du Castel Béranger. Si nous isolons l’un des deux dessins, par exemple celui de droite, et que nous considérons l’une des deux bordures, on s’aperçoit que pour dessiner la bordure opposée, Guimard lui a fait effectuer une rotation à 180 °
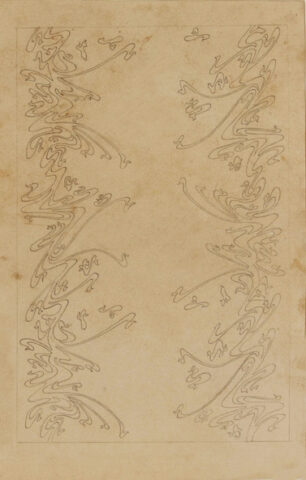
Moitié droite du dessin pour les tapis des escaliers du Castel Béranger, GP 240, musée d’Orsay. Les motifs centraux ont été effacés.
Alors que pour obtenir le dessin des tapis tels qu’ils ont en fait été exécutés, il a dupliqué l’une des deux bordures par symétrie sur un axe vertical.
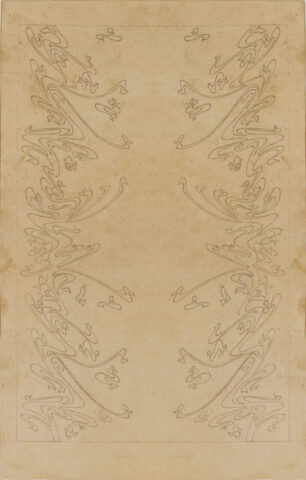
Photomontage sur la moitié droite du dessin pour les tapis des escaliers du Castel Béranger, GP 240, musée d’Orsay. Les motifs centraux ont été effacés.
Pour ces tapis d’escalier du Castel Béranger, Guimard a poussé le souci du détail jusqu’à la création d’un modèle original de pitons fixant les barres dont nous possédons plusieurs exemplaires.

Pitons des barres des tapis d’escalier du Castel Béranger. Coll. Part. Photo F. D.
Lors des restaurations effectuées en 2000, les tapis des escaliers ont été restitués de façon approximative et avec une couleur fautive pour l’escalier du hall du bâtiment sur rue.

État actuel après restaurations de l’escalier du hall du bâtiment sur rue du Castel Béranger. Photo F. D.
Quelques années plus tard, Guimard s’est adressé à la maison Parlant & Biron, représentée rue Poissonnière à Paris et dont les tissages mécaniques se trouvaient à Tourcoing. De même qu’il l’a fait dans d’autres domaines, dans une volonté de diffusion de ses créations et d’en abaisser le coût, il a obtenu l’édition de ses modèles sur catalogue. Celui qui est conservé à la Bibliothèque des Art Décoratifs ne comprend que quatre planches non numérotées dont tous les modèles sont de Guimard. Dans la mesure où il s’agit d’un don de sa veuve, on peut penser que les autres planches du catalogue en ont été ôtées de façon à simplement documenter l’œuvre de l’architecte.
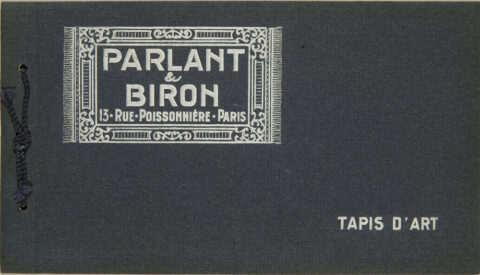
Couverture d’un catalogue Parlant & Biron, non daté. Bibliothèque des Art décoratifs. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.
Six modèles pour Parlant & Biron sont présentés sous la forme de tapis de largeur fixe 70 cm et vendus au mètre linéaire en trois qualités avec un prix de 7, 8 et 9 F-or. La matière utilisée et le type de tissage ne sont pas précisés.

Planche d’un catalogue Parlant & Biron, non daté. Bibliothèque des Arts décoratifs, modèles 13.663 – 9.359 ; 13.663 – 9.361 ; 3.366 – 9.341. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes. Le modèle du Castel Béranger est à droite.
On remarque que le modèle présenté du côté droit de cette planche semble être celui des escaliers du Castel Béranger, reproduit en camaïeu de gris avec une meilleure netteté que sur les deux planches du portfolio. Mais en fait, il s’agit cette fois du dessin d’origine (GP 240), avec ses bordures asymétriques.
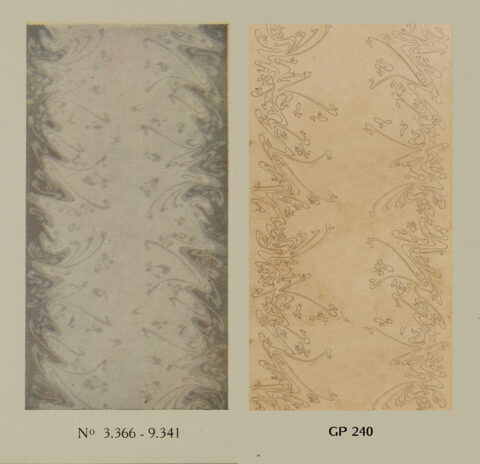
Photomontage du modèle 3.366 – 9.341 d’une planche d’un catalogue Parlant & Biron et d’une partie du dessin GP 240.
Pour l’autre modèle de cette planche présenté en deux colorations, il existe deux études aquarellées de Guimard dans le fonds de documents donné par Adeline Oppenheim Guimard à la Bibliothèque des Arts décoratifs en 1948.

Projet pour un tapis, non signé, non daté, aquarelle sur papier, Bibliothèque des Arts décoratifs, Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.
Sur une seconde planche du catalogue Parlant& Biron, un troisième modèle est décliné en trois couleurs. De même que pour les deux modèles présentés ci-dessus, ses bordures nettement accentuées le désignent comme un tapis d’escalier ou un tapis de passage pour un couloir.
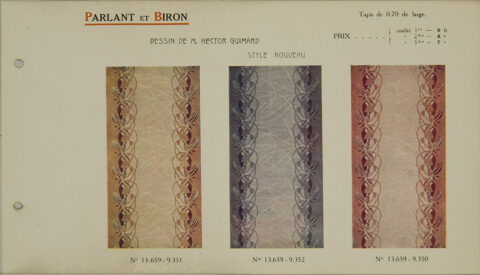
Planche d’un catalogue Parlant & Biron, non daté. Bibliothèque des Arts décoratifs, modèles 13.659 – 9.350 ; 13.659 – 9.351 ; 13.659 – 9.352. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.
Au contraire, les trois autres modèles présents sur les deux autres planches ne présentent pas de bordures et sont conçus de façon à se raccorder (comme un papier peint) pour pouvoir, par juxtaposition, couvrir de grandes surfaces et jouer le rôle d’une moquette.
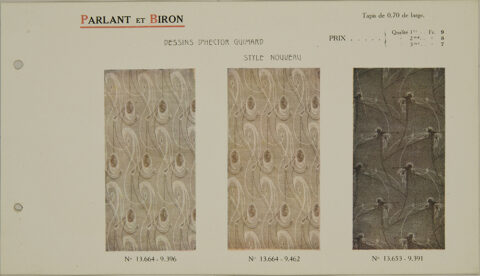
Planche d’un catalogue Parlant & Biron, non daté. Bibliothèque des Arts décoratifs, modèles 13.664 – 9.396 ; 13.664 – 9.462 ; 13.653 – 9.391. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.
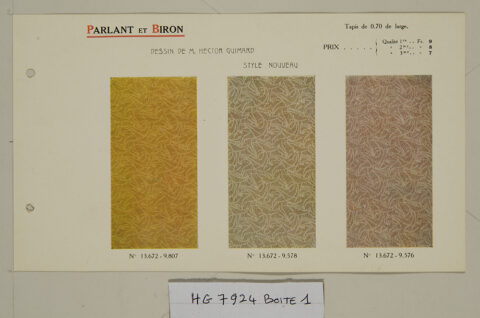
Planche d’un catalogue Parlant & Biron, non daté. Bibliothèque des Art décoratifs, modèles 13.672 – 9.576 ; 13.672 – 9.578 ; 13.672 – 9.807. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.
Il nous semble intéressant de nous pencher sur les numéros de référence de ces six modèles et de leurs variantes :
3.366 – 9.341 pour le modèle du Castel Béranger.
13.663 – 9.359 et 13.663 – 9.361 pour le modèle à bordures présent sur la même planche.
13.659 – 9.350 ; 13.659 – 9.351 ; 13.659 – 9.352 pour un modèle à bordures sur une seconde planche.
13.664 – 9.396 et 13.664 – 9.462 pour un modèle à raccord sur une troisième planche.
13.653 – 9.391 pour un modèle à raccord sur cette troisième planche.
13.672 – 9.576 ; 13.672 – 9.578 et 13.672 – 9.807 pour un modèle à raccord sur une quatrième planche.
Les quatre derniers chiffres après le tiret différencient les variantes de couleurs de modèles identiques. Nous ne connaissons pas la signification du chiffre 9. Quant aux groupes de chiffres avant le tiret, ils désignent les modèles. De plus, nous émettons l’hypothèse suivante : le ou les chiffres avant le point pourraient désigner l’année d’entrée du modèle dans le catalogue de Parlant & Biron. Ainsi, le modèle du Castel Béranger (3.366) serait entré en 1903 et tous les autres modèles seraient entrés en 1913, c’est à dire au moment où Guimard aménageait son hôtel particulier. Nous aurions ainsi une plage temporelle d’une décennie (de 1903 à 1913) de collaboration entre Guimard et Parlant & Biron. Gardons à l’esprit que cette date de 1913 n’est pas nécessairement celle de la création de ces cinq modèles et que Guimard a pu disposer de leur production par Parlant & Biron avant qu’elle ne soit éditée sur catalogue.
Plusieurs photographies montrent l’utilisation de ces tapis par Guimard. L’une d’elles, non datée, est probablement une vue prise au sein des ateliers de Guimard. On y voit clairement le tapis à bordure 13.659 et plus difficilement, sous le bureau et la chaise, le tapis à raccord 13.653.

Probable aménagement au sein des ateliers de Guimard (détail) avec les tapis 13.659 et 13.653, tirage ancien sur papier, non daté. Don Adeline Guimard-Oppenheim, 1948. Bibliothèque des Arts décoratifs. Photo Laurent Sully Jaulmes.
Des morceaux du même tapis à raccord 13.653 apparaissent aussi sur d’autres photographies prises dans des conditions similaires.

Probable aménagement au sein des ateliers de Guimard avec le tapis 13.653, tirage ancien sur papier, non daté. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Bibliothèque des Arts décoratifs. Photo Laurent Sully Jaulmes.
Enfin, deux de ces modèles de tapis à raccord apparaissent sur les photographies prises au sein de l’hôtel Guimard : à nouveau le 13.653, utilisé en moquette pour la chambre.

Détail d’un cliché de la chambre à coucher de l’hôtel Guimard, détail avec le tapis 13.653, tirage ancien sur papier, c. 1913. Coll. Part.
Et le 13.672, utilisé en moquette pour la salle à manger.

Détail d’un cliché de la salle à manger de l’hôtel Guimard, détail avec le tapis 13.672, tirage ancien sur papier, c. 1913. Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Archives de Paris 3115W 10.
Parallèlement à cette diffusion à visée industrielle, Guimard a continué à concevoir des grands tapis. Nous en avons l’écho par une esquisse aquarellée au dessin particulièrement riche, voire suggestif. Non datée, mais pouvant être située à partir de 1903, elle est conservée à la Bibliothèque des Arts décoratifs.

Projet pour un tapis, non signé, non daté, aquarelle sur papier, Bibliothèque des Arts décoratifs, Don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.
On voit donc que les tapis et moquettes de Guimard ont suivi son évolution stylistique avec des modèles qui, pour certains, pouvaient parfaitement être intégrés sans heurt dans des intérieurs modernes.
Frédéric Descouturelle
Notes
[1] Guimard, Hector, L’Art dans l’habitation moderne/Le Castel Béranger, Paris, Librairie Rouam, 1898.
[2] Leur nom figure dans la liste des fournisseurs placée en tête du portfolio : « HONORÉ FRÈRES — Tapis. ».

Parution du livre consacré à l’architecte Jules Lavirotte
La dernière publication du Cercle Guimard est à présent disponible dans trois librairies parisiennes et bientôt dans d’autres établissements.

Deux librairies spécialisées :
– Le Cabanon, 122 rue de Charenton, 75012 Paris
– Librairie du Camée, 70 rue Saint André des Arts, 75006 Paris
ainsi qu’à la librairie Villa Browna, idéalement située 27 avenue Rapp, mitoyenne de l’immeuble phare de Lavirotte.
Une dédicace aura lieu le 17 juin à 19h 15 à la libraire Le Cabanon, en présence des auteurs.

Immeuble Logilux, 1904 (Céramic hôtel), 34 avenue de Wagram. Photo F. D.
Rappelons également que l’exposition consacrée à Jules Lavirotte à Évian est ouverte du 1er juin au 30 septembre 2025, à la villa du Châtelet où le livre est également disponible.
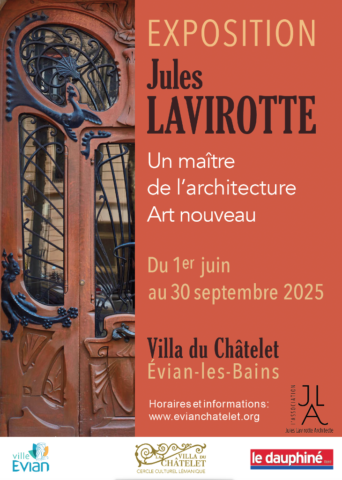
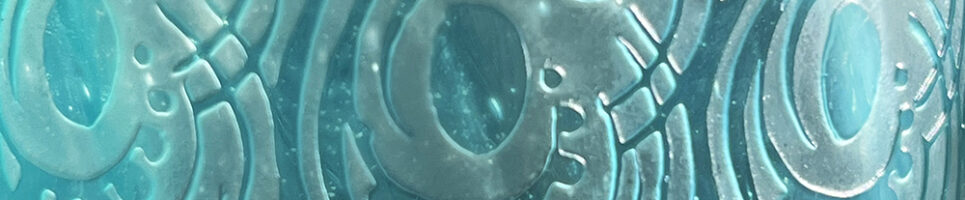
Un rare vase en cristal de Guimard
Pisté depuis des années, ce vase exceptionnel est tout récemment entré dans les collections de notre partenaire pour le projet de musée Guimard. Des négociations au long cours ont abouti à l’acquisition de cet objet rare, le premier de son genre à être identifié et décrit. Contrairement à d’autres domaines des arts décoratifs où Guimard a abondamment créé, il a en effet très peu produit pour la verrerie.

Vase Guimard de la Cristallerie de Pantin, haut. 40,2 cm, diamètre extérieur au niveau de l’ouverture : 5,2 mm, diamètre extérieur à la base : 12,7 cm, poids, 1,437 kg. Coll. part. Photo F. D.
La forme générale est celle, assez banale pour la verrerie de style Art nouveau, d’un « vase bouteille » pouvant se décomposer en trois parties : une base très aplatie soulignée par un ressaut, un fût très légèrement conique et un rétrécissement sommital avant l’inflexion de l’ouverture vers l’extérieur. Cette forme, pourvue de côtes tournoyantes, semble inédite chez Guimard qui n’a pas tenté de reproduire les silhouettes de ses modèles conçus pour le bronze ou pour la céramique. Mais comme nous le verrons plus loin, sommes-nous certains que Guimard soit l’auteur de cette forme ?
Ce vase est longtemps resté dans la famille du vendeur, mais il n’a pas été possible d’en connaitre les conditions d’achat originelles. Il est en bon état, malgré quelques griffures et la marque d’un léger dépôt calcaire montrant qu’il a été utilisé à une époque comme vase à fleurs.
Il a été produit à la Cristallerie de Pantin[1], comme l’indique la signature gravée en intaille à son culot, autour du logo « STV » reprenant les initiales du nom exact de la cristallerie : Stumpf, Touvier, Viollet & Cie.
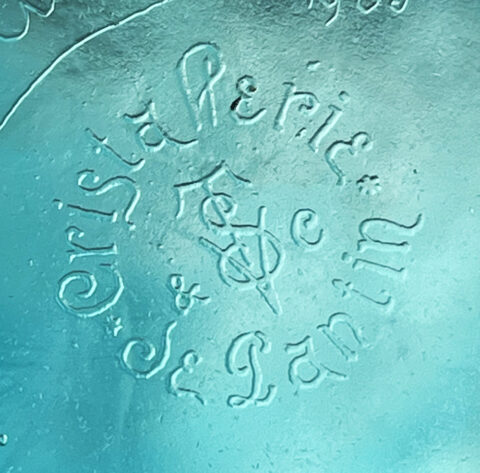
Signature de la Cristallerie de Pantin au culot du vase. Coll. part. Photo Justine Posalski.
Haut de 40,2 cm et pesant 1,437 kg, il a un volume de 0,480 litre. Ces deux dernières données permettent de calculer sa densité : 2,99, très proche de celle du cristal au plomb classique (3,1).

Calcul du volume du vase Guimard de la Cristallerie de Pantin. Coll. part. Photo Fabien Choné.
La question de la nature exacte de son matériau se posait, même si le vase provient d’une cristallerie, car nous avons établi que les verrines des candélabres des accès du métro produites par cette même cristallerie à partir de 1901 étaient en verre, sans ajout de plomb. Le Cercle Guimard en a récemment acheté un exemplaire.

Verrine d’un candélabre du métro Guimard. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.
Le culot du vase est également porteur de la signature manuscrite et cintrée de Guimard. Elle est caractérisée par la continuité du graphisme en un seul trait joignant le prénom et le nom et se terminant par le long paraphe revenant les souligner. On note que son exécution à la pointe est un peu plus hésitante que celle du logo de la cristallerie pour lequel l’ouvrier affecté à cette tâche répétitive disposait d’un pochoir.

Signature de Guimard au culot du vase de la Cristallerie de Pantin. Photo Justine Posalski.
Le millésime « 1903 » figure également sous la signature et nous renvoie à l’époque du pavillon que Guimard a édifié au sein de la nef du Grand Palais pour l’Exposition de l’Habitation cette année-là. À cette occasion il a fait éditer la série de cartes postales Le Style Guimard reproduisant ses principales œuvres architecturales.

Le pavillon « Le Style Guimard » au sein de l’Exposition de l’Habitation au Grand Palais en 1903. Carte postale ancienne n° 1 de la série Le Style Guimard. Coll. part.
Dans la liste des collaborateurs qui figure sur le prospectus joint à l’emballage de la série de ces cartes postales, on retrouve la mention de la Cristallerie de Pantin, au 66 rue d’Hauteville, lieu de son dépôt parisien.
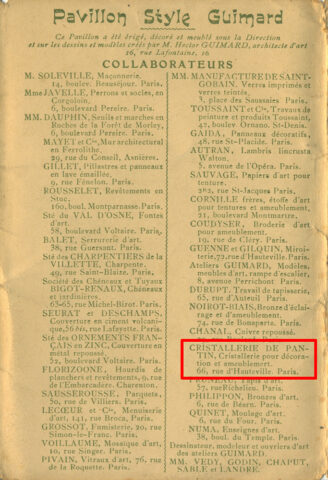
Vue partielle du prospectus de l’emballage de la série des cartes postales Le Style Guimard. Coll. part.
La cristallerie figurait dans cette liste de collaborateurs, d’une façon certaine pour les verrines du portique d’accès de métro qui encadrait l’entrée du pavillon de Guimard, et sans doute aussi pour un autre produit exposé : probablement des vases, comme le suggère le descriptif que Guimard a associé au nom du fournisseur : « cristallerie pour décoration et ameublement ». Mais les vues de l’intérieur du pavillon que nous connaissons ne montre pas malheureusement pas ces vases. D’ailleurs, rien n’indique qu’à cet instant les cristaux présentés dans le pavillon étaient déjà le fruit d’une collaboration entre l’architecte et la Cristallerie de Pantin. Guimard a pu tout simplement choisir des produits de la cristallerie sur catalogue afin de décorer les meubles exposés. L’année suivante, en revanche, nous avons acquis la certitude que cette collaboration a abouti. Dans l’opuscule que Guimard a édité à l’occasion du Salon d’automne de 1904, il a détaillé son envoi par catégories. Le numéro 4 des « Objets d’art Style Guimard » est décrit de la façon suivante : « Vase Style Guimard en cristal aigue marine. Prix : 65 francs ».
Cette dénomination « aigue-marine » n’a pas été inventée par Guimard qui, au contraire, s’est inséré dans une production de la Cristallerie de Pantin qui avait démarré quelques années plus tôt. Elle fait bien sûr référence au nom de la pierre fine, une variété de béryl, de couleur bleu clair, évoquant la mer. Ces nuances bleutées, difficiles à obtenir, ont été recherchées de façon empirique par différentes cristalleries françaises. Émile Gallé à Nancy a ainsi obtenu avec un monoxyde de cobalt une couleur d’un bleu très léger nommée « clair de lune », dévoilée à l’Exposition universelle de 1878. À la Cristallerie de Pantin, pour obtenir un verre légèrement opacifié à irisations intermédiaires turquoises, le jaune du dioxyde d’urane et le vert d’un oxyde de chrome ont été mêlés au bleu de cobalt.
La première mention de production de cristaux « aigue-marine » par la Cristallerie de Pantin que nous connaissons a fait l’objet d’une page du catalogue de la Maison Moderne[2] paru en 1901.
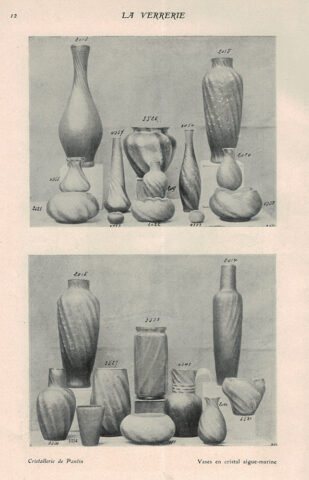
Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle (catalogue de La Maison Moderne), Paris, Edition de La Maison Moderne, 1901, p. 12, « Crisallerie de Pantin/Vases en cristal aigue-marine ». Coll. part.
Sur les deux photographies de cette page, vingt-deux vases de différentes formes et d’une couleur qui ne peut être que bleutée présentent tous des côtes tournoyantes, souvent régulièrement ponctuées de reliefs comme le sont les surfaces des coquillages, autre manière de rappeler l’inspiration marine de la série. Le ou les auteurs de ces formes modernes ne sont pas mentionnés, signe qu’il s’agit probablement d’employés de la cristallerie[3].
Le vase en cristal de Guimard ne nous était pas complètement inconnu puisque les documents de la donation Adeline Oppenheim-Guimard conservés à la Bibliothèque des Arts Décoratifs permettent d’en identifier au moins deux exemplaires décorant un meuble probablement présenté au Salon d’Automne.

Coll. Bibliothèque des Arts Décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.
Au sein du même ensemble documentaire, un autre modèle de vase torsadé, avec une base plus piriforme et un col plus effilé, est très proche du n° 4357 de la page du catalogue de la Maison Moderne (cf. supra). L’intervention de Guimard n’y est pas pour autant attestée.

Coll. Bibliothèque des Arts Décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.
Autre exemple de vase qui pourrait provenir de la Cristallerie de Pantin, le modèle en cristal translucide présenté dans la vitrine du grand salon de l’hôtel Guimard reprend le même type de torsades.

Détail de la vitrine du grand salon de l’hôtel Guimard. Coll. part.
On notera qu’aucun de ces vases ne présente de décor floral surajouté imitant le style des verreries nancéiennes Gallé et Daum. Il s’agit peut-être d’une demande expresse de la Maison Moderne, exigeant une certaine sobriété plus conforme à la ligne belge de Van de Velde qu’elle défend. Car, en dehors de la Maison Moderne, la Cristallerie de Pantin a produit de nombreux modèles de vases « aigue-marine » à décor floral que l’on retrouve de temps à autre sur le marché de l’art.

Vase « aigue-marine » à décor floral gravé à l’acide de la Cristallerie de Pantin, galerie en ligne les_styles_modernes, vente sur eBay Pays-Bas, mai 2025, haut. 24,8 cm, diam. 10,3 cm, poids, 796 g. Photo les_styles_modernes, droits réservés.

Vase « aigue-marine » à décor floral gravé à l’acide de la Cristallerie de Pantin, galerie en ligne les_styles_modernes, vente sur eBay Pays-Bas, mai 2025, haut. 24,8 cm, diam. 10,3 cm, poids, 796 g. Photo les_styles_modernes, droits réservés.
Comme ces vases, celui de Guimard possède lui aussi un décor gravé à l’acide, mais qui lui est propre et qui témoigne des recherches qu’il a menées pour renouveler son style semi-abstrait en s’éloignant progressivement des arrangements harmoniques de lignes courbes ou capricieuses qui le caractérisaient autour de 1900.

Détail du décor du vase Guimard de la Cristallerie de Pantin. Coll. part. Photo F. D.
Encore une fois, il n’est pas simple de décrire ou d’interpréter ce décor qui laisse l’imagination de l’observateur trouver ses propres références. Si une inspiration végétale parait toujours présente avec des tiges et des fleurs fortement stylisées et répétées dix fois sur la circonférence, un motif s’inspirant de la clef de sol n’est pas impossible.
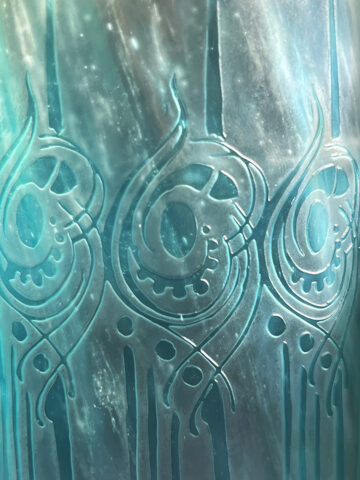
Détail du décor du vase Guimard de la Cristallerie de Pantin. Coll. part. Photo F. D.
Certains des dessins aquarellés de projets de frises, non datés, donnés par sa veuve Adeline Oppenheim au Musée des Arts Décoratifs présentent quelques similitudes stylistiques.

Guimard, détail d’un projet pour une frise, aquarelle sur papier. Coll. Bibliothèque des Arts Décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.
D’autres éléments du décor comme les filets bleus ou la coloration jaune en partie haute nous permettent d’avancer des hypothèses quant au processus de fabrication du vase. Comme pour toute fabrication, le verrier cueille dans le four une paraison avec sa canne creuse et lui donne une première forme ébauchée par soufflage et balancement. Puis il roule la paraison sur le « marbre » (une table en fonte dépolie) pour lui adjoindre des poudres d’os calcinés et d’arséniates qui y ont été préalablement disposés et qui donneront au verre un aspect satiné sur toute la hauteur du vaisseau ainsi qu’une coloration jaune au niveau de son quart supérieur. De plus, des filets bleus également torsadés, visibles en partie supérieure et en partie inférieure du vase, ont été préparés à l’avance, posés puis recouverts d’une nouvelle couche de verre reprise dans le four. Il s’agit donc d’un décor intercalaire et non de la technique habituelle des filets vénitiens qui sont plaqués en surface.

Col du vase Guimard de la Cristallerie de Pantin avec les filets bleus intercalaires. Coll. part. Photo F. D.

Base du vase Guimard de la Cristallerie de Pantin avec les filets bleus intercalaires. Coll. part. Photo F. D.
Le vaisseau de verre étant toujours au bout de la canne (du côté de la future ouverture), la base est ébauchée par gravité et tamponnement contre le marbre. Puis il est introduit dans le moule bivalve et soufflé de façon à être plaqué sur les parois. C’est à ce moment que l’essentiel des reliefs tournoyants est donné. Une fois le moule ouvert, le vaisseau est repris sous la base à l’aide d’une petite masse de verre en fusion au bout d’une barre de fer (le pontil). Du côté opposé, le col reçoit une torsion (comme en témoigne la disposition des bulles d’air qui suivent ce mouvement) avant d’être détaché de la canne en le coupant aux ciseaux et en le façonnant à la pince.

Col du vase Guimard de la Cristallerie de Pantin. Coll. part. Photo Justine Posalski.
Après un léger refroidissement qui assure sa stabilité, le vaisseau est enrobé d’une couche mince d’un verre d’un bleu plus intense que le verrier va cueillir dans un second four. Le vase est alors détaché du pontil qui lui laisse une cicatrice sous la base. Après un refroidissement progressif, il reçoit un traitement à l’acide fluorhydrique du verre bleu plaqué en surface. Pour dégager le décor qui sera conservé en bleu, on a préalablement protégé sa surface par un vernis (à cette époque du bitume de Judée), tandis que les surfaces non protégées sont éliminées par l’acide jusqu’à faire apparaitre le verre sous-jacent. Sous la base, la trace du pontil est effacée par meulage et polissage pour pouvoir y graver le logo de la cristallerie et la signature de Guimard comme nous l’avons vu plus haut. En revanche, au niveau de l’ouverture, les irrégularités de surface qui subsistent montrent que le verre n’a pas été retravaillé par meulage.

Col du vase Guimard de la Cristallerie de Pantin. Coll. part. Photo F. D.
Si ce vase est parvenu si tardivement à la connaissance des spécialistes de Guimard, c’est tout d’abord en raison de sa rareté. Son exécution encore imparfaite, visible notamment par son bullage assez conséquent, semble indiquer qu’il a fait partie d’une série qui a été des plus réduite. L’autre raison est que son attribution à Guimard n’est pas évidente au premier regard. Il est même probable qu’en l’absence de signature[4] et malgré son décor naturaliste abstrait, ce vase n’aurait pas sans doute pas suscité le même intérêt de notre part, ni les recherches qui en ont découlé pour retrouver les rares indices permettant de le localiser au sein de l’œuvre de Guimard. En même temps qu’il a eu la volonté de simplifier le Style Guimard en le résumant à un simple décor sur un objet pouvant s’accommoder finalement de tous les styles d’intérieurs, il est tout à fait probable que Guimard ait aussi fait le choix d’une forme de vase déjà existante à la Cristallerie de Pantin — forme qui n’était d’ailleurs pas nécessairement déjà commercialisée — et qu’il l’ait « guimardisée », reproduisant en cela la même démarche qu’avec les produits de certains autres fabricants comme nous l’avons démontré pour les vases en grès édités par Gilardoni & Brault[5].
Frédéric Descouturelle et Olivier Pons,
avec l’aide de Justine Posalski et de Georges Barbier-Ludwig.
Notes
[1] La cristallerie a été fondée en 1847, au 84 de la rue de Paris à Pantin et reprise en 1859 par E. Monot, ancien ouvrier de la cristallerie de Lyon. Elle a rapidement prospéré, devenant la cinquième cristallerie française puis, après la guerre de 1870 (et le passage de la cristallerie de Saint-Louis en territoire allemand), la troisième (après Baccarat et Clichy). La cristallerie usinait industriellement une gamme complète de produits qu’elle exposait dans son magasin parisien de la rue de Paradis. Son dépôt était également à Paris, au 66 rue d’Hauteville. La raison sociale a évolué : « Monot et Cie », puis « Monot Père et Fils et Stumpf », puis « Stumpf, Touvier, Viollet & Cie » après le retrait de Monot en 1889. Elle a été absorbée en 1919 par la verrerie Legras (Saint-Denis et Pantin Quatre-Chemins).
[2] Fondée par le critique d’art Julius Meier-Graefe à la fin de l’année 1899, cette galerie consacrée à l’art décoratif moderne entrait en concurrence avec celle plus connue de Siegfried Bing, L’Art Nouveau. Deux articles lui seront très prochainement consacrés par Bertrand Mothes.
[3] Pour d’autres produits, le catalogue indique le nom des auteurs des modèles. Dans ce cas, on peut penser que le contrat passé entre la galerie et l’auteur spécifiait que le nom de ce dernier devait être mentionné.
[4] Un autre exemplaire de ce vase a été répertorié et figure dans l’ouvrage « Le génie verrier de l’Europe » (G. Cappa, éd. Mardaga, 1998). Contrairement à notre vase à la couleur « aigue-marine » dominante, celui-ci se caractérise par un cristal incolore doublé de métallisations dégradées faisant davantage la part belle aux nuances « rosathea » et « jaune » tandis que la tonalité « aigue-marine » se concentre sur un petit tiers inférieur. Cet exemplaire ne présentant pas de signature, il est possible qu’il s’agisse d’un prototype.
[5] Cf. notre article sur la « guimardisation » des vases en grès édités par Gilardoni & Brault.

Camille Gauthier à Nancy, de collaborateur de Louis Majorelle à fabricant de meubles à bon marché
Notre amie Justine Posalski, membre du Cercle Guimard depuis plusieurs années, vient d’obtenir son doctorat en histoire de l’Art qui a porté sur la carrière de l’un des acteurs majeurs de l’École de Nancy, Camille Gauthier (1870-1963). Son nom a été popularisé par la marque « Gauthier-Poinsignon » et par son importante production de meubles modernes à bon marché que nous avons déjà évoquée ici, mais sa biographie avait été encore peu explorée. À la demande de son directeur de thèse, Justine Posalski a exploré le côté social et innovant de l’activité commerciale de Gauthier, notamment par sa technique de vente. Cependant, ses recherches l’ont conduite à s’intéresser de plus près au contexte dans lequel se sont nouées ses relations avec Louis Majorelle (1859-1926). C’est cet aspect peu connu et qui remet en question certaines opinions acquises que nous lui avons proposé de présenter dans cet article.
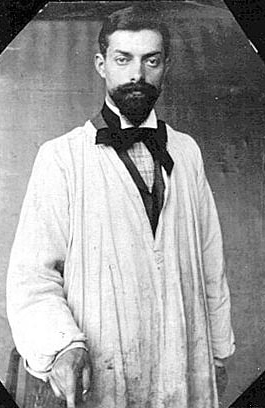
Anonyme, portrait de Camille Gauthier, tirage photographique d’époque. Coll. Musée de l’École de Nancy.
Jusqu’à présent, les exégètes de Majorelle, assez discrets sur le sujet, se contentaient de considérer que Camille Gauthier n’avait joué qu’un rôle mineur de simple collaborateur subalterne. Mais la lecture de missives des archives personnelles de la fille de Camille Gauthier indique que son père avait été recruté au sein de la firme nancéienne pour y exercer les fonctions de directeur artistique. Faute d’archives consultables, il convient donc d’examiner plus attentivement les éléments chronologiques qui permettent de rééquilibrer le rôle de chacun.
Initialement fondée à Toul par Auguste Majorelle (1825-1879), la société Majorelle a été transférée à Nancy en 1861. Après le décès de son père, Louis Majorelle a interrompu ses études à l’École nationale des Beaux-Arts de Paris pour revenir à Nancy et s’occuper de l’entreprise familiale qui bénéficie alors d’une réputation solidement établie et d’une popularité qui est synonyme d’excellente marche des affaires. À la céramique qui est à l’origine du succès du fondateur, se sont ajoutées la fabrication de meubles décorés au vernis Martin et la vente de reproductions de mobilier de style qui ont renforcé le renom de la firme nancéienne. Le goût de Louis Majorelle pour la peinture et sa proximité avec la jeune garde des peintres lorrains vont le conduire à s’orienter vers une politique de création novatrice, en associant ses anciens condisciples à la production d’œuvres d’exception.
En 1882, il sollicite le peintre Émile Friant (1863-1932) afin que ce dernier réalise la décoration de la porte d’un meuble sur le thème du roman de Miguel de Cervantes Don Quichotte de la Manche. En 1886, il s’adresse aux frères Jules (1833-1887) et Léon Voirin (1833-1898) pour réaliser l’ornementation de la face intérieure d’un paravent destiné à la cour royale des Pays-Bas. Les frères Voirin, en collaboration avec Majorelle, réalisent cinq paravents. Le succès est tel que Majorelle sollicitera la fratrie pour exécuter cinq autres paravents. Pour l’Exposition universelle de 1889, c’est un somptueux lit traineau néo-Louis XV dont les panneaux sont décoré au vernis Martin d’après Watteau qui attire l’attention sur la maison Majorelle.
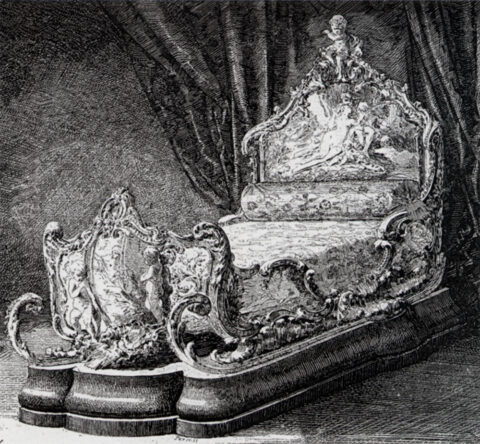
Maison Majorelle, lit traineau présenté à l’Exposition Universelle de 1889, décoré d’après Watteau.
L’année 1893 s’avère être un tournant dans l’évolution de la maison Majorelle. Sur un plan juridique, la société en nom collectif prend alors la dénomination de « Majorelle Frères ».
Cette même année, Camille Gauthier, né dans les environs de Nancy, élève à l’École des Beaux-Arts de Nancy puis pendant trois ans à l’École nationale des Arts Décoratifs de Paris[1], regagne sa province d’origine pour être embauché par Louis Majorelle qui se consacre désormais exclusivement à la direction artistique de la firme familiale. Ce dernier a pressenti qu’il était dans l’air du temps d’abandonner les modèles d’un passé révolu afin — à l’instar d’Émile Gallé — de se tourner résolument en direction de la modernité. Il a compris que l’avenir ne saurait se contenter de la répétitivité sclérosante du mobilier créé par son père et qu’il convenait de donner à ses ateliers une toute nouvelle impulsion. Camille Gauthier qui a alors vingt-trois ans a été en contact avec ce qui se faisait de plus avant-gardiste dans la capitale. Le jeune homme semble posséder toutes les qualités nécessaires pour l’aider à relever de nouveaux défis. Son engagement chez Majorelle est d’ailleurs concomitant et symétrique à celui de Jacques Gruber chez Daum[2]. Ces deux émules d’Émile Gallé dans le domaine de l’ébénisterie et de la verrerie de style moderne ont ainsi misé sur de jeunes artistes lorrains mais dont la formation avait été parachevée dans la capitale. Il est également à noter que, quelques années plus tard, d’autres influences purement parisiennes comme celles de Tony Selmersheim ou d’Henri Sauvage ont marqué l’évolution moderne du mobilier de Majorelle.
Un examen attentif d’un catalogue commercial illustré titré « Majorelle Nancy » [3], postérieur à 1890 mais antérieur à l’exposition de 1894, nous fournit un certain nombre d’indications fiables[4] sur le virage moderne de la maison Majorelle. On y constate que l’ameublement n’est pas parmi les catégories les plus mises en avant. Il ne représente qu’un faible pourcentage des produits proposés à la vente, n’apparaissant qu’à la page 48 et se terminant à la 57ème et dernière page du recueil. L’offre débute par de l’ameublement en bambou et natte de Chine, et il est précisé d’emblée que la chambre à coucher est un modèle déposé. Sont ensuite proposés des petits meubles en noyer ciré tels que tables, guéridons, colonnes, gaines, selles[5], etc. Viennent ensuite une page consacrée au « meuble de fantaisie » à la décoration brevetée au Vernis Martin, et en complément une page réservée à l’ébénisterie d’art « style japonais » dont les modèles peuvent être vendus « en bois blanc ou laqués pour être décorés ». Les quatre pages finales concernent une série de mobilier plus classique, dans un style d’esprit rocaille, Louis XVI, rococo ou pseudo Henri II. Il est indiqué que l’ancienne maison Montigny a pour successeur Majorelle dont les magasins et ateliers sont situés à Nancy.
En revanche, en 1894, concurremment avec du mobilier de style Louis XV, Louis XVI et Empire, Majorelle expose, sur son stand de l’Exposition d’art décoratif et industriel lorrain, qui se déroule dans les galeries de la salle Poirel[6], des « meubles d’inspiration moderne ». Outre un plateau de table en bois pyrogravé, on peut admirer une table intitulée La Source, réalisée d’après des dessins de Jacques Gruber (1870-1936), ainsi qu’un meuble composé par Camille Gauthier.

Anonyme, photographie du stand de Louis Majorelle à l’exposition de 1894 aux galeries Poirel, Nancy. Coll. Musée de l’École de Nancy. Au mobilier majoritairement « de style » viennent s’ajouter quelques « meubles d’inspiration moderne ».
Ces éléments sont tout à fait révélateurs du fait qu’avant le recrutement de Camille Gauthier, Majorelle n’est aucunement impliqué dans le mouvement esthétique moderne et se contente de commercialiser une gamme de produits en tous points identiques à ceux en vogue sous le Second Empire. Quoi qu’il en soit, l’arrivée de nouvelles recrues dans la firme nancéienne marque une vraie rupture avec le mobilier quelque peu emphatique pour ne pas dire suranné qui, quelques mois auparavant, marquait l’identité de la maison. De fait, avant 1894, jamais Majorelle n’avait vendu ou réalisé de mobilier orné de marqueterie de bois de placage. Au contraire, après 1894, on ne trouvera plus aucune mention d’un quelconque meuble décoré au vernis Martin.
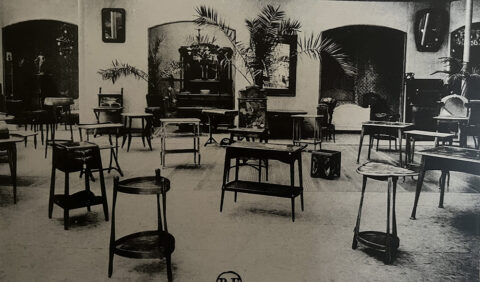
Anonyme, photographie du Magasin Majorelle, rue Saint-Georges à Nancy, vue de la salle d’exposition du 1er étage, c. 1900. Coll. bibliothèque Forney.
À son retour à Nancy, Gauthier décide de se rallier au mouvement de renouveau artistique lorrain car il le comprend comme un projet de société revendiquant le passage à un art total d’où ne serait pas exclue la dimension sociale. Pour ce jeune homme, l’Art nouveau en général et le mouvement de renouveau artistique lorrain en particulier, sont porteurs d’un projet à la fois artistique, éthique, social et politique.
Pour Majorelle, la décision de se lancer dans la production de mobilier moderne est essentiellement un choix entrepreneurial qui doit induire une réforme et une diversification rapide de la société familiale. Le choix de se consacrer à un style nouveau, en adéquation avec des impératifs de rentabilité et de conquête de parts de marché, suppose de passer d’un atelier artisanal à une fabrication rationalisée impliquant une dimension de plus forte mécanisation. Pressentant que l’avenir réside forcément dans une proposition plus adaptée à la demande du public, la maison Majorelle va apporter un soin particulier à élaborer des modèles de petits meubles à bon marché. Augmenter le volume de fabrication ne fait pas surhausser considérablement les coûts de production et, en dépit des dépenses financières liées à de nouvelles installations, l’accroissement des ventes devrait permettre de rentabiliser rapidement les investissements qu’il convient d’effectuer au plus vite.
Dès son entrée au sein des ateliers Majorelle, Gauthier se familiarise promptement avec le métier d’ébéniste en réussissant à trouver le point d’équilibre entre ses ambitions artistiques et les impératifs de la réalité économique inhérents à la bonne marche d’une entreprise. Son activité principale consiste à dessiner les compositions décoratives ornant les meubles marquetés. Très rapidement, c’est à Gauthier que sera confiée la création du mobilier d’exposition qui doit assurer la notoriété et le prestige de la firme nancéienne. Avec une application constante, Gauthier va appréhender les multiples paramètres techniques permettant de concevoir une production originale de meubles innovants et audacieux, précieux et raffinés mais sachant éviter les écueils de l’afféterie ou de l’ostentatoire.

Louis Majorelle et Gautier (sic) projet pour la décoration d’un salon (fragment). Victor Antoine Champier (1851-1929), Documents d’atelier. Art décoratif moderne, Paris, Librairie Rouan, 1899, pl. XXXI. Coll. part.

Louis Majorelle et Gautier (sic) : projet de cabinet à objets d’art. Victor Antoine Champier (1851-1929), Documents d’atelier. Art décoratif moderne, Paris, Librairie Rouan, 1899, pl. XVII. Coll. part.
C’est à partir de 1897, date du transfert des ateliers de la rue Girardet à la rue du vieil-Aître que l’on assiste véritablement à une transformation de Majorelle qui passe du statut d’artisan d’importance à celui d’industriel d’art. Ainsi, afin de réaliser en série des produits manufacturés de qualité, il était indispensable de posséder un lieu suffisamment conséquent pour accueillir les volumineuses machines modernes qui allaient permettre de répondre à la volonté de Majorelle de devenir un entrepreneur de stature nationale dans le secteur de l’ameublement. Les nouvelles installations sont dimensionnées pour accueillir un personnel conséquent. Camille Gauthier avait jusqu’ici évolué au sein d’une entreprise à caractère quasi-familial entouré par des ouvriers et compagnons fidèles et expérimentés, présents depuis les débuts d’Auguste Majorelle. Il va devoir désormais vivre au quotidien dans un environnement où interagissent plus de cent cinquante intervenants[7]. Parallèlement à l’utilisation de nouveaux procédés, les techniques courantes de l’ébénisterie et de la menuiserie sont bousculées pour se plier aux besoins d’une création originale. Les productions des ateliers Majorelle présentent un large éventail des techniques utilisées dans l’histoire de la marqueterie. Les procédés et les matériaux employés en révèlent une parfaite connaissance.
Gauthier mêle les essences du pays aux bois exotiques en conservant les particularités des ronces, loupes ou gales. Assurément, les dessins naturels des essences permettent de donner du tempérament à la composition, notamment dans le rendu des matériaux. Outre le dessin du veinage et la couleur des bois, le choix du débit des placages permet effectivement de multiplier les effets. Gauthier, loin d’être fidèle à un unique procédé, fait feu de tout bois et multiplie les expériences pour varier les aspects à obtenir.

Majorelle Frères & Cie, trumeau de cheminée, composition marquetée par Camille Gauthier, haut. 1,33 m, larg. 1,11 m, vente Claude Aguttes SAS – Paris, 20 mars 2015, lot n° 99.

Majorelle Frères & Cie, La Cascade, meuble de salon, composition marquetée par Camille Gauthier, signé et daté 1899, haut. 1,676 m, larg. 0,8 m, prof. 0,4 m, vente Phillip’s – New-York, 8 juin 2023, lot n° 78.
Les structures en « Y » (voir ci-dessus) et la mouluration en quart de vrille des montants sont deux marqueurs caractéristiques de l’influence de Camille Gauthier sur les productions signées Majorelle.

Majorelle Frères & Cie, détail du quart de vrille d’une sellette à décor marqueté, collection A-L.P.
Au fil des années, Majorelle a consenti à mettre un peu plus en avant Camille Gauthier en reconnaissant dans sa communication avec la presse l’importance du travail que ce dessinateur effectuait au sein de l’entreprise. Mais le lien de confiance qui présidait à leur relation s’est progressivement délité. Pour le mobilier présenté par Majorelle à l’Exposition universelle de 1900, la part du décor marqueté qui était confié à Gauthier s’est s’amenuisée au profit des décors en bronze et des pentures métalliques prônées par un autre collaborateur de la maison, Alfred Levy[8]. Cela n’est sans doute pas étranger à la rupture qui va s’avérer inéluctable et intervenir au lendemain de l’Exposition au sein de laquelle la maison Majorelle a triomphé, mais sans que Gauthier ne reçoive une distinction.

Coiffeuse présentée par la maison Majorelle à l’Exposition universelle de 1900 avec la collaboration de Camille Gauthier. Porfolio Meubles de style moderne Exposition Universelle de 1900, Charles Schmid éditeur. Coll. part.
Après plusieurs années de relations entre Louis Majorelle et Camille Gauthier, on peut se demander, lequel des deux protagonistes a su le mieux tirer parti de leur collaboration. Camille Gauthier peut s’enorgueillir d’avoir été sollicité par une entreprise de renom, au prestige établi lui ayant proposé un poste de responsabilité alors qu’il n’avait aucune expérience de quelque nature que ce soit. Certes, le jeune Gauthier possédait d’indéniables qualités de dessinateur mais la plupart des étudiants fréquentant les institutions de formation partageait cette caractéristique. Sans doute plus que d’autres, il faisait montre d’une grande motivation à se former et à tout mettre en œuvre pour être admis et reconnu au sein des milieux artistiques qu’il fréquentait.
De son côté, Louis Majorelle, qui avait déjà eu l’occasion de recruter de jeunes talents prometteurs, faisait le pari audacieux d’embaucher un collaborateur inexpérimenté mais le risque qu’il prenait était somme toute assez limité car en cas d’insatisfaction, il avait à tout moment la possibilité d’y mettre un terme. En travaillant au sein d’un atelier où œuvraient les artisans les plus qualifiés, Gauthier gagnait beaucoup de temps dans l’acquisition des connaissances d’un métier qui nécessitait des années d’apprentissage. Il en avait parfaitement conscience et savait qu’en regardant attentivement autour de lui, le modèle Majorelle lui administrait en accéléré la meilleure formation pour comprendre de quelle manière il fallait diriger une entreprise moderne de fabrication de meubles.
Sans Gauthier, Majorelle aurait-il pu réaliser aussi efficacement la conversion qui lui doit d’être considéré comme un des maîtres de l’École de Nancy ? On ne saurait vraiment répondre à cette question. Toutefois, il n’est pas interdit d’imaginer qu’en lieu et place de Camille Gauthier, Majorelle se serait probablement mis en quête d’un autre employé susceptible de remplir ce rôle. Sans Majorelle, Camille Gauthier aurait-il pu trouver l’opportunité lui permettant d’exprimer sa voie dans le domaine artistique ? Là encore, il n’y a pas de réponse définitive face à une telle interrogation et, plutôt que de se lancer dans d’interminables conjectures, on se doit de conclure que la collaboration entre Gauthier et Majorelle s’est effectivement traduite par un résultat mutuellement fructueux.
Après son départ, Camille Gauthier a fondé son propre atelier où il a continué à développer et à réinventer son style personnel, lequel présentait de facto de fortes similitudes avec celui que Majorelle continuait à décliner. Il signe alors « Camille Gauthier » ou « Camil Gauthier » ou « Gauthier le lorrain ».

À gauche : Gauthier Le Lorrain, meuble de collectionneur, publié dans La Lorraine Artiste, 18ème année, n° 10, 1er déc. 1900, p. 157.
Adhérent à l’Alliance Provinciale des Industries d’Art (École de Nancy) au côté de son président Émile Gallé et de son ancien employeur Louis Majorelle, il a exposé avec le groupe nancéien au Pavillon de Marsan à Paris en 1903.

Gauthier & Cie, salle à manger au tulipier, noyer verni. Portfolio Exposition Lorraine/l’École de Nancy/au/Musée de l’Union Centrale des Arts Décoratifs/Pavillon de Marson à Paris/1ère Série : Le Mobilier/Armand Guérinet, Éditeur, 1903, pl. 46. Coll. part.
Son mobilier tend alors vers une certaine simplification car, conformément à ses aspirations sociales, la clientèle recherchée n’est plus celle de l’aristocratie ou de la haute bourgeoisie. Parfois, Gauthier renonce même au décor végétal, omniprésent à Nancy, ne conservant qu’une construction par des lignes souples rapprochant ses créations de celles des parisiens Plumet et Selmersheim.

Camille Gauthier, étagère. Coll. part.
Ce n’est qu’en 1904, en s’associant au tapissier Paul Poinsignon, qu’il peut fonder à Nancy une nouvelle unité de production en série avec vente directe des meubles exposés dans une vaste galerie. En se passant d’intermédiaires et de concessionnaires, par une politique de diffusion de catalogues, de participation à des concours et à des expositions, ses meubles bien exécutés et toujours fidèles à l’esthétique naturaliste de l’École de Nancy vont entrer dans les foyers de la petite et de la moyenne bourgeoisie, bien au-delà de la Lorraine. Mais la société « Gauthier-Poinsignon » a également équipé de nombreux lieux publics, commerces, hôtels et restaurants, tout en restant capable de produire à l’occasion des ensembles plus luxueux.

À gauche : vitrine-casier, acajou et bubinga, sculptures renoncules, marqueteries marguerites, haut ; 1,55 m, larg. 0,65 m, prix 290 F., ateliers Gauthier-Poinsignon, photographie issue du catalogue commercial Gauthier, Poinsignon & Cie, réf. n° 21, 1914, p. 120. Coll. part.
À droite, vitrine-casier à musique – réf. n° 21, signée, haut. 1,58 m, larg. 0,69 m, prof. 0,34 m, vente Millon et associés — Paris, 07 avril 2017, lot n° 76.
En 1909, Gauthier présente à l’Exposition Internationale de l’Est de la France à Nancy un cabinet de travail en chêne lacustre décoré selon la flore et la faune fossile et annonçant l’apparition du style Art Déco ou à tout le moins d’un style post-École de Nancy dont le succès commercial sera considérable. À cette occasion, Majorelle semble à nouveau dépassé stylistiquement et devra s’adapter peu après.

Cabine de travail en chêne lacustre sur l’un des stands de Gauthier-Poinsignon au palais du Génie Civil à l’Exposition Internationale de l’Est de la France à Nancy en 1909. Cliché Henri Bellieni. Coll. part.
La Première Guerre mondiale affecte fortement le moral de Gauthier, d’autant plus que son associé Paul Poinsignon décède brutalement en 1916. La société garde néanmoins le même nom. Désireux de se retirer progressivement, Gauthier cède finalement son entreprise, redevenue prospère, en 1924 au fabricant de meuble toulois Delfour.
Justine Posalski
Notes
[1] Il y côtoie alors le futur décorateur parisien Tony Selmersheim et y croise le nancéien Jacques Gruber. Hector Guimard en est professeur d’octobre 1891 à juillet 1898.
[2] Antonin Daum (1864-1930) ingénieur formé à l’École Centrale à Paris et son frère Auguste Daum (1853-1909), juriste de formation, ont repris la verrerie acquise par leur père et n’ont — contrairement à Louis Majorelle — aucune formation artistique.
[3] Édité par l’imprimerie Camis, sis 59 boulevard Richard Lenoir à Paris.
[4] Catalogue de la maison Majorelle, circa 1892.
[5] Le terme « selle » fait référence à ce qu’aujourd’hui on nomme usuellement sellette.
[6] Inaugurée en 1889, la Salle Poirel est un ensemble culturel situé à Nancy composé d’une salle de spectacle et d’une vaste galerie d’art.
[7] Roselyne Bouvier, Majorelle. Une aventure moderne, Paris-Metz, Éditions Bibliothèque des Arts et Serpenoise, 1991, page 43.
[8] Alfred Lévy (1872-1965) est entré en 1888, à l’âge de 16 ans, chez Majorelle. Sa présence ne semble pas avoir été déterminante dans le virage moderne de la maison Majorelle. Il est resté fidèle à l’entreprise en tant que directeur artistique, assurant la relève de Gauthier après 1900, puis le virage vers l’Art Déco après la Première Guerre mondiale.

Acquisition d’un vase de Cerny d’Hector Guimard inédit
Alors que la date limite de réception des offres pour la conclusion d’un bail emphytéotique sur l’hôtel Mezzara approche rapidement, notre mobilisation se poursuit notamment au niveau de l’enrichissement de nos collections. Après l’achat d’une section de candélabre et sa verrine du métropolitain par Le Cercle Guimard[1], c’est au tour de notre partenaire Fabien Choné d’acquérir, aux enchères cette fois-ci[2], une nouvelle œuvre de Guimard : un tirage d’époque du vase de Cerny.
Rappelons que Cerny est une des trois formes dessinées par Guimard pour la Manufacture de Sèvres autour de 1900[3]. Sa production s’est étalée sur une dizaine d’années et nos recherches au sein des archives de l’institution nous ont permis d’estimer à une quinzaine d’exemplaires au plus le nombre de vases fabriqués à l’époque par Sèvres[4].
L’apparition d’un tirage original du vase de Cerny constitue donc un petit événement en soi qui nous permet par ailleurs d’identifier et de documenter le dixième exemplaire parvenu jusqu’à nous. En grès émaillé, il se caractérise par une couverte jaune moutarde rehaussée de discrètes cristallisations bleues nichées dans les creux de l’encolure et soulignant sa base, une gamme chromatique qui le rapproche des exemplaires conservés par les musées de Sèvres et Limoges.

Vase de Cerny vendu aux enchères le 23 mars 2025. Photo étude Metayer-Mermoz.
On y retrouve à sa base le traditionnel monogramme en creux HG — qui orne toutes les productions sévriennes de Guimard — ainsi qu’au culot les marques propres à la Manufacture : le cachet triangulaire S 1904 qui permet de le dater et le tampon rectangulaire SÈVRES.

Monogramme HG en creux à la base du vase. Photo étude Metayer-Mermoz.
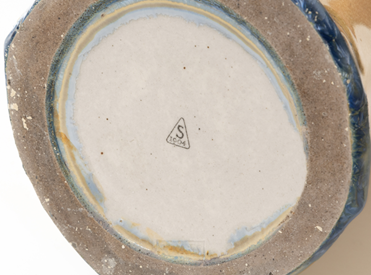
Culot du vase présentant les deux marques de la Manufacture de Sèvres. Photo étude Metayer-Mermoz.
Un accident ancien a nécessité une restauration réalisée l’année dernière — et sur laquelle nous reviendrons bientôt — qui a consisté à reconstituer partiellement une des quatre anses composant l’encolure.
L’originalité de ce vase réside dans son histoire et sa provenance qui, fait assez rare pour ce type d’objet, sont connues grâce aux témoignages familiaux.
Par descendance directe, ce vase provient de l’ancienne collection de M. Numa Andoire (Coursegoules 1908 – Antibes 1994), joueur de football et entraineur professionnel, célèbre notamment pour avoir gagné le Championnat de France en 1951 et 1952 alors qu’il entrainait l’équipe niçoise, l’OGC Nice, ainsi que la Coupe de France en 1952.

L’équipe de Nice en 1931. Numa est debout à droite adossé au mur. Photo droits réservés.
Le récit familial précise que le vase aurait été offert par le président de la République Gaston Doumergue (1863-1937) à Numa Andoire en 1927 à l’occasion du tournoi de football organisé pour l’inauguration du monument aux morts antibois de la Première guerre mondiale. Le monument dont la pièce maitresse est la statue du poilu sculptée par Bouchard[5] a été construit au pied du Fort carré et domine encore aujourd’hui le terrain de football éponyme.
Les presses régionale et locale ont relayé l’évènement qui a eu lieu le dimanche 03 juillet 1927 à grand renfort, comme il se devait, de discours patriotiques, de défilés de troupes et de remises de médailles au son de la Marseillaise.
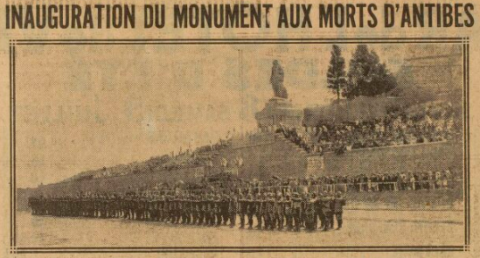
L’Excelsior du 05 juillet 1927. Site internet BNF/Gallica
On y retrouvait un ancien sous-secrétaire d’État à la guerre chargé de présider la cérémonie, un sénateur, un député, un général représentant le ministre de la Guerre mais point de président de la République… qui s’était certainement fait représenter comme cela arrive souvent pour ce genre d’évènement.
La présence d’un vase de Cerny d’une telle valeur en tant que cadeau offert par l’État à l’occasion d’une compétition relativement anodine peut paraître étonnante. Mais elle est à replacer dans l’histoire longue (et parfois insolite) des largesses octroyées par les autorités à l’occasion d’évènements culturels, scientifiques ou sportifs. Il faut se souvenir du fait que l’État, seul actionnaire de la Manufacture de Sèvres, s’en servait pour fournir tout d’abord des cadeaux diplomatiques de grande valeur, mais aussi un important volume d’objets d’art remis au nom des autorités lors de manifestations culturelles et sportives. Les expositions universelles, internationales et régionales étaient ainsi l’occasion de remettre de nombreux vases, statuettes et autres plats décoratifs — le plus souvent avec le fameux fond bleu de Sèvres — dont la taille et le décor étaient plus ou moins corrélés à l’importance des prix remis aux lauréats, des récompenses diversement appréciées par la communauté artistique…[6].
En ce qui concerne notre vase de Cerny, remis plus de 15 ans après la fabrication du dernier exemplaire à Sèvres, il s’agit probablement d’une des nombreuses occasions pour lesquelles l’État a pioché dans les réserves des manufactures officielles pour récompenser les premiers prix quand ce n‘étaient pas les institutions ou les ministères eux-mêmes qui se séparaient de certaines acquisitions[7]. En 1927, à un moment où l’Art nouveau était déjà bien dévalorisé, les autorités n’ont sans doute pas eu l’impression d’offrir un objet qui, un siècle plus tard, allait acquérir une valeur artistique et financière aussi importante.
Pourquoi notre vase est-il devenu la propriété de Numa Andoire plutôt qu’un autre joueur ? Le récit familial n’étant pas suffisamment précis sur ce point, nous ne pouvons qu’émettre des hypothèses. S’agissait-il de récompenser la courte mais prometteuse carrière du jeune joueur prodige de l’Olympique d’Antibes ou bien plutôt de lui offrir un cadeau de départ, lui qui achevait sa 7ème et dernière saison au sein de l’équipe Antiboise avant de rejoindre l’équipe niçoise ? Probablement un peu des deux… Il est en tout cas touchant de constater que ce vase ait été longtemps conservé en tant que souvenir familial avant que, finalement, les héritiers ne décident de s’en défaire.
Ce vase de Cerny inédit figure désormais en bonne place dans notre projet de parcours muséal pour l’hôtel Mezzara.
Olivier Pons
Notes
[1] https://www.lecercleguimard.fr/fr/une-verrine-en-verre-du-metro-de-guimard-pour-notre-projet-museal/
[2] Vente du 23/03/2025, étude Metayer-Mermoz à Antibes, expert E. Eyraud.
[3] Les deux autres formes sont le cache-pot de Chalmont et la jardinière des Binelles.
[4] Sur l’histoire de cette collaboration, nous renvoyons nos lecteurs au livre paru en 2022 aux Éditions du Cercle Guimard : F. Descouturelle, O. Pons, La Céramique et la Lave émaillée d’Hector Guimard.
[5] Henri Bouchard (1875-1960), s’était fait construire en 1924 un atelier, 25 rue de l’Yvette à Paris (75016) en face de la propriété du peintre Jacques-Emile Blanche pour lequel Guimard réalisa des travaux de décoration. L’atelier du sculpteur, devenu musée Bouchard, a fermé ses portes en 2007 avant d’être transféré à La Piscine à Roubaix.
[6] Un des cas les plus célèbres est probablement celui de François-Rupert Carabin (1862-1932), sculpteur à l’esprit frondeur, qui avait reçu en 1912 comme « Prix du Président de la République » un vase de Sèvres à fond bleu qu’il jugeait « fort laid et de second choix ». Il réalisa alors un socle constitué de trois figures féminines s’en détournant avec horreur et l’exposa peu après au Salon de la Société nationale des Beaux Arts afin d’en faire étalage lors de la visite présidentielle. Le socle et le vase appartiennent à présent à la collection Perrier-Jouët à Épernay.
[7] En 1905, par exemple, le ministère de la Marine a fait l’acquisition d’un vase de Cerny sorti des ateliers de la Manufacture de Sèvres un an avant, donc daté 1904, comme notre vase…

Hector Guimard et le Jugendstil
Nous avons le plaisir de publier un article de notre adhérent suisse de longue date, Michel Philippe Dietschy-Kirchner, rédigé à l’occasion de l’exposition que Munich consacre ces jours-ci au Jugenstil — le versant allemand du style Art nouveau. À partir des pièces présentées, il élargit son propos en élaborant des associations possibles au sein du mouvement européen, notamment avec les œuvres d’Hector Guimard et de Paul Follot.
Jugendstil made in Munich est une exceptionnelle exposition conjointe de la Kunsthalle München et du Münchner Stadtmuseum. Elle se tient à la Kunsthalle de Munich du 25 octobre 2024 au 23 mars 2025 et regroupe les œuvres du Münchner Stadtmuseum (qui possède une collection de renommée internationale), complétées par des prêts d’autres institutions et de collections privées. Des textiles originaux sont notamment à nouveau montrés au public. Tous les textes sont écrits en allemand avec une traduction en anglais. Elle rencontre un franc succès bien mérité.
À la fin du 19ème siècle, Munich, grâce à d’excellentes opportunités de formation et d’expositions, est devenue une métropole de la culture ouverte au monde. Elle attire de ce fait des artistes de toute l’Europe. Dans ce foisonnement innovateur est né en 1896 la revue Jugend, Münchener illustrierte Wochenscrift für Kunst und Leben. Elle donnera le nom de « Jugendstil » à la révolution esthétique allemande, tandis que la française s’appellera « Art nouveau », grâce au galeriste parisien (d’origine allemande) Siegfried Bing (1838-1905). Le programme de cette revue, comme sa qualification l’indique, « hebdomadaire munichois de l’art et du style de vie », est de réformer tous les domaines de la vie (Lebensreform), comme d’autres mouvements de son époque. Les valeurs fondamentales de la société sont remises en question par l’industrialisation galopante, la surexploitation des sols et des matières premières, la destruction des sites naturels et des paysages, la pollution, l’explosion des villes avec l’entassement des populations, la paupérisation, l’injustice sociale et l’insalubrité. Une réponse potentielle à ces défis a été proposée dans les idéaux d’une cohabitation harmonieuse avec la nature et entre les humains. Cette vision globale se retrouve également dans le Gesamtkunstwerk, théorie où l’ensemble des conceptions artistiques forme un tout cohérent. Les prémices du développement durable, de la répartition équitable des richesses, de l’égalité et de la tolérance sont ainsi posés. Elles motivent les initiatives suivantes apparues à l’aube du XXe siècle. Rudolf Steiner (1861-1925) développe l‘anthroposophie dans le sens de l’intégration de l’humain dans l’univers, comme l’agriculture biodynamique pour conserver la fertilité des sols et stimuler la production des cultures. Des ligues pour la protection du patrimoine (1905) et de la nature (1909) ont été créées en Suisse. Le médecin Maximilian Bircher-Benner (1867-1939) redéfinit la diététique par les bienfaits du birchermuesli. Des restaurants végétariens naissent un peu partout : Haus Hiltl, le premier à Zurich en 1898, ou Ethos à Munich. La mode commence à devenir plus confortable et plus respectueuse du corps en abandonnant les corsets trop serrés et en concevant des coupes plus amples. Le processus de la création artistique ne se fonde dorénavant plus sur le recopiage d’œuvres du passé, de répertoires de motifs ou de la nature de manière figurative (approche naturaliste), mais sur la recherche d’un nouvel ornement plus abstrait inspiré par cette dernière (approche organique). Elle n’est plus reproduite en tant que telle, mais l’artiste la dépasse en interprétant la quintessence, le dynamisme et la vitalité de l’esprit de son mouvement. Le modèle ne peut souvent plus être reconnu du premier coup. Ces deux extrêmes, naturaliste et organique, sont à considérer comme un continuum. Cette nouvelle danse de la nature a été décrite en « coup de fouet », tant en France pour la production des périodes Art nouveau d’Hector Guimard (1867-1942)[1] qu’en Allemagne pour la tapisserie au motif de cyclamen d’Hermann Obrist (1862-1927).

Tapisserie au motif de cyclamen dessinée par Hermann Obrist et réalisée par Berthe Ruchet, vers 1895, tissu de laine (à l’origine bleue) avec broderie de soie, haut. 1,19 m, marg. 1,83 m, Münchener Stadtmuseum. Source : www.kunsthalle-muc.de. Droits réservés.
De plus, grâce aux progrès scientifiques et technologiques, la découverte de mondes nouveaux dans les fonds sous-marins et les organismes microscopiques amène de nouvelles sources d’inspiration, qu’on peut retrouver dans ce grand vase de sol, comme dans certains décors animaliers et d’inspiration sous-marine de l’immeuble du Castel Béranger d’Hector Guimard à Paris[2].
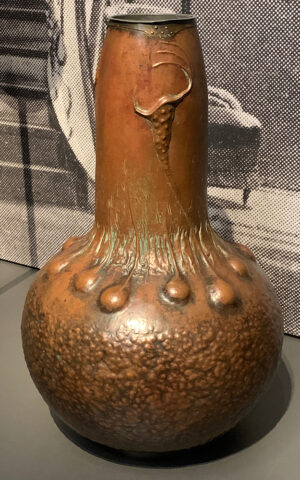
Vase de sol dessiné par un artiste inconnu et réalisé par I. Winhart & Co., München, 1906, cuivre et laiton, Münchener Stadtmuseum. Photo auteur.
En effet, Hector Guimard s’est démarqué de ses collègues français par l’approche la plus organique et la moins naturaliste, plus proche finalement de celle du Jugendstil que de l’Art nouveau. D’ailleurs, les abat-jours de Marie Herberger (1875-1963) rappellent le style Guimard. Aurait-elle vu entre autres les entourages du Métropolitain d’Hector Guimard dans le portfolio allemand Ausgeführte moderne Kunstchmiede-Arbeiten[3] ?

Marie Herberger, abat-jour en tôle de fer, c. 1905, Münchener Stadtmuseum, don Alexandra Aichberger, petite nièce de l’artiste. Photo auteur.
Le critique et historien d’art allemand Julius Meier-Graefe (1867-1935) a tissé des liens internationaux, notamment entre la France, la Belgique et l’Allemagne. La visite de la Maison d’Art La Toison d’Or et la rencontre de Henry Van de Velde (1863-1957) lors d’un voyage en compagnie de Siegfried Bing à Bruxelles au printemps 1895 a nourri les deux hommes de concepts novateurs pour chacune de leur future galerie d’art. Durant son séjour à Paris, outre ses activités d’écriture dans des revues d’art allemandes et françaises, il collabora avec Siegfried Bing au sein de La Maison de l’Art nouveau en tant que conseiller artistique en 1895, avant d’ouvrir la sienne, La Maison Moderne, de 1899 à 1905. Il y sélectionnera des artistes de toute l’Europe, comme Paul Follot (1877-1942), Henri Van de Velde, Peter Behrens (1868-1940) et Félix Vallotton (1865-1925)[4]. Paul Follot (marié à une artiste peintre allemande connue à Paris) a aussi choisi une approche plutôt organique, mais d’une facture moins extrême que celle d’Hector Guimard et du Jugendstil[5]
Le motif de sa lampe, qui se retrouve aussi sur sa couverture des Documents sur l’Art industriel au XXe siècle, trahit bien une origine naturelle, sans que toutefois une espèce spécifique puisse être formellement identifiée.
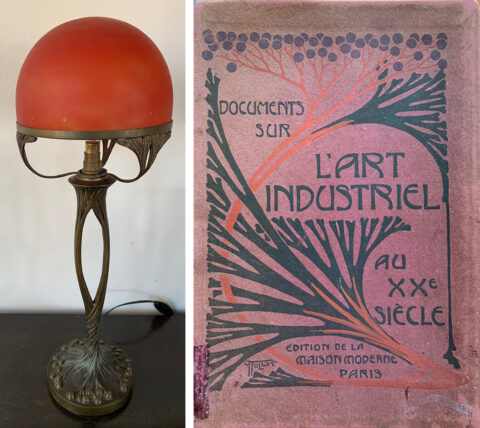
À gauche : Pied de lampe en bronze argenté, non signé, attribué à Paul Follot et abat-jour en verre, non signé, attribué à Daum, pour La Maison Moderne, 1901-1902, haut. 0,43 m. Coll. part. Photo auteur.
À droite : Documents sur l’Art industriel au XXe siècle, couverture signée de Paul Follot, édition de La Maison Moderne, 1901, haut. 0,30 m, larg. 0,21 m. Coll. part. Photo auteur.
En dernier lieu, comme Hector Guimard au début de sa carrière lors de sa période proto Art nouveau, Richard Riemerschmid (1867-1957) dans ses premiers meubles et Bernhard Pankok (1872-1943) ont revisité le style gothique dans respectivement ce buffet et cette armoire-vitrine.

À gauche : buffet dessiné par Rischard Riemerschmid et réalisé par la Möbelfabrik Wenzel Till, München, 1897, if et fer, Landesmuseum Württemberg, Stuttgart. Photo auteur.
À droite : armoire-vitrine de la salle à manger de la Villa Obrist dessinée par Bernhard Pankok et réalisée par les Vereinigte Werkstätte für Kunst im Handwerk, München, 1898-1899, chêne et verre (étagères refaites), Münchener Stadtmuseum. Photo auteur.
Ces associations entre le Jugendstil et Hector Guimard sont-elles fortuites ou le fruit d’influences délibérées ? Cette question a déjà été soulevée dans une actualité parue le site internet du Cercle Guimard[6]. L’hypothèse d’une conception quasi-simultanée y a été avancée.
Les apports d’Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) lors de sa formation, ainsi que de Victor Horta (1861-1947) et de Paul Hankar (1859-1901) lors de son voyage à Bruxelles en été 1895 sont clairement établis pour Hector Guimard. Cependant, une connexion privilégiée avec le Jugendstil n’est pas évidente, à part les échanges d’informations au sein du réseau des galeries d’art et dans la riche littérature des arts décoratifs de l’époque. Ces derniers sont également facilités par le développement des moyens de communications et de déplacements. L’émulation artistique au tournant du siècle dernier se fonde sur les mêmes bases dans toute l’Europe, telles qu’un retour aux sources de la nature, du Moyen-Âge et du monde fantastique des contes et légendes, la découverte des arts orientaux, le concept de l’art dans tout et pour tous. Il n’est alors pas étonnant de retrouver des similitudes dans les démarches créatives entre les œuvres d’Hector Guimard et du Jugendstil. En sachant son fort caractère, ainsi que sa liberté et son indépendance d’esprit le maintenant en dehors des clivages patriotiques, il ne se gênait pas pour suivre son propre chemin, se différenciant de ses collègues français et pouvant se rapprocher stylistiquement du Jugendstil.
Michel Philippe Dietschy-Kirchner
Notes
[1] Descouturelle Frédéric : « Hector Guimard : Inventivité et économie de création par transformations, combinaisons et réutilisations de motifs décoratifs d’un matériau à l’autre, d’un produit édité à un autre », intervention lors de la journée d’études « Autour d’Hector Guimard » pour le 150e anniversaire de sa naissance, Musée des Arts décoratifs de Paris, 13 octobre 2017, https://youtu.be/QHxzlnCjP04
[2] Briaud Maréva : « Le Bestiaire fantastique et coloré du Castel Béranger » actualité publiée sur le site internet du Cercle Guimard, 12 janvier 2025.
[3] Rehme Wilhelm : Ausgeführte moderne Kunstchmiede-Arbeiten, Baumgärtner, Leipzig, 1902.
[4] Mothes Bertrand : « La Maison moderne de Julius Meier-Graefe, une galerie allemande à Paris ? » dans Les artistes et leurs galeries, Paris-Berlin, 1900-1950, tome II : Berlin, sous la direction de Denise Vernerey-Laplace et d’Hélène Ivanoff, Presses universitaires de Rouen et du Havre, Mont-Saint- Aignan, 2020, Chapitre X, pages 245-261.
[5] Sanchez Léopold Diego : Paul Follot, un artiste décorateur parisien, AAM Éditions, Bruxelles, 2020.
[6] Descouturelle, Frédéric avec la participation de Pons, Olivier : « Guimard, Riemerschmid et Thonet, une étonnante convergence pour le piètement d’une petite table », actualité publiée sur le site internet du Cercle Guimard, 14 janvier 2024.
Comment commander ?
Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.
Recevoir les objets par colis
Prix du transport en sus.
Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».
Merci d'envoyer un message pour passer commande.
Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).
Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.
Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?
Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.
