Author: f.descouturelle

La Maison Moderne de Julius Meier-Graefe — Seconde partie
Organisation, offre et fonctionnement de La Maison Moderne
Parmi tous les artistes choisis, deux compatriotes belges reçoivent la mission la plus importante : Georges Lemmen tout d’abord. Meier-Graefe lui confie le soin d’élaborer l’élément le plus reconnaissable pour une enseigne : son logotype[1]. Ce symbole, censé être la « marque » de La Maison Moderne, se compose simplement des lettres initiales du nom de la galerie superposées, dessinées en courbes dans la lignée du style déjà employé par Lemmen dans les affiches pour Dekorative Kunst. De conception simple, ce logo se retrouvera sur la majeure partie de la production et des publications de La Maison Moderne dans sa forme originale ou plus élaborée.

Georges Lemmen, logotype de La Maison Moderne, 1899.
L’aménagement de La Maison Moderne est confié à l’artiste en qui Meier-Graefe à le plus confiance : Henry Van de Velde. Celui-ci conçoit alors une devanture avec des vitrines, permettant de voir une sélection d’objets vendus à l’intérieur.

Aménagement intérieur de La Maison Moderne par Van de Velde, 82 rue des Petits-Champs à Paris, Deutsche Kunst und Dekoration, octobre 1900, bibliothèque en ligne de l’Université de Heidelberg. Sur l’étagère du meuble de présentation figurent deux vases de Dufrène et Dalpayrat.

Maurice Dufrène dessinateur, Dalpayrat et Lesbros céramiste, grès flammé, c. 1899, achat par l’Union Centrale des Arts Décoratifs à La Maison Moderne en 1899, monture en argent de Cardeilhac ajoutée en 1900, exposé au pavillon de l’UCAD à l’Exposition universelle de Paris en 1900, Musée des Arts Décoratifs. Droits réservés.
L’élaboration de la typographie des lettres qui lui sont destinées échoit à Georges Lemmen[2]. Ce choix témoigne de la confiance que Meier-Graefe place dans le talent des deux artistes belges, la devanture tenant alors un rôle aussi important que celui d’une affiche pour les boutiques de la fin du XIXe siècle. Dans la galerie, Van de Velde propose un décor complet, alternant vitrines, étagères et pièces aménagées.
Les autres artistes sélectionnés pour apparaitre dans le catalogue de la galerie sont légion : plus de soixante sont recensés. Malgré une volonté affichée de la part de Meier-Graefe de créer une galerie favorisant les réalisations françaises, les créateurs étrangers sont très nombreux dans ses murs.

Bernhard Hoetger (Hörde, Allemagne, 1874 – Beatenberg, Suisse, 1949), La Tempête, c. 1901, bronze, musée d’Orsay, RF 4189, haut. 0311 m, larg. 0,245 m, prof. 0,25 m. Droits réservés. Cette sculpture est reproduite dans les Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, bronze 3322-1, La Sculpture p. 5.
Il est significatif, pour fournir un aperçu de la diversité de l’offre proposée, de mentionner toutes les nationalités présentes parmi les collaborateurs de La Maison Moderne : français, belges, allemands, italiens, autrichiens, hongrois, roumains, serbes, danois, néerlandais, et finlandais. Il est intéressant de noter l’absence d’artistes britanniques et espagnols parmi eux. Le goût de Meier-Graefe est le seul vrai dénominateur commun entre tous ces artistes, et leur sélection est effectuée avec un souci de cohérence qui lui est cher (le manque de cohérence avait été reproché à Bing quatre ans plus tôt).

Aménagement intérieur de La Maison Moderne par Van de Velde, 82 rue des Petits-Champs à Paris, Deutsche Kunst und Dekoration, octobre 1900, bibliothèque en ligne de l’Université de Heidelberg.
L’offre proposée par l’établissement est également très étendue : dans l’article annonçant l’ouverture en septembre 1899, il est dit que « Les galeries de la « Maison Moderne » renfermeront un peu de tout : meubles, étoffes de tenture, tapis, céramiques, verreries, appareils d’éclairage, broderies, dentelles, bijoux, éventails, objets de toilette et de fantaisie — depuis la brosse jusqu’au pommeau de canne — enfin, tout ce qui entre dans la demeure et sur la personne[3] ». Cette prédiction se voit bien confirmée : La Maison Moderne propose tout ce qui est nécessaire pour aménager un intérieur et tous les accessoires — mais pas les vêtements — dont peut avoir besoin une personne aisée du début du XXe siècle. Ce même article mentionne également une sélection de maitres de la peinture, dont des œuvres sont proposées à la vente : Édouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Paul Cézanne, Auguste Renoir, Maurice Denis, Théo Van Rysselberghe, Édouard Vuillard et Pierre Bonnard. Cet article reste toutefois la seule évocation de l’exposition de peintures à La Maison Moderne. Les tableaux qui ont pu y être présentés nous sont inconnus, et d’éventuels autres artistes ne peuvent être identifiés.
En plus de proposer des objets seuls à la vente, la galerie se proposait de concevoir et d’aménager des pièces, des appartements ou tout autre type d’intérieur dans leur ensemble. La plupart de ces aménagements complets ont été réalisés sous la direction d’Abel Landry, de Pierre Selmershein ou de Maurice Dufrène. Aucun exemple n’est parvenu jusqu’à nous autrement que par des photographies anciennes comme celles de ce magasin de mode, à nouveau conçu par Van de Velde pour le Palast Hotel, Potsdamer Platz à Berlin, dirigé par P. H. C. Kons.

Henri Van de Velde, aménagement d’un magasin de modes « filiale de Madame Henriette » au sein du Palast Hotel à Berlin, réalisation par La Maison Moderne avec des meubles dessinés par Abel Landry, Deutsche Kunst und Dekoration, octobre 1900, bibliothèque en ligne de l’Université de Heidelberg.
La commande la plus important et la plus documentée concerne l’aménagement du restaurant allemand Konss[4], situé cette fois à Paris, à l’angle de la rue Grammont et du boulevard des Italiens, au premier étage, pour le même P. H. C. Kons. L’architecte désigné par le propriétaire pour diriger les travaux est Bruno Möhring[5]. Celui-ci décide de l’agencement intégral de l’enseigne et Kons renouvelle sa confiance à La Maison Moderne pour la réalisation et la mise en place des décors. Les travaux se déroulent du 15 janvier au 17 avril 1901. Véritable réussite, la participation de La Maison Moderne à l’aménagement est signalée dans le hall d’entrée de son établissement. Quelques mois plus tard, Meier-Graefe en donne un compte-rendu dans L’Art Décoratif, sous l’un de ses pseudonymes : G. M. Jacques[6]. À la lecture de cet article on est frappé par le fait que, l’ayant signé d’un pseudonyme à consonance française dans sa revue française, Meier-Graefe adopte un point de vue qui pourrait être celui d’un journaliste parisien, critiquant l’aménagement de Möhring en alléguant que ses « instincts de Latin sont fermés à sa conception germanique. » alors que c’est pourtant sa propre entreprise qui a effectué l’aménagement. En collant ainsi à ce qu’il imagine être un état d’esprit « latin », sans doute désire-t-il ne pas prêter le flanc à une suspicion de conflits d’intérêt.

Bruno Möhring, palier sur l’escalier du restaurant Konss, au premier étage du 30 rue de Grammont à Paris, 1901, exécution par La Maison Moderne, céramiques Laüger, Architektonische Monatshefte, VII. Jahrgang 1901, pl. 88, Leipzig/Wien, Friedrich Wolfrum, 1901, bibliothèque en ligne de l’Université de Stuttgart.

Bruno Möhring, salon vert du restaurant Konss, au premier étage du 30 rue de Grammont à Paris, 1901, exécution par La Maison Moderne, panneaux par Georges de Feure, Architektonische Monatshefte, VII. Jahrgang 1901, pl. 87, Leipzig/Wien, Friedrich Wolfrum, 1901, bibliothèque en ligne de l’Université de Stuttgart.

Bruno Möhring, salon lilas du restaurant Konss, au premier étage du 30 rue de Grammont à Paris, 1901, exécution par La Maison Moderne, L’Art Décoratif, novembre 1901, article G. M. Jacques (Julius Meier-Graefe). Bibliothèque en ligne de l’Université de Heidelberg.
Le mode de fonctionnement de La Maison Moderne est très réfléchi, il exprime la réflexion poussée de son directeur et ses capacités innovatrices. Conscient du comportement du collectionneur français, qui agit avec l’objet d’art de la même façon qu’avec une peinture ou une sculpture, Meier-Graefe propose une organisation inspirée des Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk (Ateliers réunis pour l’art et l’artisanat) de Munich. Alors que l’art décoratif français demeure surtout un art de commande, dans lequel les artistes ne répondent qu’à des demandes spécifiques en créant des modèles uniques inaptes à la reproduction, Meier-Graefe propose un système inverse : les objets ne relèvent plus de commandes de particuliers mais sont produits en série par des artistes et des artisans. La production reste cependant dans le domaine de l’artisanat et ne bascule pas vers l’industrie. En l’absence d’archives administratives provenant de la galerie, aucun chiffre précis ne peut être avancé : le nombre de pièces réalisées pour un même modèle devait être relativement restreint sans toutefois comporter d’œuvres uniques. Sans même parler de goût ou de style, c’est d’abord la manière de penser que veut changer le directeur de La Maison Moderne.
Des exceptions à ce système sont possibles. Des tapisseries de Paul-Élie Ranson, réalisées à la main par son épouse France Ranson-Rousseau en un seul exemplaire, étaient proposées à la vente à La Maison Moderne[7].

Paul-Élie Ranson, Printemps, tapisserie en laine sur toile à canevas exécutée par France Ranson-Rousseau, 1895, haut. 1,67 m, larg. 1,32 m, Musée d’Orsay, OAO 1788, droits réservés.

Aménagement intérieur de La Maison Moderne par Van de Velde, 82 rue des Petits-Champs à Paris. Au mur, deux tapisseries de Paul-Élie Ranson : Printemps et Femme en rouge, Deutsche Kunst und Dekoration, octobre 1900, bibliothèque en ligne de l’Université de Heidelberg.

Exposition Femmes chez les nabis. De fil en aiguille au Musée de Pont-Aven (22 juin au 3 novembre 2024), évocation de la salle de La Maison Moderne où se trouvaient les tapisseries de Ranson. Photo Bertrand Mothes.
Cependant il s’agit là d’objets confectionnés avant l’ouverture de la galerie, et ne relevant donc pas de la méthode de fabrication élaborée par Meier-Graefe. Le principe de fonctionnement est simple : les artistes créent des modèles et en donnent les droits de production à la galerie qui se charge de les exécuter. L’artiste reçoit une portion du prix de vente — portion définie avec son accord — pour chaque objet vendu[8]. La possibilité de fabriquer en plusieurs exemplaires permet également à Meier-Graefe de vendre ses objets à « prix raisonnable », selon ses propres termes. Le « prix raisonnable » favoriserait l’achat et permettrait à l’artiste une rémunération confortable. Il ne faut ici pas confondre « raisonnable » et « bas ». Si les prix des objets vendus à La Maison moderne n’atteignent pas ceux constatés chez Bing, ils n’en restent pas moins accessibles qu’à des personnes assez aisées, et non à des ouvriers ou à des petits employés.
Pour la production des objets, la galerie possédait ses propres ateliers. Le seul attesté avec certitude est l’atelier de maroquinerie[9], mais il est possible que des ateliers d’ébénisterie, de tabletterie, de tapisserie, de dinanderie, de joaillerie et d’horlogerie aient été présents. Les arts du feu, difficiles à mettre en place à grande échelle au cœur de la capitale parisienne, proviennent eux de fabricants associés à La Maison Moderne. Le vase Exposition 1900 Paris provenant d’Allemagne en est un bon exemple. Fabriqué par la manufacture Tonwerke à Kandern, dirigée par Max Laüger, il ne relève pas de la production habituelle de cette manufacture mais bien d’une fabrication exclusivement destinée à LMM, comme le prouve la marque de la galerie incisée sous sa base au côté du monogramme de Laüger et de la marque de la manufacture.
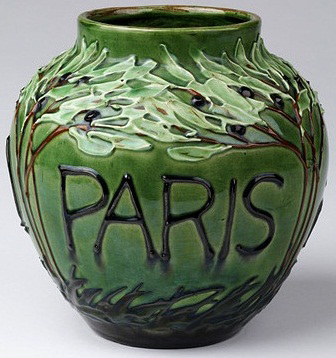
Max Laüger, atelier de la manufacture Tonwerke, Vase Exposition 1900 Paris, vers 1900, faïence peinte sous couverte, édité par La Maison Moderne, haut. 0212 m, Londres, Victoria & Albert Museum. Droits réservés.

Max Laüger, atelier de la manufacture Tonwerke, Vase Exposition 1900 Paris, vers 1900, faïence peinte sous couverte, haut. 0,212 m, Paris, musée d’Orsay. Droits réservés.
À cette conception de la production et de la vente s’ajoute un choix décisif pour l’emplacement de la galerie. Le 82, rue des Petit-Champs est situé à quelques mètres de la rue de la Paix, qui reste encore aujourd’hui l’un des quartiers les plus fournis en boutiques de luxe à Paris. En plus d’être central, cet emplacement constitue le lieu de passage d’une clientèle fortunée et réceptive aux innovations artistiques. La rue a depuis changé de nom et est devenue la rue Danielle-Casanova. L’ancien numéro 82 correspond aujourd’hui à l’actuel 26, emplacement aujourd’hui occupé par un café.
Directeur d’un établissement commercial, Meier-Graefe a bien entendu utilisé tous les moyens disponibles à son époque pour faire connaitre sa galerie. Deux affiches constituent le pivot de sa démarche publicitaire. La première est l’œuvre de Maurice Biais. Elle représente une dame élégante, regardant des objets disposés dans une des vitrines conçues par Van de Velde, fidèlement reproduite

Aménagement intérieur de La Maison Moderne par Van de Velde, 82 rue des Petits-Champs à Paris, Deutsche Kunst und Dekoration, octobre 1900, bibliothèque en ligne de l’Université de Heidelberg.

Maurice Biais, imprimerie J. Minot, affiche pour La Maison Moderne, 1899-1900, lithographie en couleur sur papier, haut. 114 m, larg. 0,785 m, Paris, Bibliothèque nationale de France.
Les objets dessinés sur l’affiche sont d’autant plus facilement reconnaissables que Maurice Biais s’est servi de photographies qui seront ultérieurement utilisées pour le catalogue de La Maison Moderne. Un encrier en émail flammé de Jakob Rapoport dessiné par Maurice Dufrène, des petites sculptures en bronze de Georges Minne, un chat en porcelaine de la manufacture danoise Bing et Groendahl et une lampe de Dufrène y sont, entre autres, visibles.

Maurice Dufrène, lampe électrique, bronze patiné, n° 1580-1, haut. 0,55 m, Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle (catalogue de La Maison Moderne), 1901, Appareils d’éclairage, p. 9. Coll. part.

Aménagement intérieur de La Maison Moderne par Van de Velde, 82 rue des Petits-Champs à Paris, Deutsche Kunst und Dekoration, octobre 1900, bibliothèque en ligne de l’Université de Heidelberg. À gauche de la vitrine, Le Petit Blessé de Georges Minne.

Georges Minne, Le Petit Blessé, bronze, haut. 0,25 m, Nationalgalerie, Berlin. Droits réservés. Cette sculpture est reproduite dans les Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle (catalogue de La Maison Moderne), 1901, La Sculpture, bronze n° 308-1, p. 21.
La seconde affiche est l’œuvre de Manuel Orazi (fig. 5). D’une composition et d’une atmosphère totalement différente de celle de Biais, elle présente elle aussi des objets qui y étaient vendus. L’on reconnait ainsi un encrier portant une figure en bronze d’Alexandre Charpentier sur un socle dessiné par Dufrène et réalisé en grès flammé par Adrien Dalpayrat, un fauteuil de Van de Velde, une lampe en bronze de Gustave Gurschner, un vase de Dufrène et Dalpayrat et une figurine de singe par Joseph Mendes da Costa. La particularité de cette affiche tient évidemment à la grande et hiératique figure féminine qui l’orne. Il s’agit en fait de la célèbre danseuse Cléo de Mérode, qui prête, comme une égérie, son image à la galerie[10].

Manuel Orazi, imprimerie J. Minot, affiche pour La Maison Moderne, 1901, lithographie en couleur sur papier, haut. 0,83 m, larg. 1,175 m, Paris, Bibliothèque nationale de France.

Gustav Gurschner, lampe électrique, bronze, n° 718-1, haut. 0,48 m lampes comprises, Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle (catalogue de La Maison Moderne), 1901, La Sculpture, p. 13. Coll. part.
Outre ces affiches, Meier-Graefe édite également des petits prospectus destinés à véhiculer l’image de sa galerie. Le carton d’invitation à l’inauguration est l’œuvre de Georges Lemmen.
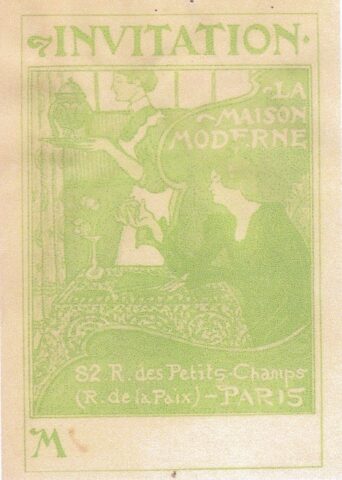
Georges Lemmen, carton d’invitation à l’inauguration de La Maison Moderne, 1899, impression en couleur sur papier, haut. 0,19 m, larg. 0,13 m. Coll. part.
La composition sera également utilisée comme encart publicitaire dans les pages de L’Art Décoratif. Les deux femmes représentées ne sont pas anonymes puisqu’en réalité, il s’agit de Mme Meier-Graefe et de Jenny, une jeune servante[11].
Le second imprimé est réalisé par Manuel Orazi, qui s’inspire de sa propre affiche pour le dessin.

Manuel Orazi, prospectus pour La Maison Moderne, vers 1903, lithographie sur papier, haut. 0,117 m, larg. 0,277 m, Paris, bibliothèque des Arts décoratifs.
De la même affiche, Meier-Graefe imprime encore des bons de réduction, soit pour ses meilleurs clients, soit pour attirer une nouvelle clientèle. L’un des éléments de publicité les plus importants reste l’ouvrage Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, publié en 1901.

Paul Follot, Couverture des Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, Paris, Édition de La Maison Moderne, 1901, haut. 0,30 m, larg. 0,208 m. Coll. part.
Présenté sous la forme d’un florilège des plus belles réalisations d’art de l’époque, il s’agit en réalité du catalogue commercial de la galerie, comportant un très grand nombre de références d’objets de La Maison Moderne.

Félix Aubert, Maison Georges Robert, éventail Iris n° 54-V et sa boîte, c. 1900, dentelle polychrome en soie, corne, émeraude, perle, haut. 0, 28 m, diam. 0,48 m, Caen, Musée de Normandie. Droits réservés. Cet éventail est reproduit dans les Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, 1901, La Dentelle, p. 4.
En plus de ces publicités indépendantes, Meier-Graefe garnit les revues qu’il dirige de références constantes à sa galerie et à ses artistes collaborateurs. Il participe également à des manifestations comme l’Exposition Internationale d’Arts Décoratifs Modernes de Turin en 1902, pour laquelle il édite une carte postale comportant là encore des objets réels provenant de son enseigne.

Maurice Biais, Société Éditrice Cartoline, Salle principale de “La Maison Moderne” à l’Exposition de Turin, 1902, carte postale ancienne, Miami, The Wolfsonian-Florida International University. Droits réservés.
Cependant, malgré toutes ses idées novatrices et son rôle précurseur au début du XXe siècle, la galerie sera un échec. Son directeur la vend en 1904 à Delrue et Cie, qui se chargera de liquider le stock[12]. Le climat de xénophobie ambiant à Paris porte tort tant à Meier-Graefe qu’à Bing, les collectionneurs français voyant d’un mauvais œil un Allemand venir leur faire la leçon de ce que doit être leur goût[13]. De plus, bien que sa structure soit ingénieuse, les coûts de production sont restés trop élevés pour permettre à la galerie de rester viable.

Abel Landry, fauteuil flâneuse n° 43, édité par La Maison Moderne, acajou, garniture moderne, haut 1,04 m, larg. 0,75 m, prof. 0,90 m, galerie Zéhil, Monaco. Photo galerie Zéhil. Ce fauteuil est reproduit dans les Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, 1901, Ameublement et décoration, p. 16.
Cette galerie, portée par un directeur innovant et sûr de son goût, n’a jamais su trouver son public, mais reste l’unique réelle tentative en 1900 de créer une alliance entre art, industrie et commerce.
Bertrand Mothes
Notes
[1] Roger CARDON, Georges Lemmen (1865-1916), Anvers, Petraco-Pandora, 1990, p. 449.
[2] Cat. Exp Georges Lemmen 1865-1916, Bruxelles, Crédit Communal, Gand, Snoeck-Ducaju & Zoon, Anvers, Pandora, 1997, p. 58.
[3] R. [pseud. Julius MEIER-GRAEFE], « Chronique de l’art décoratif, La « Maison Moderne » », L’Art Décoratif, septembre 1899, n° 12, p. 277.
[4] On peut penser que le redoublement du « s » final du nom du propriétaire du restaurant, correspond à la volonté de le faire prononcer à l’allemande et d’éviter une facile confusion avec un mot français un peu trop proche.
[5] En 1900, Möhring avait déjà construit le Restaurant allemand à l’Exposition universelle de Paris qui avait eu un grand succès.
[6] G. M. JACQUES, « Un restaurant allemand à Paris », L’Art décoratif, novembre 1901, n° 38, p. 54-60.
[7] Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle. Reproductions photographiques des principales œuvres des collaborateurs de la Maison Moderne. Commentées par R. [Raoul] AUBRY, H. [Henri] FRANTZ, G.-M. JACQUES [pseud. Julius MEIER-GRAEFE], G. [Gustave] KAHN, J. [Julius] MEIER-GRAEFE, Gabriel MOUREY, Y. [Yvanhoé] RAMBOSSON, E. [Émile] SEDEYN, Gustave SOULIER, G. [Georges] BANS, avec neuf hors textes par Félix VALLOTTON Les Métiers d’Art. Paris, Édition de La Maison Moderne, 1901, L’Ameublement, p. 36.
[8] R., op. cit. à la note 3, p. 277.
[9] Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, op. cit. à la note 7, La Maroquinerie, p. II.
[10] Alexandre Charpentier (1856-1909). Naturalisme et Art Nouveau, cat. exp., Paris, Musée d’Orsay, N. Chaudun, 2007, p. 126.
[11] Roger CARDON, Georges Lemmen (1865-1916), Anvers, Petraco-Pandora, 1990, p. 449.
[12] Publicité pour La Maison Moderne, Delrue et Cie, Fermes et Châteaux, novembre 1905, n° 3, p. IX.
[13] Nancy J. TROY, Modernism and the Decorative Arts in France : Art Nouveau to Le Corbusier, New Haven et Londres, Yale University Press, 1991, p. 47.
Liste des artistes mentionnés dans les Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle
Félix AUBERT
Henri BANS
Gyula BETLEN
Maurice BIAIS
Alexandre BIGOT
[manufacture] BING & GROENDAHLSofie BURGER HARTMANN
Alexandre CHARPENTIER
Cristallerie de Pantin
Jens DAHL-JENSEN
Pierre Adrien DALPAYRAT
Eugène DELATRE
Maurice DUFRÈNE
Paul FOLLOT
Édouard FORTINY
Maurin GAUTHIER
Gustave GURSCHNER
Bernhard HOETGER
Henry JOLLY
Emil KIEMLEN
G. KISS
Abel LANDRY
Georges LEMMEN
Hans Stoltenberg LERCHE
Clément MÈRE
Charles MILÈS
Georges MINNE
Koloman MOSER
Gabriel OLIVIER
Manuel ORAZI
Blanche ORY-ROBIN
Paul-Élie RANSON
Jakab RAPOPORT
Auguste RODIN
SAINT-YVES SCHLESINGER
Elisabeth SCHMIDT-PECHT
Tony SELMERSHEIM
Louis Comfort TIFFANY
Henry VAN DE VELDE
Heinrich VOGLER
Félix VOULOT
François WALDRAFF
Pour citer cet article :
Bertrand MOTHES, « La Maison Moderne de Julius Meier-Graefe » dans Catherine Méneux, Emmanuel Pernoud et Pierre Wat (ed.), Actes de la Journée d’études Actualité de la recherche en XIXe siècle, Master 1, Années 2012 et 2013, Paris, site de l’HiCSA, mis en ligne en janvier 2014.

L’hôtel Mezzara deviendra le musée Guimard !
Après plus de vingt ans d’engagement, Le Cercle Guimard voit son projet devenir réalité : l’hôtel Mezzara accueillera bientôt le musée Guimard, dédié à l’un des maîtres de l’Art nouveau. Vingt-deux ans après la création du Cercle Guimard, et dix-neuf ans après notre première exposition à l’hôtel Mezzara (Guimard, album d’un collectionneur), notre association franchit aujourd’hui une étape déterminante vers la création du musée Guimard. Nous sommes fiers de vous annoncer que notre équipe — Le Cercle Guimard, Hector Guimard Diffusion, avec les co-financeurs FABELSI et la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) — a remporté l’appel à candidatures pour un bail emphytéotique de cinquante ans de l’hôtel Mezzara, chef-d’œuvre d’Hector Guimard classé monument historique. Le courrier officiel nous a été adressé le 23 juin 2025.

Hall de l’hôtel Mezzara, état actuel. Photo F. D.
Depuis que cette propriété de l’État a été déclarée « d’inutilité au service public », il y a dix ans, notre association a déployé toute son énergie et mobilisé toutes ses ressources pour faire de l’hôtel Mezzara le futur musée Guimard. Le tournant stratégique de notre action a eu lieu en 2017 avec l’organisation de l’exposition Hector Guimard, précurseur du design, conçue pour démontrer le potentiel de l’hôtel Mezzara en tant qu’écrin muséal. Son retentissement médiatique a permis de faire connaître notre projet au public.
Grâce à l’architecte et historien belge Maurice Culot, nous avons rencontré en 2018 l’entrepreneur passionné de patrimoine Fabien Choné, qui a offert un nouveau souffle à notre démarche. Avec sa structure Hector Guimard Diffusion, nous sommes devenus co-porteurs du projet muséal privé, que nous avons depuis structuré et développé ensemble. Deux appels d’offres lancés par l’État ont été déclarés infructueux, avant que notre candidature ne soit enfin retenue lors du troisième.
Toutes ces années ont permis de professionnaliser Le Cercle Guimard, de constituer une collection, de créer un centre d’archives et une maison d’édition — Les Éditions du Cercle Guimard, dont le premier ouvrage a été consacré à l’hôtel Mezzara — de poursuivre les projets de rééditions et de numérisation, de développer la recherche sur Hector Guimard et ses créations, et d’installer le siège de l’association dans l’ancienne agence de l’architecte, au Castel Béranger.
Une période exaltante s’ouvre désormais : aux côtés de spécialistes de l’Art nouveau, d’artisans d’art, de restaurateurs, d’architectes et de partenaires culturels et institutionnels, nous allons concevoir un musée à la hauteur de l’un des plus grands architectes du tournant du XXe siècle.

Loggia de l’hôtel Mezzara, au second étage de la façade sur rue, vue extérieure. Photo F. D.
Nous remercions chaleureusement, en tout premier lieu, nos adhérents et les membres du conseil d’administration pour leur fidélité, leur engagement et leur patience tout au long de ces années de mobilisation.
Nous pensons avec reconnaissance à Jean-Pierre Lyonnet, premier président du Cercle Guimard, qui nous a quittés il y a plusieurs années, ainsi qu’à tous les anciens membres du bureau qui ont contribué activement au développement de l’association. Merci Arnaud, merci Bruno.
Nous avons également une pensée émue pour les premiers “hectorologues”, dont certains sont encore membres du Cercle : Henri Poupée, Roger-Henri Guerrand, Alain Blondel, Michèle Blondel, Yves Plantin, Laurent Sully Jaulmes et Ralph Culpepper.
Nous sommes bien sûr aussi très reconnaissants envers Philippe Thiébaut, conservateur général honoraire du patrimoine et Georges Vigne, conservateur du patrimoine, qui ont fait très notablement progresser les connaissances sur Hector Guimard par leurs recherches, leurs expositions et leurs publications.
Mais nous remercions aussi :
La DRFIP, la Direction de l’immobilier de l’État, le service local du Domaine de Paris, le ministère de la Culture, la DRAC Île-de-France, ainsi que les membres de la commission d’analyse des candidatures, pour la confiance qu’ils nous ont accordée.
La RATP pour son soutien actif à la valorisation de l’héritage de Guimard.
Les musées et institutions qui nous soutiennent et annoncent de belles collaborations :
Le musée d’Orsay
Le Musée des Arts décoratifs (MAD Paris)
La Cité de l’architecture et du patrimoine
La fondation Le Corbusier
Les Archives de Paris
Le musée de l’École de Nancy.
La Ville de Paris, et en particulier Karen Taïeb, adjointe à la Maire de Paris, dont le soutien constant et décisif fut essentiel, notamment en initiant en 2023 l’Année Guimard qui a largement contribué à faire connaître notre projet.
La mairie du 16e arrondissement pour son engagement en faveur du musée, et tout particulièrement :
Jérémie Redler, maire du 16e
Samia Badat-Karam, première adjointe
Bérengère Gréé, conseillère de Paris.
Le département de la Haute-Marne et la ville de Saint-Dizier pour leur mobilisation en faveur des fontes artistiques de Guimard, avec le concours de :
La fonderie GHM
Le musée municipal de Saint-Dizier et son conservateur Clément Michon
Élisabeth Robert-Dehault et tous les acteurs locaux engagés.
La Normandie et la ville de Cabourg, où Guimard construisit trois villas emblématiques (La Sapinière, La Bluette, La Surprise), avec le soutien de :
La Villa du Temps Retrouvé
Tristan Duval, Emmanuel Porcq, Roma Lambert.
Nos partenaires américains, qui ont largement contribué à la reconnaissance internationale de Guimard :
Le Driehaus Museum
L’Art Institute of Chicago
L’Alliance Française de Chicago
Le Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum de New York
Le Virginia Museum of Fine Arts
Delta Air Lines.
Et nous adressons également des remerciements appuyés à Barry Bergdoll, David Hanks, Sarah Coffin, Ingrid Gournay, David Dozier, Elisabeth Cummings.
En Catalogne, nous remercions Teresa Sala, Professeur d’Histoire de l’Art à l’Université de Barcelone et spécialiste du Modernisme catalan.
En Belgique, nous remercions le Horta Museum et son conservateur Benjamin Zurstrassen, ainsi que Françoise Aubry. Notre projet vise également à renforcer les liens entre Bruxelles et Paris autour de l’Art nouveau.

Loggia de l’hôtel Mezzara, au second étage de la façade sur rue, vue intérieure. Photo O. P.
Nous remercions également les professionnels qui ont contribué à la qualité et à la solidité de notre dossier de candidature :
Rydge Avocats, pour leur accompagnement juridique
KPMG, pour leur expertise financière et fiscale
Beaux-Arts Consulting, pour leur expertise stratégique et culturel
Thibierge Notaires, pour le volet notarial
REVA (Bruno Donzet et Maurice Masri), pour l’économie du projet
Picard Expertise, pour l’évaluation immobilière
Dozier Stratégie, conseils en partenariat et financement culturel.
Enfin, nous exprimons notre profonde gratitude à toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont soutenu ce projet : élus, chercheurs, musées, institutions, associations, journalistes, collectionneurs et passionnés — en France comme à l’étranger. À toutes les personnes qui, même brièvement, ont croisé notre chemin et apporté leur aide ou leurs conseils au bon moment, nous disons également merci. Ces dix années d’efforts nous ont permis de nouer de nombreux liens solides, souvent amicaux, que nous n’oublierons pas.
Le bureau du Cercle Guimard
Nicolas Buisson, Frédéric Descouturelle, Nicolas Horiot, Peggy Laden, Dominique Magdelaine, Olivier Pons

La Maison Moderne de Julius Meier-Graefe — Première partie
Grâce à notre adhérent suisse Michel Philippe Dietschy-Kirchner, nous sommes entrés en contact avec Bertrand Mothes qui est l’auteur d’une étude sur La Maison Moderne, fondée à Paris par le critique d’art allemand Julius Meier-Graefe. Souvent négligée au profit de sa concurrente plus connue La Galerie de l’Art Nouveau de Siegfried Bing, elle a pourtant édité des artistes décorateurs de premier plan, comme Maurice Dufrène. Ses liens avec Guimard sont ténus, indirects, mais non inexistants. Bertrand Mothes nous fait l’honneur de nous confier un résumé de son travail.
La dernière décennie du XIXe siècle est une période de changement radical dans le domaine des arts décoratifs en Europe. Artistes, mécènes, critiques, institutions participent activement à ce mouvement de renaissance des arts appliqués, certes selon des voies et des idées propres à chacun, mais toujours dans un objectif de rupture par rapport au pastiche historiciste dans lequel se sont enfermés les artistes décorateurs et les architectes durant la seconde moitié du siècle. Dans ce climat d’émulation, le rôle des marchands ne doit pas être négligé. En 1895, Siegfried Bing ouvre les Galeries de l’Art nouveau au 22, rue de Provence à Paris[1]. Si cette galerie est aujourd’hui la mieux connue et celle dont l’historiographie est la plus riche, il est important de prendre en compte l’environnement des galeries d’art parisiennes de la période, environnement dont fait partie La Maison Moderne. Cet établissement, fondé par le critique et historien d’art allemand Julius Meier-Graefe en 1899, s’inscrit face à l’Art Nouveau de Bing comme le second pôle du commerce des arts décoratifs novateurs dans la capitale française au tournant du siècle. Comme la Galerie de L’Art Nouveau, La Maison Moderne est une boutique où le Parisien peut venir meubler son habitation, acheter des œuvres d’art, des bibelots ou des accessoires de mode. Sa structure et son fonctionnement diffèrent cependant de ceux du 22 rue de Provence, et correspondent à l’état d’esprit du propriétaire des lieux. De même, la sélection des artistes — certains œuvrent pour les deux enseignes — est une manifestation des choix esthétiques de Julius Meier-Graefe.
L’âme de La Maison Moderne
Le premier élément à étudier pour comprendre la genèse de La Maison Moderne est la définition des buts de son créateur, Julius Meier-Graefe. En effet, la galerie est modélisée selon sa volonté, et c’est lui qui incarnera son âme durant toute la période où elle sera en activité. Fils d’Edward Meier, un des chefs de file de l’industrie sidérurgique en Allemagne, et de Marie Graefe qui décède en le mettant au monde[2], Julius Meier-Graefe est né le 10 juin 1867 à Reșița[3]. Sa famille déménage en Rhénanie et le jeune Julius grandit près de Düsseldorf. Il obtient l’Abitur en 1879 et débute des études industrielles en vue de reprendre les affaires paternelles[4], en 1888 à Munich puis l’année suivante à Zurich et à Liège. Il semble alors déjà attiré par le monde de l’art : il visite l’Exposition universelle de 1889 à Paris et part pour Berlin dès 1890. Il commence alors des études d’histoire de l’art sous l’enseignement d’Herman Grimm et quitte Berlin sans avoir été diplômé[5].

Edvard Munch, portrait de Julius Meier-Graefe, 1894. huile sur toile, haut. 100 cm, larg. 75 cm, collection: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, photo : Høstland, Børre, Creative Commons – Attribution CC-BY.
L’année 1893 voit les premières implications de Meier-Graefe dans le domaine artistique : il aide son ami Edvard Munch à organiser une exposition et publie son premier ouvrage, le roman Nach Norden (« Vers le Nord »). Il voyage cette même année en Angleterre où il rencontre les plus importants représentants de l’Aesthetic Movement et des Arts and Crafts que sont Oscar Wilde, William Morris, Edward Burne-Jones et Aubrey Beardsley[6]. En 1894, il participe à la fondation de l’association Pan et devient l’éditeur de la revue éponyme qui l’accompagne. Il partage le titre de rédacteur en chef avec l’écrivain Otto Julius Bierbaum. Meier-Graefe s’occupe de la rédaction des articles ayant trait aux beaux-arts et Bierbaum se charge de ceux qui sont consacrés à la littérature[7].

Franz von Stuck, Couverture de la revue Pan, avril-mai 1895. Coll. Université de Heidelberg. Droits réservés.
Il commence alors à écrire sur les arts décoratifs. Selon lui, la peinture a perdu son contact avec la société et il est nécessaire de se tourner vers les arts appliqués pour pouvoir espérer faire renaître l’art[8]. Meier-Graefe souhaite ainsi adjoindre un salon d’art à l’association Pan. Il veut faire de ce salon un endroit neuf, en rupture avec les expositions organisées alors et qui ne contentent plus le public, et se propose de réunir dans des intérieurs cohérents tous les arts, sans distinction entre beaux-arts et arts appliqués. Son but est alors de rallier artistes et spectateurs et de créer un milieu « moderne et harmonieux »[9]. Cette idée de salon d’art semble avoir émergé dans son esprit après son voyage avec Siegfried Bing en Belgique au printemps 1895. Ils visitent à Bruxelles la Maison d’Art de la Toison d’Or. Cette galerie, fondée en 1894 par la Société Anonyme l’Art, est installée dans l’hôtel particulier d’Edmond Picard, au 56 avenue de la Toison d’Or, et est dirigée par son fils William Picard. Le but de la Société Anonyme l’Art, qui est de stimuler la production des arts appliqués, se retrouve dans le procédé de présentation choisi qui est alors totalement nouveau : l’aménagement de l’hôtel est conservé et les objets – des œuvres d’art et d’artisanat contemporain destinées à la vie quotidienne – sont exposés dans les pièces. Cette manière de procéder diffère de l’ordonnancement habituel dans les galeries de l’époque qui consiste à simplement disposer les objets en vente sur des étagères dans des lieux sans âme et sans décoration. Bing et Meier-Graefe sont impressionnés par son aspect novateur[10]. Immédiatement après leur passage à la Maison d’Art, Meier-Graefe et Bing rendent également visite à Henry Van de Velde qui vient d’amorcer la construction de sa nouvelle maison, le Bloemenwerf, à Uccle. Dans ses mémoires, Van de Velde évoque alors « un voyage qui devait les renseigner sur le réveil des métiers d’art en Angleterre et dans divers pays du continent. De Bruxelles, ils devaient gagner l’Angleterre, reviendraient par la Hollande pour se rendre au Danemark, en Allemagne, en Autriche et en Tchécoslovaquie[11]. »

Vue du Bloemenwerf, maison d’Henry Van de Velde, construite en 1895 à Uccle dans la banlieue de Bruxelles. Droits réservés.
Van de Velde poursuit en exposant les intentions et les propositions de Meier-Graefe, qui compte nourrir son réseau de connaissances et trouver de nouveaux sujets d’articles afin de participer au développement des revues d’art en Allemagne. Ainsi Meier-Graefe propose à Van de Velde de figurer parmi les collaborateurs étrangers de la revue Pan. Les deux voyageurs sont alors, semble-t-il, convaincus de la nécessité de travailler avec Van de Velde et ne tarissent pas d’éloges sur son goût en matière d’aménagement intérieur[12]. Au moment du départ, Bing exprime son envie de reprendre contact avec Van de Velde en vue d’une éventuelle collaboration lorsqu’il sera de retour à Paris. C’est à la fin de ce voyage que Meier-Graefe encourage Bing à transformer sa galerie parisienne, enthousiasmé par l’exemple édifiant que constitue la Maison d’Art comme galerie novatrice.
À la fin de l’année, Meier-Graefe quitte l’association Pan à la suite d’une discorde liée à la publication, dans le numéro de septembre-novembre 1895 de la revue, d’une lithographie d’Henri de Toulouse-Lautrec, Mademoiselle Lender, en buste, jugée immorale par certains membres du comité de rédaction[13].

Henri de Toulouse-Lautrec, Mademoiselle Marcelle Lender en buste, 1895, lithographie en couleurs sur papier, Vente Tajan, Paris, 3 mai 2022, lot 43. Droits réservés.
Il part alors vivre à Paris dans les mois qui suivent, tout en continuant à collaborer avec des revues allemandes. À partir de cette date, Meier-Graefe écrit peu au sujet de la peinture et se focalise sur les arts décoratifs. En parallèle à cette activité d’écriture il devient à la fin de l’année 1895 conseiller artistique de Siegfried Bing dans sa galerie L’Art nouveau et y organise des expositions[14].

La galerie de L’Art nouveau Bing, à l’angle de la rue Chauchat et de la rue de Provence, réhabilitation par l’architecte Louis Bonnier en 1895. Photo Édouard Pourchet. Droits réservés.
Le rôle de Meier-Graefe au sein de l’entreprise de Bing le met au centre d’un réseau d’artistes, enrichissant celui déjà constitué en Allemagne. Cependant, son action n’est pas exempte de critiques négatives de la part d’acteurs principaux de la scène artistique française comme Auguste Rodin, Octave Mirbeau ou Edmond de Goncourt, qui l’accusent de vouloir renverser le « bon goût » et la tradition des arts décoratifs français. Meier-Graefe et L’Art nouveau sont cependant défendus par des critiques éminents, tels Camille Mauclair, Gustave Geffroy, Thadée Nathanson ou Roger Marx[15]. Au bout de six mois de collaboration, Meier-Graefe quitte la galerie de Bing. Les deux hommes continuent cependant de se fréquenter.
Julius Meier-Graefe retourne alors à l’écriture. Il décrit dans un article publié dans Das Atelier en 1896, ce qu’il considère comme dépassé dans le domaine de l’aménagement intérieur. Pour lui, la maison d’Edmond de Goncourt, meublée dans le goût du XVIIIe siècle, ne correspond plus au besoin d’un intérieur de la fin du XIXe siècle :
« Une personne moderne ne peut pas vivre dans un bric-à-brac du Second Empire. Arracher quelque chose à une autre époque et la placer dans un nouvel environnement peut être aussi désastreux que les imitations barbares des vieux modèles dans les arts décoratifs[16]. »
Meier-Graefe critiquera également l’aspect « muséal » de cette demeure lors de la vente aux enchères de son contenu en 1897[17]. Cette idée d’anachronisme concernant le décor intérieur et l’ameublement est constante chez Meier-Graefe, qui en fait un argument en faveur de la modernité. Il considère qu’« habiter un salon du plus pur style Régence, équivaut, pour un citoyen de la Troisième République, à s’affubler d’une perruque à marteau et d’un habit à rubans » et qu’un collectionneur meublant son intérieur en style ancien « se donne souvent aussi le ridicule du « Bourgeois Gentilhomme » [18] ».
C’est un autre article de Meier-Graefe, publié en juin 1896, qui fait figure de profession de foi et d’affirmation de son engagement pour le soutien des arts décoratifs modernes[19]. Il y développe son point de vue qui divise l’art entre « milieu extérieur » et « milieu intérieur ». Selon lui, le XIXe siècle a été le siècle du « milieu extérieur » dédié à un art réaliste, et son époque réagit à cette conception artistique avec un art « fantastique » – terme à comprendre aujourd’hui comme « symboliste » – qui aurait pour but d’être « utile ». Il place les arts appliqués au centre de ce renouveau de l’art et considère que la modernité pourra gagner le public via le domaine « neutre » des arts décoratifs. Il fait alors partie des personnes les mieux à même d’accompagner ce développement de l’art décoratif étant donné l’intérêt qu’il y porte mais également grâce à son savoir dans ce domaine et à son réseau de connaissances qui s’étend à toute l’Europe. Il partage ce point de vue avec de nombreux artistes qui commencent à délaisser la peinture et la sculpture afin de se consacrer à l’art « utile », Henry Van de Velde en tête.
Meier-Graefe continue d’écrire et se dote en 1897 du meilleur outil disponible pour véhiculer ses idées, une revue dont il sera le directeur : Dekorative Kunst. Cette revue en langue allemande est cofondée et éditée par le Munichois Hugo Bruckmann. Les articles sont en majorité écrits par Meier-Graefe lui-même, qui signe sous un grand nombre de pseudonymes différents[20]. Formée sur le modèle anglais de The Studio, la revue est internationale par son mode d’édition : publiée en Allemagne mais avec des bureaux installés à Paris. Sa vocation est également de dépasser les frontières comme l’indique le prospectus de lancement. Meier-Graefe y explique que l’œuvre d’art abstraite est devenue une fin en elle-même et ne s’adresse plus qu’à une minorité d’amateurs, alors que le domaine de l’intérieur et de la maison est abandonné à l’offre de fabricants sans scrupules qui se bornent à fabriquer de mauvaises répliques de styles anciens. Une réaction contre cet état de fait serait en marche et la nouvelle revue, consacrée uniquement à l’art décoratif moderne, participerait à ce renouvellement en préparant le terrain. Cet effort dirigé vers les arts appliqués modernes uniquement se démarque des autres revues, créées ou rénovées à la même période, qui se consacrent à l’art moderne autant qu’à l’art ancien, comme la Revue des Arts Décoratif et Art et Décoration, en France, The Studio, en Angleterre et Deutsche Kunst und Dekoration, en Allemagne.
Meier-Graefe ne se contente pas d’écrire sur les arts décoratifs, il met en application ses idées au sein de sa nouvelle revue avec la contribution d’artistes belges : la page de titre du premier numéro de Dekorative Kunst est ainsi dessinée par Henry Van de Velde ou Théo Van Rysselberghe[21]. Meier-Graefe fait appel pour les autres éléments de diffusion de sa revue à un troisième artiste belge, Georges Lemmen, qui dessine deux affiches et un papier à lettres. Meier-Graefe pousse son idée jusqu’à commander à Van de Velde l’aménagement des bureaux de rédaction de la revue au 37 rue Pergolèse, dans le 16e arrondissement[22].

Salle de rédaction de la revue Dekorative Kunst à Paris, 37 rue Pergolèse, reproduit dans Henry Van de Velde, Sembach, Klaus-Jürgen, éd. Hazan, 1989. Au-dessus de la porte, on voit une affiche de Georges Lemmen avec le titre de la revue, et au-dessus de la cheminée, Le Chahut de Seurat (act. au musée d’Orsay). Droits réservés.
Il semble que Meier-Graefe soit déjà à l’origine de la collaboration entre le décorateur belge et Siegfried Bing en 1895[23]. Suite aux réactions négatives suscitées par ses aménagements intérieurs à L’Art nouveau — pour Rodin « Van de Velde est un barbare »[24] — Van de Velde semble ne plus apprécier Paris[25], mais Meier-Graefe, convaincu de son succès possible en France, fait tout pour l’y faire reconnaître.

Salon aménagé par Henry Van de Velde pour l’ouverture de la Galerie de l’Art Nouveau Bing en 1895. Cliché reproduit dans l’ouvrage de Gabriel P. Weisberg, Les Origines de l’Art Nouveau, la maison Bing, éditions du Musée des Arts décoratifs, 2004. Droits réservés.
Au vu du succès rencontré par Dekorative Kunst et afin de propager encore plus largement ses idées, Meier-Graefe fonde la revue L’Art décoratif, pendant en français de la publication originelle. Le premier numéro est disponible en octobre 1898[26]. Il est entièrement consacré à Henry Van de Velde à qui Meier-Graefe fait appel pour le dessin de la couverture[27] ainsi que pour un nouvel aménagement des bureaux de la revue.

Henry Van de Velde, couverture du premier numéro de la revue L’Art Décoratif, octobre 1898. Bibliothèque de I’Institut national de l’histoire de l’art, collections Jacques Doucet. Droits réservés.

Julius Meier-Graefe et son épouse dans son bureau de la rédaction de la revue L’Art Décoratif, 37 rue Pergolèse à Paris, vers 1898-1899. Au mur à droite, Madone de Edvard Munch. Photo Bibliothèque royale de Belgique, Archives et Musée de la littérature, reproduit dans Henry Van de Velde Passion Fonction Beauté, publié à l’occasion de l’exposition éponyme au musée du Cinquantenaires à Bruxelles, 2013, éditions Lanoo, Tielt, 2013. Droits réservés.
Le sous-titre de L’Art décoratif, Revue internationale d’art industriel et de décoration est à lui seul un résumé du combat que Meier-Graefe a entrepris l’année précédente dans le monde germanophone et qu’il souhaite engager dans le monde francophone. Sa ligne de conduite est précisée dans la préface du premier numéro. Il ambitionne de trouver une manière rationnelle d’organiser la production et la diffusion des objets d’art modernes. Il veut rompre avec la tradition française qui met en valeur la « chose rare »[28]. Il déplore la situation des industries d’art de l’époque, qui pousse les artistes décorateurs à ne répondre qu’à des commandes de collectionneurs fortunés et n’incite pas les industriels possédant les infrastructures nécessaires à la fabrication d’objets en grande quantité à faire appel à des artistes pour dessiner leurs modèles, produisant uniquement des objets copiant les styles anciens. Meier-Graefe veut changer cet état de fait et souhaite réconcilier les artistes avec l’industrie « qui peut seule rendre le beau accessible au grand nombre[29] ». Dès le troisième numéro de L’Art décoratif , sa volonté de contribuer au commerce de l’art transparaît : un éventail de Georges de Feure tiré à cent exemplaires est proposé aux lecteurs de la revue, qui doivent s’adresser à la rédaction afin de commander l’objet[30]. Il s’agit de la première action de Meier-Graefe en tant que marchand d’art.
Le besoin d’une nouvelle galerie
Un changement radical se fait sentir dans l’action de Meier-Graefe. Même s’il quitte l’Art nouveau de Bing pour se concentrer sur ses activités d’écriture, il continue à considérer celle-ci comme étant la structure idéale pour la diffusion du style moderne à Paris. Cependant, au cours des dernières années du siècle, celui-ci amorce un changement dans le concept décoratif qu’il souhaite mettre en avant à L’Art nouveau. À peine un an après l’ouverture de la galerie, les bénéfices ne semblent déjà pas être à la hauteur de ses espérances, comme le souligne Paul Signac : « Les affaires ne marchent pas du tout ; il ne sait ni ce qu’il veut, ni ce que les clients veulent. Il est aux abois et je pense qu’il ne tardera pas à passer à d’autres exercices[31] ». Bing commence dès lors à favoriser des artistes ayant une conception plus « française » des arts décoratifs[32]. Ce « retour » à la « tradition française » du meuble voit son aboutissement lors de l’Exposition Universelle de 1900 où le pavillon de Bing présente des œuvres de Georges de Feure, Édouard Colonna et Eugène Gaillard.

Vitrine et fauteuil en bois doré de Georges de Feure dans le pavillon Bing à l’Exposition Universelle de Paris en 1900. Portfolio Meubles de style moderne Exposition universelle 1900. Coll. part.
Meier-Graefe, lui « ne permettra aucune sorte de compromis, au moins pour le moment[33] ». Il a de plus déjà pris conscience des enjeux économiques et financiers que peut avoir une entreprise comme L’Art Nouveau. Les entreprises de Louis Majorelle et de Gustave Serrurier-Bovy sont alors des modèles d’établissements florissants aux procédés distincts de ceux de Bing. Même si celui-ci installe son propre atelier afin de créer des objets de luxe pour sa galerie, Meier-Graefe considère qu’il a alors « sous-estimé l’énorme croissance de ce marché de produits nouveaux » et qu’il ne tient pas compte du contexte concurrentiel propre aux galeries de mobilier parisiennes[34].
Ces différents facteurs conduisent Meier-Graefe à envisager la création de sa propre galerie d’art privée, qu’il dirigera, et où il exposera uniquement les œuvres d’artistes correspondant à sa vision de l’art décoratif moderne. En 1899, Meier-Graefe a déjà longuement réfléchi au problème et ses idées sont arrivées à maturité. Le projet est lancé dans le courant de l’année. Grâce aux « ressources de son sentiment instinctif et de ses connaissances[35] », Meier-Graefe commence à réunir une « équipe » d’artistes chargés de choisir les œuvres qu’il va vendre dans sa galerie mais également comment et par qui elle sera aménagée. À partir de cette date, il abandonne progressivement la direction éditoriale de Dekorative Kunst et de L’Art décoratif pour se consacrer entièrement à son projet[36]. Il peut de plus débuter son affaire grâce à un fort apport d’argent hérité de son père décédé en 1899. L’absence d’archives ne nous permet cependant pas de savoir si Meier-Graefe a pu bénéficier d’un soutien financier autre que son héritage et son investissement personnel lors de la création de sa galerie[37]. Son changement d’activité et son implication de plus en plus importante sont loués dans la préface des Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle publiée en 1901 par La Maison Moderne :
« Voici dix ans ce fut son plaisir de soutenir, dans les revues, avec une chaleur d’âme passionnée, la doctrine de l’égalité des arts […] ; mais M. Meier-Graefe ne s’est pas contenté de l’action contemplative et d’ordinaire inefficace dévolue au critique ; il a entendu faire la preuve de ses dires, passer de la théorie à la pratique, de la propagande au fait.[38] »

Devanture de La Maison Moderne, 82 rue des Petits-Champs à Paris, Deutsche Kunst und Dekoration, 1900, reproduit dans Henry van de Velde, Ein europäischer Kunstler seiner Zeit, Sembach/Schulte, catalogue des expositions éponymes 1992-1993, éd. Weinand-Verlag, Köln, 1992. Droits réservés.
L’ouverture de la galerie est rapportée par les revues dont il est encore le directeur. Le numéro de septembre 1899 de L’Art décoratif comporte une page rédigée par Meier-Graefe lui-même (sous un pseudonyme) annonçant l’ouverture prochaine de La Maison Moderne, « une nouvelle maison de production et de vente d’objets d’art usuels[39] ». Le numéro suivant précise la date de cette ouverture prévue pour la deuxième quinzaine d’octobre, et annonce qu’un vernissage aura lieu où seront conviés les lecteurs abonnés à la revue[40]. L’ouverture au public est cependant reportée, comme en témoigne le numéro de novembre 1899, « par suite de travaux d’aménagement que les entrepreneurs n’avaient pas prévus[41] ». Il s’agit de la dernière mention d’une ouverture prochaine de la galerie. La lettre envoyée par Van de Velde à sa femme Maria, datée du 15 novembre 1899 et mentionnant l’ouverture de la galerie, nous permet d’estimer plus précisément la date de cet événement qui a dû avoir lieu entre le 1er et le 15 novembre 1899. Van de Velde explique que l’ouverture de La Maison Moderne n’a pas été un événement mondain aussi fameux que celle de L’Art nouveau quatre ans plus tôt, sans toutefois s’en inquiéter : « Cette ouverture n’est pas sensationnelle, tant s’en faut mais néanmoins je crois au succès de l’entreprise[42] ». Malgré le peu d’enthousiasme généré par la création d’une nouvelle galerie, Meier-Graefe et ses collaborateurs sont alors convaincus de leur potentiel novateur et de la réussite future de leur action.

Aménagement intérieur de La Maison Moderne à Paris, Deutsche Kunst und Dekoration, 1900, reproduit dans Henry Van de Velde Passion Fonction Beauté, publié à l’occasion de l’exposition éponyme au musée du Cinquantenaires à Bruxelles, 2013, éditions Lanoo, Tielt, 2013. Droits réservés.
La Maison Moderne est, pour son créateur, une entreprise sans précédent : opposée aux salons et aux expositions officielles par la multiplicité des objets exposés et par leur présence en plusieurs exemplaires mais également opposée aux grands magasins grâce à l’indiscutable qualité artistique des objets proposés à l’achat, elle est aussi différente des boutiques dépendantes d’ateliers comme chez les frères Daum ou chez Louis Majorelle. La Maison Moderne fait partie du même type d’enseigne que la galerie de Bing, mais là encore, Meier-Graefe considère qu’une grande différence — autre que stylistique — les sépare. Contrairement à Bing qui choisit de plaire à une clientèle très aisée, Meier-Graefe veut inclure son établissement dans « une nouvelle catégorie de « galeries d’art moderne » qui répondrait aux besoins d’un nombre de plus en plus important de personnes pour lesquelles les objets vendus dans les boutiques existantes sont difficilement accessibles[43] ». Le public visé est donc bien plus large que celui de Bing. La raison mise en avant pour ce choix est la volonté de mettre l’art à la portée du plus grand nombre. Selon le rédacteur de la préface des Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, « la création de la Maison Moderne n’a pas eu d’autre origine que la volonté bien arrêtée de satisfaire un idéal qui avait été celui de William Morris, chez nos voisins d’Outre-Manche, et que, jusqu’en 1898, nul n’avait réussi à réaliser parmi nous[44] ». Cette volonté sociale mise en avant à l’ouverture de la galerie peut également s’expliquer par le fait qu’un commerce vendant des objets de qualité à prix raisonnable peut s’attendre à réaliser un plus grand nombre de ventes qu’une galerie comme celle de Bing, et donc à être viable économiquement. En effet, l’aspect financier de La Maison Moderne est un élément important à prendre en compte : si les idées de Meier-Graefe sont honorables et sa volonté de remplir les espaces d’habitation des ménages modestes sont louables, il lui faut pour réussir son entreprise une prospérité financière certaine. L’idéal social propre au mouvement Art nouveau est ainsi soumis à la réussite économique, sans laquelle aucune création et diffusion d’objets nouveaux n’est possible. Cette bonne santé financière encouragerait de plus les artistes les plus renommés à vouloir collaborer avec la galerie. Ces principes directeurs sont dès le départ présents dans la ligne de conduite de la galerie et sont explicités dans les articles qui accompagnent son ouverture[45]. Dans la préface des Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, les principes de fonctionnement et la variété des objets vendus sont mis en avant. Max Osborn explique un an après l’ouverture la place prise par la galerie dans le milieu du marché de l’art parisien et le rôle de son directeur :
« L’un des phénomènes caractéristiques les plus récents de l’époque actuelle, où l’art et l’artisanat sont enfin réunis après une trop longue séparation, c’est le bazar des arts décoratifs, établissement hybride qui tient le milieu entre la galerie d’art et le grand magasin, proposant à la fois des produits de luxe et des objets d’usage courant, et dont le propriétaire est une combinaison insolite de connaisseur, d’artiste, de critique d’art, de mécène, et d’homme d’affaires au sens le plus noble du terme[46] ».
Max Osborn met également en évidence le côté paradoxal de la situation des arts décoratifs parisiens : les deux enseignes les plus importantes sont dirigées par des Allemands qui tentent suivant leur propre voie d’« enraciner » l’Art nouveau en France. Van de Velde mentionne dans ses mémoires la force de volonté dont fait preuve Meier-Graefe à l’égard de sa conception des arts décoratifs mais exprime des doutes sur sa capacité à pouvoir mener un projet de cette envergure :
« La Maison Moderne devait se différencier des galeries Art Nouveau de Samuel Bing par l’intransigeance de son programme ; il s’agissait d’y rassembler cette partie du public qui se sentait attirée par une évolution de la peinture et de la sculpture vers des formes sûres, vers des qualités essentielles. Julius Meier-Graefe était de taille à réaliser un tel programme. Il ne manquait certes pas d’ambition, mais de moyens financiers et de la persévérance nécessaire pour se vouer seul à cette mission[47] ».
Les craintes de Van de Velde sont aussi justifiées par l’ampleur que veut donner Meier-Graefe à sa galerie. S’il ouvre son premier établissement à Paris, il souhaite également créer des antennes dans toute l’Europe œuvrant à la diffusion d’un art industriel moderne[48].

Aménagement intérieur de La Maison Moderne à Paris, Deutsche Kunst und Dekoration, 1900, reproduit dans Henry Van de Velde Passion Fonction Beauté, publié à l’occasion de l’exposition éponyme au musée du Cinquantenaires à Bruxelles, 2013, éditions Lanoo, Tielt, 2013. Droits réservés.
L’initiative de Meier-Graefe est alors très novatrice en France et La Maison Moderne doit être le tremplin d’une nouvelle alliance entre art, industrie et commerce. Il tente de constituer alors le seul trio capable d’offrir à une critique et à un public réticent des objets et des ameublements abordables, un trio qui serait constitué de l’artiste, du fabricant et du marchand[49]. Une fois sa galerie ouverte et ce jusqu’à sa vente, Meier-Graefe va progressivement se désengager de la direction de Dekorative Kunst et de L’Art décoratif, même si le partage de bureaux administratifs de la rue des Petits-Champs entre la galerie et les périodiques ainsi que la fréquence d’articles publiés par lui dans les deux revues indiquent que ce désengagement ne sera jamais total. S’il se présente volontiers comme directeur de La Maison Moderne et de L’Art décoratif, il lui est difficile de concilier ouvertement la direction d’une galerie d’art moderne avec la rédaction d’articles dans des revues militant pour la même cause[50]. Il réussit à mener une action concertée grâce à l’utilisation de son nom réel à la tête de La Maison Moderne et à l’emploi de pseudonymes pour la publication de ses articles.
Si la fondation de Dekorative Kunst puis de L’Art décoratif ont placé Meier-Graefe sur le devant de la scène artistique parisienne, la création de La Maison Moderne le distingue comme l’un des acteurs principaux du marché de l’art au début du XXe siècle. Il dispose alors de tous les moyens nécessaires pour diffuser ses idées grâce aux écrits publiés et aux objets proposés à la vente. De plus sa qualité de directeur de galerie lui permet de sélectionner les artistes avec lesquels il souhaite collaborer et constitue par ce biais un réseau de création à l’échelle européenne pouvant contribuer à alimenter le climat d’émulation qui règne alors dans la capitale française. Cependant, son positionnement en tant que défenseur d’un art décoratif moderne, déterminé à « déclarer la guerre au goût français et à la situation en France », fait de La Maison Moderne une entreprise risquée, qui doit convertir au plus vite le public parisien au goût moderne sous peine de disparaître.
Bertrand Mothes
Notes
[1] Cat. exp. Les origines de l’Art nouveau: la Maison Bing, Anvers, Fonds Mercator, Paris, Les Arts décoratifs, Amsterdam, Van Gogh Museum, 2004.
[2] Lee SORENSEN, « Julius Meier-Graefe », Dictionary of Art Historians, [http://www.dictionaryofarthistorians.org/meiergraefej.htm].
[3] Ville de Banat, aujourd’hui en Roumanie.
[4]Kenworth MOFFETT, Meier-Graefe as Art Critic, Munich, Prestel-Verlag, 1973, p. 9.
[5] Lee SORENSEN, « Julius Meier-Graefe », Dictionary of Art Historians, [http://www.dictionaryofarthistorians.org/meiergraefej.htm].
[6] Cat. exp. Alexandre Charpentier (1856-1909). Naturalisme et Art Nouveau, Paris, Musée d’Orsay, N. Chaudun, 2007, p. 126.
[7] Jean-Michel LENIAUD, L’Art nouveau, Paris, Citadelles & Mazenod, 2009, p. 453-454.
[8] Cat. exp. Art nouveau : Symbolismus und Jugendstil in Frankreich, Stuttgart, Arnoldsche, 1999, p. 150.
[9] Catherine KRAHMER, « Meier-Graefe et les arts décoratifs, un rédacteur à deux têtes » dans Alexandre KOSTKA, Françoise LUCBERT (dir.), Distanz und Aneignung, Relations artistiques entre la France et l’Allemagne 1870-1945, Berlin, Akademie Verlag, 2004, p. 232.
[10] Cat. Exp Georges Lemmen 1865-1916, Bruxelles, Crédit Communal, Gand, Snoeck-Ducaju & Zoon, Anvers, Pandora, 1997, p. 51.
[11] Henry VAN DE VELDE, Récit de ma vie. 1, Anvers, Bruxelles, Paris, Berlin (1863-1900), texte établi et commenté par Anne VAN LOO et Fabrice VAN DE KERCKHOVE, Bruxelles, Versa, Paris, Flammarion, 1992, p. 263.
[12] La conversation a lieu dans le salon de musique de la maison de la belle-mère de Van de Velde, qu’il vient de réaménager pour Irma Sèthe, sœur de sa femme Maria, avec un papier peint à motif de dahlias.
[13] Roger CARDON, Georges Lemmen (1865-1916), Anvers, Petraco-Pandora, 1990, p. 448.
[14] Les origines de L’Art nouveau : la Maison Bing, op. cit., note 1, p. 236.
[15] MOFFETT, op. cit., note 4, p. 28.
[16] Julius MEIER-GRAEFE, « L’Art Nouveau. Das Prinzip », Das Atelier, 1896, n °5, p. 2-4 ; traduction par Edwin Becker dans Les origines de L’Art nouveau : la Maison Bing, op. cit. note 1, p. 129-131.
[17] MOFFETT, op. cit., note 4, p. 28.
[18] Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle. Reproductions photographiques des principales œuvres des collaborateurs de la Maison Moderne. Commentées par R. [Raoul] AUBRY, H. [Henri] FRANTZ, G.-M. JACQUES [pseud. Julius MEIER-GRAEFE], G. [Gustave] KAHN, J. [Julius] MEIER-GRAEFE, Gabriel MOUREY, Y. [Yvanhoé] RAMBOSSON, E. [Émile] SEDEYN, Gustave SOULIER, G. [Georges] BANS, avec neuf hors textes par Félix VALLOTTON Les Métiers d’Art. Paris, Édition de La Maison Moderne, 1901, p. 11 [Préface].
[19] Julius MEIER-GRAEFE, « Dekorative Kunst », Neue Deutsche Rundschau, juin 1896, p. 543-560.
[20] Sur les pseudonymes de Meier-Graefe, voir KRAHMER, op. cit. note 9, p. 248-249.
[21] Catherine Krahmer attribue le dessin de la couverture à Van de Velde (KRAHMER, op. cit. note 9, p. 233) et Roger Cardon l’attribue à Van Rysselberghe (CARDON, op. cit. note 13, p. 445-446).
[22] CARDON, op. cit. note 13, p. 176.
[23] VAN DE VELDE, op. cit. note 11, p. 267.
[24] VAN DE VELDE, op. cit. note 11, p. 277.
[25] LENIAUD, op. cit. note 7, p. 129.
[26] VAN DE VELDE, op. cit. note 11, p. 341.
[27] La composition de Van de Velde sera utilisée comme couverture de L’Art décoratif jusqu’au n° 24 de la revue, en septembre 1900.
[28] KRAHMER, op. cit. note 9, p. 239.
[29] Julius MEIER-GRAEFE [n. s.], « Préface », L’Art décoratif, octobre 1898, n °1, p. 2.
[30] L’Art décoratif, décembre 1898, n° 3, n. p.
[31] Lettre de Paul Signac à Charles Angrand, 30 décembre 1896, archives privées, citée dans Paris-Bruxelles, Bruxelles-Paris symbolisme, art nouveau : les relations artistiques entre la France et la Belgique, 1848-1914, cat. exp., Paris, Réunion des musées nationaux, Anvers, Fonds Mercator, 1997, p. 393.
[32] Nancy J. TROY, Modernism and the Decorative Arts in France : Art Nouveau to Le Corbusier, New Haven et Londres, Yale University Press, 1991, p. 32.
[33] « Meier-Graefe lässt sich, wenigstens vorläufig, auf solche Kompromisse nicht ein » (Max OSBORN, « La Maison Moderne in Paris », Deutsche Kunst und Dekoration, novembre 1900, vol. VII, p. 102).
[34] Stephen ESCRITT, L’Art nouveau, Paris, Phaidon, 2002, p. 316.
[35] Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, op. cit., note 18, p. IV [Préface].
[36] Art nouveau : Symbolismus und Jugendstil in Frankreich, op. cit.,note 8, p. 151.
[37] TROY, op. cit., note 32, p. 46.
[38] Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, op.cit., note 18, p. I [Préface]. Cette reconnaissance de l’action de Meier-Graefe est à modérer : il semble qu’il soit lui-même l’auteur de la préface des Documents sur l’Art Industriel au vingtièème siècle ainsi que celui du commentaire de la section « Ameublement », étant mentionné sur la page de garde comme l’un des contributeurs à l’ouvrage alors qu’aucun des textes signés ne l’est de son nom. Il est cependant indiscutablement l’auteur du commentaire sur les objets en métal et objets d’éclairage, signé sous son pseudonyme G.-M. Jacques.
[39] R. [pseud. Julius MEIER-GRAEFE], « Chronique de l’art décoratif, La « Maison Moderne » », L’Art Décoratif, septembre 1899, n° 12, p. 277.
[40] R. [pseud. Julius MEIER-GRAEFE], « Chronique de l’art décoratif, La « Maison Moderne » », L’Art Décoratif, octobre 1899, n° 13, p. 51.
[41] R. [pseud. Julius MEIER-GRAEFE], « Chronique de l’art décoratif, La « Maison Moderne » », L’Art Décoratif, novembre 1899, n° 14, p. 96
[42] Paris-Bruxelles, Bruxelles-Paris, op. cit., note 31, p. 392.
[43] TROY, op. cit., note 32, p. 43 ; ESCRITT, op. cit., note 34, p. 318.
[44] Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle, op. cit., note 18, p. I [Préface].
[45] R., op. cit., note 3_9, p. 277.
[46] OSBORN, op. cit., note 33, p. 99.
[47] VAN DE VELDE, op. cit., note 11, p. 357.
[48] KRAHMER, op. cit., note 9, p. 240.
[49] Rossella FROISSART PEZONE, L’art dans tout. Les arts décoratifs en France et l’utopie de l’Art Nouveau, Paris, CNRS Éditions, 2004, p. 69.
[50] [50] KRAHMER, op. cit., note 9, p. 237.

Parution du livre consacré à l’architecte Jules Lavirotte
La dernière publication du Cercle Guimard est à présent disponible dans trois librairies parisiennes et bientôt dans d’autres établissements.
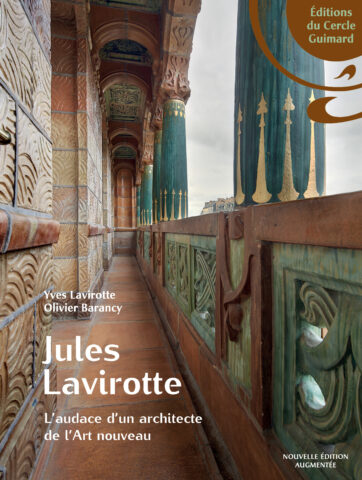
Deux librairies spécialisées :
– Le Cabanon, 122 rue de Charenton, 75012 Paris
– Librairie du Camée, 70 rue Saint André des Arts, 75006 Paris
ainsi qu’à la librairie Villa Browna, idéalement située 27 avenue Rapp, mitoyenne de l’immeuble phare de Lavirotte.
Une dédicace aura lieu le 17 juin à 19h 15 à la libraire Le Cabanon, en présence des auteurs.

Immeuble Logilux, 1904 (Céramic hôtel), 34 avenue de Wagram. Photo F. D.
Rappelons également que l’exposition consacrée à Jules Lavirotte à Évian est ouverte du 1er juin au 30 septembre 2025, à la villa du Châtelet où le livre est également disponible.

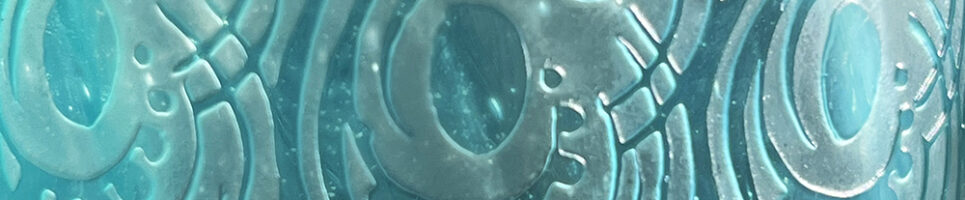
Un rare vase en cristal de Guimard
Pisté depuis des années, ce vase exceptionnel est tout récemment entré dans les collections de notre partenaire pour le projet de musée Guimard. Des négociations au long cours ont abouti à l’acquisition de cet objet rare, le premier de son genre à être identifié et décrit. Contrairement à d’autres domaines des arts décoratifs où Guimard a abondamment créé, il a en effet très peu produit pour la verrerie.

Vase Guimard de la Cristallerie de Pantin, haut. 40,2 cm, diamètre extérieur au niveau de l’ouverture : 5,2 mm, diamètre extérieur à la base : 12,7 cm, poids, 1,437 kg. Coll. part. Photo F. D.
La forme générale est celle, assez banale pour la verrerie de style Art nouveau, d’un « vase bouteille » pouvant se décomposer en trois parties : une base très aplatie soulignée par un ressaut, un fût très légèrement conique et un rétrécissement sommital avant l’inflexion de l’ouverture vers l’extérieur. Cette forme, pourvue de côtes tournoyantes, semble inédite chez Guimard qui n’a pas tenté de reproduire les silhouettes de ses modèles conçus pour le bronze ou pour la céramique. Mais comme nous le verrons plus loin, sommes-nous certains que Guimard soit l’auteur de cette forme ?
Ce vase est longtemps resté dans la famille du vendeur, mais il n’a pas été possible d’en connaitre les conditions d’achat originelles. Il est en bon état, malgré quelques griffures et la marque d’un léger dépôt calcaire montrant qu’il a été utilisé à une époque comme vase à fleurs.
Il a été produit à la Cristallerie de Pantin[1], comme l’indique la signature gravée en intaille à son culot, autour du logo « STV » reprenant les initiales du nom exact de la cristallerie : Stumpf, Touvier, Viollet & Cie.
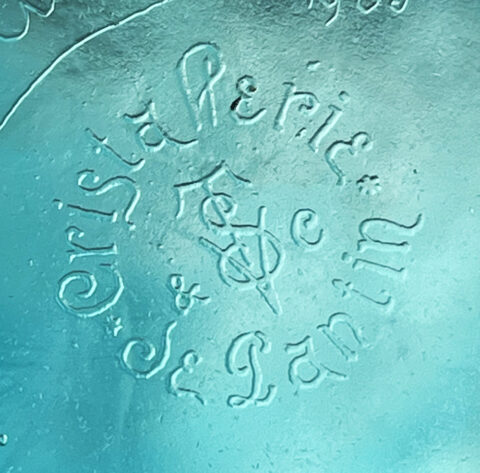
Signature de la Cristallerie de Pantin au culot du vase. Coll. part. Photo Justine Posalski.
Haut de 40,2 cm et pesant 1,437 kg, il a un volume de 0,480 litre. Ces deux dernières données permettent de calculer sa densité : 2,99, très proche de celle du cristal au plomb classique (3,1).

Calcul du volume du vase Guimard de la Cristallerie de Pantin. Coll. part. Photo Fabien Choné.
La question de la nature exacte de son matériau se posait, même si le vase provient d’une cristallerie, car nous avons établi que les verrines des candélabres des accès du métro produites par cette même cristallerie à partir de 1901 étaient en verre, sans ajout de plomb. Le Cercle Guimard en a récemment acheté un exemplaire.

Verrine d’un candélabre du métro Guimard. Coll. Le Cercle Guimard. Photo F. D.
Le culot du vase est également porteur de la signature manuscrite et cintrée de Guimard. Elle est caractérisée par la continuité du graphisme en un seul trait joignant le prénom et le nom et se terminant par le long paraphe revenant les souligner. On note que son exécution à la pointe est un peu plus hésitante que celle du logo de la cristallerie pour lequel l’ouvrier affecté à cette tâche répétitive disposait d’un pochoir.

Signature de Guimard au culot du vase de la Cristallerie de Pantin. Photo Justine Posalski.
Le millésime « 1903 » figure également sous la signature et nous renvoie à l’époque du pavillon que Guimard a édifié au sein de la nef du Grand Palais pour l’Exposition de l’Habitation cette année-là. À cette occasion il a fait éditer la série de cartes postales Le Style Guimard reproduisant ses principales œuvres architecturales.

Le pavillon « Le Style Guimard » au sein de l’Exposition de l’Habitation au Grand Palais en 1903. Carte postale ancienne n° 1 de la série Le Style Guimard. Coll. part.
Dans la liste des collaborateurs qui figure sur le prospectus joint à l’emballage de la série de ces cartes postales, on retrouve la mention de la Cristallerie de Pantin, au 66 rue d’Hauteville, lieu de son dépôt parisien.
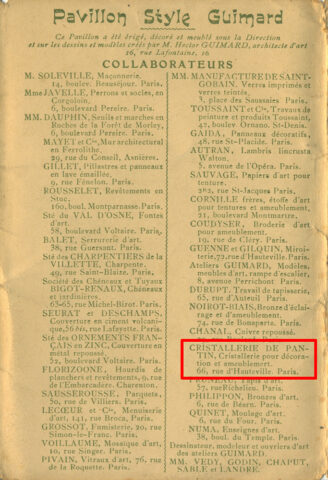
Vue partielle du prospectus de l’emballage de la série des cartes postales Le Style Guimard. Coll. part.
La cristallerie figurait dans cette liste de collaborateurs, d’une façon certaine pour les verrines du portique d’accès de métro qui encadrait l’entrée du pavillon de Guimard, et sans doute aussi pour un autre produit exposé : probablement des vases, comme le suggère le descriptif que Guimard a associé au nom du fournisseur : « cristallerie pour décoration et ameublement ». Mais les vues de l’intérieur du pavillon que nous connaissons ne montre pas malheureusement pas ces vases. D’ailleurs, rien n’indique qu’à cet instant les cristaux présentés dans le pavillon étaient déjà le fruit d’une collaboration entre l’architecte et la Cristallerie de Pantin. Guimard a pu tout simplement choisir des produits de la cristallerie sur catalogue afin de décorer les meubles exposés. L’année suivante, en revanche, nous avons acquis la certitude que cette collaboration a abouti. Dans l’opuscule que Guimard a édité à l’occasion du Salon d’automne de 1904, il a détaillé son envoi par catégories. Le numéro 4 des « Objets d’art Style Guimard » est décrit de la façon suivante : « Vase Style Guimard en cristal aigue marine. Prix : 65 francs ».
Cette dénomination « aigue-marine » n’a pas été inventée par Guimard qui, au contraire, s’est inséré dans une production de la Cristallerie de Pantin qui avait démarré quelques années plus tôt. Elle fait bien sûr référence au nom de la pierre fine, une variété de béryl, de couleur bleu clair, évoquant la mer. Ces nuances bleutées, difficiles à obtenir, ont été recherchées de façon empirique par différentes cristalleries françaises. Émile Gallé à Nancy a ainsi obtenu avec un monoxyde de cobalt une couleur d’un bleu très léger nommée « clair de lune », dévoilée à l’Exposition universelle de 1878. À la Cristallerie de Pantin, pour obtenir un verre légèrement opacifié à irisations intermédiaires turquoises, le jaune du dioxyde d’urane et le vert d’un oxyde de chrome ont été mêlés au bleu de cobalt.
La première mention de production de cristaux « aigue-marine » par la Cristallerie de Pantin que nous connaissons a fait l’objet d’une page du catalogue de la Maison Moderne[2] paru en 1901.
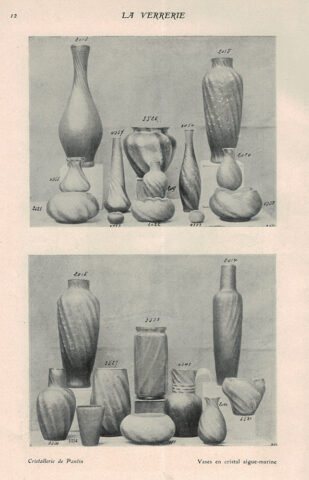
Documents sur l’Art Industriel au vingtième siècle (catalogue de La Maison Moderne), Paris, Edition de La Maison Moderne, 1901, p. 12, « Crisallerie de Pantin/Vases en cristal aigue-marine ». Coll. part.
Sur les deux photographies de cette page, vingt-deux vases de différentes formes et d’une couleur qui ne peut être que bleutée présentent tous des côtes tournoyantes, souvent régulièrement ponctuées de reliefs comme le sont les surfaces des coquillages, autre manière de rappeler l’inspiration marine de la série. Le ou les auteurs de ces formes modernes ne sont pas mentionnés, signe qu’il s’agit probablement d’employés de la cristallerie[3].
Le vase en cristal de Guimard ne nous était pas complètement inconnu puisque les documents de la donation Adeline Oppenheim-Guimard conservés à la Bibliothèque des Arts Décoratifs permettent d’en identifier au moins deux exemplaires décorant un meuble probablement présenté au Salon d’Automne.

Coll. Bibliothèque des Arts Décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.
Au sein du même ensemble documentaire, un autre modèle de vase torsadé, avec une base plus piriforme et un col plus effilé, est très proche du n° 4357 de la page du catalogue de la Maison Moderne (cf. supra). L’intervention de Guimard n’y est pas pour autant attestée.

Coll. Bibliothèque des Arts Décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.
Autre exemple de vase qui pourrait provenir de la Cristallerie de Pantin, le modèle en cristal translucide présenté dans la vitrine du grand salon de l’hôtel Guimard reprend le même type de torsades.

Détail de la vitrine du grand salon de l’hôtel Guimard. Coll. part.
On notera qu’aucun de ces vases ne présente de décor floral surajouté imitant le style des verreries nancéiennes Gallé et Daum. Il s’agit peut-être d’une demande expresse de la Maison Moderne, exigeant une certaine sobriété plus conforme à la ligne belge de Van de Velde qu’elle défend. Car, en dehors de la Maison Moderne, la Cristallerie de Pantin a produit de nombreux modèles de vases « aigue-marine » à décor floral que l’on retrouve de temps à autre sur le marché de l’art.

Vase « aigue-marine » à décor floral gravé à l’acide de la Cristallerie de Pantin, galerie en ligne les_styles_modernes, vente sur eBay Pays-Bas, mai 2025, haut. 24,8 cm, diam. 10,3 cm, poids, 796 g. Photo les_styles_modernes, droits réservés.

Vase « aigue-marine » à décor floral gravé à l’acide de la Cristallerie de Pantin, galerie en ligne les_styles_modernes, vente sur eBay Pays-Bas, mai 2025, haut. 24,8 cm, diam. 10,3 cm, poids, 796 g. Photo les_styles_modernes, droits réservés.
Comme ces vases, celui de Guimard possède lui aussi un décor gravé à l’acide, mais qui lui est propre et qui témoigne des recherches qu’il a menées pour renouveler son style semi-abstrait en s’éloignant progressivement des arrangements harmoniques de lignes courbes ou capricieuses qui le caractérisaient autour de 1900.

Détail du décor du vase Guimard de la Cristallerie de Pantin. Coll. part. Photo F. D.
Encore une fois, il n’est pas simple de décrire ou d’interpréter ce décor qui laisse l’imagination de l’observateur trouver ses propres références. Si une inspiration végétale parait toujours présente avec des tiges et des fleurs fortement stylisées et répétées dix fois sur la circonférence, un motif s’inspirant de la clef de sol n’est pas impossible.

Détail du décor du vase Guimard de la Cristallerie de Pantin. Coll. part. Photo F. D.
Certains des dessins aquarellés de projets de frises, non datés, donnés par sa veuve Adeline Oppenheim au Musée des Arts Décoratifs présentent quelques similitudes stylistiques.

Guimard, détail d’un projet pour une frise, aquarelle sur papier. Coll. Bibliothèque des Arts Décoratifs, don Adeline Oppenheim-Guimard, 1948. Photo Laurent Sully Jaulmes.
D’autres éléments du décor comme les filets bleus ou la coloration jaune en partie haute nous permettent d’avancer des hypothèses quant au processus de fabrication du vase. Comme pour toute fabrication, le verrier cueille dans le four une paraison avec sa canne creuse et lui donne une première forme ébauchée par soufflage et balancement. Puis il roule la paraison sur le « marbre » (une table en fonte dépolie) pour lui adjoindre des poudres d’os calcinés et d’arséniates qui y ont été préalablement disposés et qui donneront au verre un aspect satiné sur toute la hauteur du vaisseau ainsi qu’une coloration jaune au niveau de son quart supérieur. De plus, des filets bleus également torsadés, visibles en partie supérieure et en partie inférieure du vase, ont été préparés à l’avance, posés puis recouverts d’une nouvelle couche de verre reprise dans le four. Il s’agit donc d’un décor intercalaire et non de la technique habituelle des filets vénitiens qui sont plaqués en surface.

Col du vase Guimard de la Cristallerie de Pantin avec les filets bleus intercalaires. Coll. part. Photo F. D.

Base du vase Guimard de la Cristallerie de Pantin avec les filets bleus intercalaires. Coll. part. Photo F. D.
Le vaisseau de verre étant toujours au bout de la canne (du côté de la future ouverture), la base est ébauchée par gravité et tamponnement contre le marbre. Puis il est introduit dans le moule bivalve et soufflé de façon à être plaqué sur les parois. C’est à ce moment que l’essentiel des reliefs tournoyants est donné. Une fois le moule ouvert, le vaisseau est repris sous la base à l’aide d’une petite masse de verre en fusion au bout d’une barre de fer (le pontil). Du côté opposé, le col reçoit une torsion (comme en témoigne la disposition des bulles d’air qui suivent ce mouvement) avant d’être détaché de la canne en le coupant aux ciseaux et en le façonnant à la pince.

Col du vase Guimard de la Cristallerie de Pantin. Coll. part. Photo Justine Posalski.
Après un léger refroidissement qui assure sa stabilité, le vaisseau est enrobé d’une couche mince d’un verre d’un bleu plus intense que le verrier va cueillir dans un second four. Le vase est alors détaché du pontil qui lui laisse une cicatrice sous la base. Après un refroidissement progressif, il reçoit un traitement à l’acide fluorhydrique du verre bleu plaqué en surface. Pour dégager le décor qui sera conservé en bleu, on a préalablement protégé sa surface par un vernis (à cette époque du bitume de Judée), tandis que les surfaces non protégées sont éliminées par l’acide jusqu’à faire apparaitre le verre sous-jacent. Sous la base, la trace du pontil est effacée par meulage et polissage pour pouvoir y graver le logo de la cristallerie et la signature de Guimard comme nous l’avons vu plus haut. En revanche, au niveau de l’ouverture, les irrégularités de surface qui subsistent montrent que le verre n’a pas été retravaillé par meulage.

Col du vase Guimard de la Cristallerie de Pantin. Coll. part. Photo F. D.
Si ce vase est parvenu si tardivement à la connaissance des spécialistes de Guimard, c’est tout d’abord en raison de sa rareté. Son exécution encore imparfaite, visible notamment par son bullage assez conséquent, semble indiquer qu’il a fait partie d’une série qui a été des plus réduite. L’autre raison est que son attribution à Guimard n’est pas évidente au premier regard. Il est même probable qu’en l’absence de signature[4] et malgré son décor naturaliste abstrait, ce vase n’aurait pas sans doute pas suscité le même intérêt de notre part, ni les recherches qui en ont découlé pour retrouver les rares indices permettant de le localiser au sein de l’œuvre de Guimard. En même temps qu’il a eu la volonté de simplifier le Style Guimard en le résumant à un simple décor sur un objet pouvant s’accommoder finalement de tous les styles d’intérieurs, il est tout à fait probable que Guimard ait aussi fait le choix d’une forme de vase déjà existante à la Cristallerie de Pantin — forme qui n’était d’ailleurs pas nécessairement déjà commercialisée — et qu’il l’ait « guimardisée », reproduisant en cela la même démarche qu’avec les produits de certains autres fabricants comme nous l’avons démontré pour les vases en grès édités par Gilardoni & Brault[5].
Frédéric Descouturelle et Olivier Pons,
avec l’aide de Justine Posalski et de Georges Barbier-Ludwig.
Notes
[1] La cristallerie a été fondée en 1847, au 84 de la rue de Paris à Pantin et reprise en 1859 par E. Monot, ancien ouvrier de la cristallerie de Lyon. Elle a rapidement prospéré, devenant la cinquième cristallerie française puis, après la guerre de 1870 (et le passage de la cristallerie de Saint-Louis en territoire allemand), la troisième (après Baccarat et Clichy). La cristallerie usinait industriellement une gamme complète de produits qu’elle exposait dans son magasin parisien de la rue de Paradis. Son dépôt était également à Paris, au 66 rue d’Hauteville. La raison sociale a évolué : « Monot et Cie », puis « Monot Père et Fils et Stumpf », puis « Stumpf, Touvier, Viollet & Cie » après le retrait de Monot en 1889. Elle a été absorbée en 1919 par la verrerie Legras (Saint-Denis et Pantin Quatre-Chemins).
[2] Fondée par le critique d’art Julius Meier-Graefe à la fin de l’année 1899, cette galerie consacrée à l’art décoratif moderne entrait en concurrence avec celle plus connue de Siegfried Bing, L’Art Nouveau. Deux articles lui seront très prochainement consacrés par Bertrand Mothes.
[3] Pour d’autres produits, le catalogue indique le nom des auteurs des modèles. Dans ce cas, on peut penser que le contrat passé entre la galerie et l’auteur spécifiait que le nom de ce dernier devait être mentionné.
[4] Un autre exemplaire de ce vase a été répertorié et figure dans l’ouvrage « Le génie verrier de l’Europe » (G. Cappa, éd. Mardaga, 1998). Contrairement à notre vase à la couleur « aigue-marine » dominante, celui-ci se caractérise par un cristal incolore doublé de métallisations dégradées faisant davantage la part belle aux nuances « rosathea » et « jaune » tandis que la tonalité « aigue-marine » se concentre sur un petit tiers inférieur. Cet exemplaire ne présentant pas de signature, il est possible qu’il s’agisse d’un prototype.
[5] Cf. notre article sur la « guimardisation » des vases en grès édités par Gilardoni & Brault.

Jules Lavirotte : une nouvelle version du livre est publiée par le Cercle Guimard — une exposition lui est consacrée à Évian — l’établissement des Eaux minérales du Châtelet
En 2018, l’association Jules Lavirotte a publié un premier livre consacré à la vie et à l’œuvre d’un architecte à la renommée paradoxale puisque si son nom et quelques-unes de ses œuvres sont bien connus du public, sa vie et sa carrière étaient jusque là pratiquement ignorées des spécialistes eux-mêmes. Cette année, les auteurs, Yves Lavirotte et Olivier Barancy, ont choisi le Cercle Guimard pour la publication de la nouvelle édition de l’ouvrage revue et augmentée. Même si la première version — à présent épuisée — était remarquable, cette nouvelle édition la surpasse. Sur 192 pages et avec de nombreuses illustrations, les auteurs complètent la carrière de l’architecte d’informations inédites et de nouvelles œuvres. Le livre sera disponible à partir des derniers jours du mois de mai, au prix de 35 €. Sa parution sera suivie d’une présentation dédicace et de visites guidées consacrées à l’œuvre de Lavirotte, des évènements sur lesquels nous reviendrons bientôt.
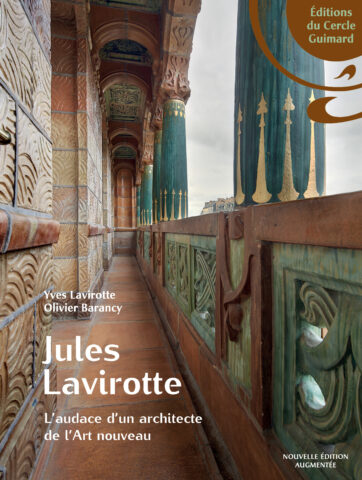
Pour le lancement de cette nouvelle édition, les auteurs ont saisi l’occasion d’une exposition consacrée à l’architecte et organisée avec leur concours par la ville d’Évian à la villa du Châtelet, du 1er juin au 30 septembre 2025.

Olivier Barancy nous livre ci-après l’histoire de l’établissement thermal construit à Évian par Lavirotte et dont la villa du Châtelet est un des bâtiments subsistants.

Vue générale de la buvette, côté lac, tirage photographique ancien. Coll. part.
À la suite de l’acquisition, le 4 avril 1906, par MM. Arthur Sérasset et Émile Lavirotte de terrains bâtis au bord du lac Léman à Évian-les-Bains, Jules Lavirotte est pressenti par ses frères pour construire un établissement thermal sur les terrains tout juste acquis. L’architecte se met immédiatement au travail et les travaux débutent rapidement.

Jules Lavirotte dans une galerie de la buvette, tirage photographique ancien. Coll. part.
Le projet est important : sur un terrain pentu d’environ 15 000 m2, avec un linéaire de plus de 100 m le long d’une route très passante qui longe le lac, doit s’élever au 29 quai Paul-Léger un premier bâtiment neuf, la « buvette ». Celle-ci doit intégrer une petite villa néo-Renaissance, de construction récente (1898) et coquettement distribuée. Un patio imaginé par l’architecte résoudra la jonction entre la construction neuve et la partie existante, qui accueillera les bureaux. La buvette comprend tous les aménagements nécessaires pour recevoir les curistes, ainsi que les services commerciaux liés aux bureaux. En complément, deux villas existantes, dont celle dite du Châtelet qui donne son nom au complexe thermal, sont aménagées pour loger les curistes, ainsi que le bâtiment des communs et la maison du jardiner, en haut du parc, qui accueillent le personnel. La buvette, de style Art nouveau tardif, se développe sur trois niveaux. Le rez-de-chaussée abrite la partie commerciale d’embouteillage, incluant un quai de déchargement couvert et les services. L’étage comprend, côté lac, une grande galerie promenoir à colonnes accouplées, flanquée d’une salle de lecture et d’un grand salon ; et côté sud, à l’opposé du lac donc, « une buvette luxueusement aménagée » reliée à une « salle de lunch ». Le tout est couvert par des terrasses en ciment armé auxquelles on accède par un escalier abrité dans un gracieux campanile à l’Ouest de la façade. À l’Est et à l’angle opposé un autre campanile, à la fine silhouette, s’élance jusqu’à 16 mètres. Ces deux édicules permettent de signaler de loin l’établissement, selon un procédé architectural assez répandu dans la composition d’un édifice public. L’aménagement intérieur est luxueux : un grand vitrail[1] au fond de la galerie sud représente un paysage de montagnes enneigées d’où s’écoule un torrent ; aux murs, des fresques à l’antique présentent des fontaines et des guirlandes ; et du plafond pendent des lustres à branches dorées, ornés de feuilles à trois tons et de grappes en verre de Murano[2] ; des mosaïques enfin recouvrent le sol. Dans le parc, un ruisseau serpente entre des rocailles et traverse un kiosque rustique où parvient également l’eau d’une seconde source, à l’arrière du « châtelet ». L’établissement est inauguré fin 1910.
Françoise Breuillaud-Sottas, spécialiste du thermalisme à Évian, a souligné l’originalité du projet : « Seule la source du Châtelet est associée à un véritable établissement hydrothérapique. »

Une galerie de la buvette, coté parc, tirage photographique ancien. Coll. part.
En parallèle, l’administrateur de la Société des Sources du Chatelet et associé d’Émile Lavirotte, Arthur Sérasset, confie à Jules Lavirotte les « pleins pouvoirs » afin de trouver puis d’aménager des boutiques à Paris pour commercialiser les bouteilles d’eau minérale. Il en réalisera au moins deux, au 36 boulevard des Italiens et au 56 boulevard de Bercy. Les finitions de la buvette semblent soignées car certains prestataires sont les mêmes que ceux qui interviennent à l’hôtel particulier de l’avenue de Messine à Paris. Enfin l’architecte réalise en 1909 à Évian, 4 avenue du Port, l’Office des baigneurs ; c’est un local modeste pour une agence immobilière, propriétaire également du journal Évian Mondain.
En revanche, le complément de commande pour la construction du grand hôtel qui domine le parc est difficile à obtenir car l’assemblée des actionnaires reproche à Lavirotte le manque de suivi pour le premier établissement et le dépassement budgétaire. Elle exige la présence sur place d’un architecte adjoint : ce sera Étienne Curny (1861-1945), actif à Lyon et dans sa région. Les grandes lignes du projet établi en 1907 sont plus classiques que la buvette quoiqu’on note avec intérêt la grande terrasse avec vue sur le lac, l’audacieuse marquise de l’entrée côté sud et les frises florales qui ceignent le bâtiment sous l’attique ; mais à la demande des commanditaires, les plans sont fortement modifiés pour abaisser les coûts et augmenter le nombre de chambres. La façade nord en particulier, avec ses balcons, ses deux avant-corps et son comble habité dissymétrique en ardoises n’a pas grand-chose à voir avec l’esquisse initiale. Lavirotte finalement n’intervient plus.

Auguste Labouret, grand vitrail de la buvette, du côté parc. Photo Christophe Lavirotte.
En 1925, éclate un scandale autour de l’eau des Sources Évian-Châtelet : ses dirigeants, dont son président M. Bocheux, sont condamnés à plusieurs mois de prison ferme pour la commercialisation d’eau minérale non conforme aux normes sanitaires. L’année suivante, l’hôtel du Châtelet prend le nom d’hôtel du Parc. Puis en 1938 la buvette est démolie[3] pour laisser place à une route qui relie le quai à l’hôtel où le 18 mars 1962 seront signés les accords d’Évian, mettant fin à la guerre d’Algérie.
Olivier Barancy
Notes
[1] Dû à Auguste Labouret (1871-1964), prolifique maître verrier installé à Paris.
[2] Jules Lavirotte est allé lui-même les choisir à Venise.
[3] Certains éléments seront conservés et mis en scène dans le parc.

Camille Gauthier à Nancy, de collaborateur de Louis Majorelle à fabricant de meubles à bon marché
Notre amie Justine Posalski, membre du Cercle Guimard depuis plusieurs années, vient d’obtenir son doctorat en histoire de l’Art qui a porté sur la carrière de l’un des acteurs majeurs de l’École de Nancy, Camille Gauthier (1870-1963). Son nom a été popularisé par la marque « Gauthier-Poinsignon » et par son importante production de meubles modernes à bon marché que nous avons déjà évoquée ici, mais sa biographie avait été encore peu explorée. À la demande de son directeur de thèse, Justine Posalski a exploré le côté social et innovant de l’activité commerciale de Gauthier, notamment par sa technique de vente. Cependant, ses recherches l’ont conduite à s’intéresser de plus près au contexte dans lequel se sont nouées ses relations avec Louis Majorelle (1859-1926). C’est cet aspect peu connu et qui remet en question certaines opinions acquises que nous lui avons proposé de présenter dans cet article.

Anonyme, portrait de Camille Gauthier, tirage photographique d’époque. Coll. Musée de l’École de Nancy.
Jusqu’à présent, les exégètes de Majorelle, assez discrets sur le sujet, se contentaient de considérer que Camille Gauthier n’avait joué qu’un rôle mineur de simple collaborateur subalterne. Mais la lecture de missives des archives personnelles de la fille de Camille Gauthier indique que son père avait été recruté au sein de la firme nancéienne pour y exercer les fonctions de directeur artistique. Faute d’archives consultables, il convient donc d’examiner plus attentivement les éléments chronologiques qui permettent de rééquilibrer le rôle de chacun.
Initialement fondée à Toul par Auguste Majorelle (1825-1879), la société Majorelle a été transférée à Nancy en 1861. Après le décès de son père, Louis Majorelle a interrompu ses études à l’École nationale des Beaux-Arts de Paris pour revenir à Nancy et s’occuper de l’entreprise familiale qui bénéficie alors d’une réputation solidement établie et d’une popularité qui est synonyme d’excellente marche des affaires. À la céramique qui est à l’origine du succès du fondateur, se sont ajoutées la fabrication de meubles décorés au vernis Martin et la vente de reproductions de mobilier de style qui ont renforcé le renom de la firme nancéienne. Le goût de Louis Majorelle pour la peinture et sa proximité avec la jeune garde des peintres lorrains vont le conduire à s’orienter vers une politique de création novatrice, en associant ses anciens condisciples à la production d’œuvres d’exception.
En 1882, il sollicite le peintre Émile Friant (1863-1932) afin que ce dernier réalise la décoration de la porte d’un meuble sur le thème du roman de Miguel de Cervantes Don Quichotte de la Manche. En 1886, il s’adresse aux frères Jules (1833-1887) et Léon Voirin (1833-1898) pour réaliser l’ornementation de la face intérieure d’un paravent destiné à la cour royale des Pays-Bas. Les frères Voirin, en collaboration avec Majorelle, réalisent cinq paravents. Le succès est tel que Majorelle sollicitera la fratrie pour exécuter cinq autres paravents. Pour l’Exposition universelle de 1889, c’est un somptueux lit traineau néo-Louis XV dont les panneaux sont décoré au vernis Martin d’après Watteau qui attire l’attention sur la maison Majorelle.
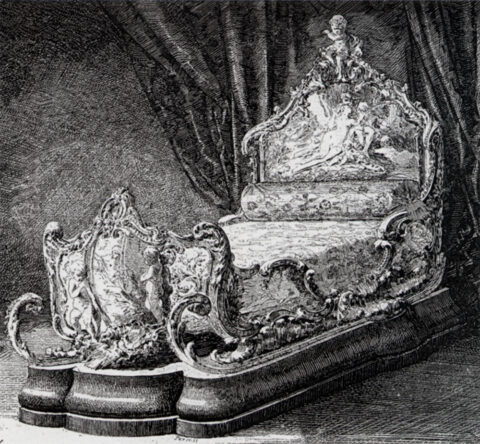
Maison Majorelle, lit traineau présenté à l’Exposition Universelle de 1889, décoré d’après Watteau.
L’année 1893 s’avère être un tournant dans l’évolution de la maison Majorelle. Sur un plan juridique, la société en nom collectif prend alors la dénomination de « Majorelle Frères ».
Cette même année, Camille Gauthier, né dans les environs de Nancy, élève à l’École des Beaux-Arts de Nancy puis pendant trois ans à l’École nationale des Arts Décoratifs de Paris[1], regagne sa province d’origine pour être embauché par Louis Majorelle qui se consacre désormais exclusivement à la direction artistique de la firme familiale. Ce dernier a pressenti qu’il était dans l’air du temps d’abandonner les modèles d’un passé révolu afin — à l’instar d’Émile Gallé — de se tourner résolument en direction de la modernité. Il a compris que l’avenir ne saurait se contenter de la répétitivité sclérosante du mobilier créé par son père et qu’il convenait de donner à ses ateliers une toute nouvelle impulsion. Camille Gauthier qui a alors vingt-trois ans a été en contact avec ce qui se faisait de plus avant-gardiste dans la capitale. Le jeune homme semble posséder toutes les qualités nécessaires pour l’aider à relever de nouveaux défis. Son engagement chez Majorelle est d’ailleurs concomitant et symétrique à celui de Jacques Gruber chez Daum[2]. Ces deux émules d’Émile Gallé dans le domaine de l’ébénisterie et de la verrerie de style moderne ont ainsi misé sur de jeunes artistes lorrains mais dont la formation avait été parachevée dans la capitale. Il est également à noter que, quelques années plus tard, d’autres influences purement parisiennes comme celles de Tony Selmersheim ou d’Henri Sauvage ont marqué l’évolution moderne du mobilier de Majorelle.
Un examen attentif d’un catalogue commercial illustré titré « Majorelle Nancy » [3], postérieur à 1890 mais antérieur à l’exposition de 1894, nous fournit un certain nombre d’indications fiables[4] sur le virage moderne de la maison Majorelle. On y constate que l’ameublement n’est pas parmi les catégories les plus mises en avant. Il ne représente qu’un faible pourcentage des produits proposés à la vente, n’apparaissant qu’à la page 48 et se terminant à la 57ème et dernière page du recueil. L’offre débute par de l’ameublement en bambou et natte de Chine, et il est précisé d’emblée que la chambre à coucher est un modèle déposé. Sont ensuite proposés des petits meubles en noyer ciré tels que tables, guéridons, colonnes, gaines, selles[5], etc. Viennent ensuite une page consacrée au « meuble de fantaisie » à la décoration brevetée au Vernis Martin, et en complément une page réservée à l’ébénisterie d’art « style japonais » dont les modèles peuvent être vendus « en bois blanc ou laqués pour être décorés ». Les quatre pages finales concernent une série de mobilier plus classique, dans un style d’esprit rocaille, Louis XVI, rococo ou pseudo Henri II. Il est indiqué que l’ancienne maison Montigny a pour successeur Majorelle dont les magasins et ateliers sont situés à Nancy.
En revanche, en 1894, concurremment avec du mobilier de style Louis XV, Louis XVI et Empire, Majorelle expose, sur son stand de l’Exposition d’art décoratif et industriel lorrain, qui se déroule dans les galeries de la salle Poirel[6], des « meubles d’inspiration moderne ». Outre un plateau de table en bois pyrogravé, on peut admirer une table intitulée La Source, réalisée d’après des dessins de Jacques Gruber (1870-1936), ainsi qu’un meuble composé par Camille Gauthier.

Anonyme, photographie du stand de Louis Majorelle à l’exposition de 1894 aux galeries Poirel, Nancy. Coll. Musée de l’École de Nancy. Au mobilier majoritairement « de style » viennent s’ajouter quelques « meubles d’inspiration moderne ».
Ces éléments sont tout à fait révélateurs du fait qu’avant le recrutement de Camille Gauthier, Majorelle n’est aucunement impliqué dans le mouvement esthétique moderne et se contente de commercialiser une gamme de produits en tous points identiques à ceux en vogue sous le Second Empire. Quoi qu’il en soit, l’arrivée de nouvelles recrues dans la firme nancéienne marque une vraie rupture avec le mobilier quelque peu emphatique pour ne pas dire suranné qui, quelques mois auparavant, marquait l’identité de la maison. De fait, avant 1894, jamais Majorelle n’avait vendu ou réalisé de mobilier orné de marqueterie de bois de placage. Au contraire, après 1894, on ne trouvera plus aucune mention d’un quelconque meuble décoré au vernis Martin.

Anonyme, photographie du Magasin Majorelle, rue Saint-Georges à Nancy, vue de la salle d’exposition du 1er étage, c. 1900. Coll. bibliothèque Forney.
À son retour à Nancy, Gauthier décide de se rallier au mouvement de renouveau artistique lorrain car il le comprend comme un projet de société revendiquant le passage à un art total d’où ne serait pas exclue la dimension sociale. Pour ce jeune homme, l’Art nouveau en général et le mouvement de renouveau artistique lorrain en particulier, sont porteurs d’un projet à la fois artistique, éthique, social et politique.
Pour Majorelle, la décision de se lancer dans la production de mobilier moderne est essentiellement un choix entrepreneurial qui doit induire une réforme et une diversification rapide de la société familiale. Le choix de se consacrer à un style nouveau, en adéquation avec des impératifs de rentabilité et de conquête de parts de marché, suppose de passer d’un atelier artisanal à une fabrication rationalisée impliquant une dimension de plus forte mécanisation. Pressentant que l’avenir réside forcément dans une proposition plus adaptée à la demande du public, la maison Majorelle va apporter un soin particulier à élaborer des modèles de petits meubles à bon marché. Augmenter le volume de fabrication ne fait pas surhausser considérablement les coûts de production et, en dépit des dépenses financières liées à de nouvelles installations, l’accroissement des ventes devrait permettre de rentabiliser rapidement les investissements qu’il convient d’effectuer au plus vite.
Dès son entrée au sein des ateliers Majorelle, Gauthier se familiarise promptement avec le métier d’ébéniste en réussissant à trouver le point d’équilibre entre ses ambitions artistiques et les impératifs de la réalité économique inhérents à la bonne marche d’une entreprise. Son activité principale consiste à dessiner les compositions décoratives ornant les meubles marquetés. Très rapidement, c’est à Gauthier que sera confiée la création du mobilier d’exposition qui doit assurer la notoriété et le prestige de la firme nancéienne. Avec une application constante, Gauthier va appréhender les multiples paramètres techniques permettant de concevoir une production originale de meubles innovants et audacieux, précieux et raffinés mais sachant éviter les écueils de l’afféterie ou de l’ostentatoire.

Louis Majorelle et Gautier (sic) projet pour la décoration d’un salon (fragment). Victor Antoine Champier (1851-1929), Documents d’atelier. Art décoratif moderne, Paris, Librairie Rouan, 1899, pl. XXXI. Coll. part.

Louis Majorelle et Gautier (sic) : projet de cabinet à objets d’art. Victor Antoine Champier (1851-1929), Documents d’atelier. Art décoratif moderne, Paris, Librairie Rouan, 1899, pl. XVII. Coll. part.
C’est à partir de 1897, date du transfert des ateliers de la rue Girardet à la rue du vieil-Aître que l’on assiste véritablement à une transformation de Majorelle qui passe du statut d’artisan d’importance à celui d’industriel d’art. Ainsi, afin de réaliser en série des produits manufacturés de qualité, il était indispensable de posséder un lieu suffisamment conséquent pour accueillir les volumineuses machines modernes qui allaient permettre de répondre à la volonté de Majorelle de devenir un entrepreneur de stature nationale dans le secteur de l’ameublement. Les nouvelles installations sont dimensionnées pour accueillir un personnel conséquent. Camille Gauthier avait jusqu’ici évolué au sein d’une entreprise à caractère quasi-familial entouré par des ouvriers et compagnons fidèles et expérimentés, présents depuis les débuts d’Auguste Majorelle. Il va devoir désormais vivre au quotidien dans un environnement où interagissent plus de cent cinquante intervenants[7]. Parallèlement à l’utilisation de nouveaux procédés, les techniques courantes de l’ébénisterie et de la menuiserie sont bousculées pour se plier aux besoins d’une création originale. Les productions des ateliers Majorelle présentent un large éventail des techniques utilisées dans l’histoire de la marqueterie. Les procédés et les matériaux employés en révèlent une parfaite connaissance.
Gauthier mêle les essences du pays aux bois exotiques en conservant les particularités des ronces, loupes ou gales. Assurément, les dessins naturels des essences permettent de donner du tempérament à la composition, notamment dans le rendu des matériaux. Outre le dessin du veinage et la couleur des bois, le choix du débit des placages permet effectivement de multiplier les effets. Gauthier, loin d’être fidèle à un unique procédé, fait feu de tout bois et multiplie les expériences pour varier les aspects à obtenir.

Majorelle Frères & Cie, trumeau de cheminée, composition marquetée par Camille Gauthier, haut. 1,33 m, larg. 1,11 m, vente Claude Aguttes SAS – Paris, 20 mars 2015, lot n° 99.

Majorelle Frères & Cie, La Cascade, meuble de salon, composition marquetée par Camille Gauthier, signé et daté 1899, haut. 1,676 m, larg. 0,8 m, prof. 0,4 m, vente Phillip’s – New-York, 8 juin 2023, lot n° 78.
Les structures en « Y » (voir ci-dessus) et la mouluration en quart de vrille des montants sont deux marqueurs caractéristiques de l’influence de Camille Gauthier sur les productions signées Majorelle.

Majorelle Frères & Cie, détail du quart de vrille d’une sellette à décor marqueté, collection A-L.P.
Au fil des années, Majorelle a consenti à mettre un peu plus en avant Camille Gauthier en reconnaissant dans sa communication avec la presse l’importance du travail que ce dessinateur effectuait au sein de l’entreprise. Mais le lien de confiance qui présidait à leur relation s’est progressivement délité. Pour le mobilier présenté par Majorelle à l’Exposition universelle de 1900, la part du décor marqueté qui était confié à Gauthier s’est s’amenuisée au profit des décors en bronze et des pentures métalliques prônées par un autre collaborateur de la maison, Alfred Levy[8]. Cela n’est sans doute pas étranger à la rupture qui va s’avérer inéluctable et intervenir au lendemain de l’Exposition au sein de laquelle la maison Majorelle a triomphé, mais sans que Gauthier ne reçoive une distinction.

Coiffeuse présentée par la maison Majorelle à l’Exposition universelle de 1900 avec la collaboration de Camille Gauthier. Porfolio Meubles de style moderne Exposition Universelle de 1900, Charles Schmid éditeur. Coll. part.
Après plusieurs années de relations entre Louis Majorelle et Camille Gauthier, on peut se demander, lequel des deux protagonistes a su le mieux tirer parti de leur collaboration. Camille Gauthier peut s’enorgueillir d’avoir été sollicité par une entreprise de renom, au prestige établi lui ayant proposé un poste de responsabilité alors qu’il n’avait aucune expérience de quelque nature que ce soit. Certes, le jeune Gauthier possédait d’indéniables qualités de dessinateur mais la plupart des étudiants fréquentant les institutions de formation partageait cette caractéristique. Sans doute plus que d’autres, il faisait montre d’une grande motivation à se former et à tout mettre en œuvre pour être admis et reconnu au sein des milieux artistiques qu’il fréquentait.
De son côté, Louis Majorelle, qui avait déjà eu l’occasion de recruter de jeunes talents prometteurs, faisait le pari audacieux d’embaucher un collaborateur inexpérimenté mais le risque qu’il prenait était somme toute assez limité car en cas d’insatisfaction, il avait à tout moment la possibilité d’y mettre un terme. En travaillant au sein d’un atelier où œuvraient les artisans les plus qualifiés, Gauthier gagnait beaucoup de temps dans l’acquisition des connaissances d’un métier qui nécessitait des années d’apprentissage. Il en avait parfaitement conscience et savait qu’en regardant attentivement autour de lui, le modèle Majorelle lui administrait en accéléré la meilleure formation pour comprendre de quelle manière il fallait diriger une entreprise moderne de fabrication de meubles.
Sans Gauthier, Majorelle aurait-il pu réaliser aussi efficacement la conversion qui lui doit d’être considéré comme un des maîtres de l’École de Nancy ? On ne saurait vraiment répondre à cette question. Toutefois, il n’est pas interdit d’imaginer qu’en lieu et place de Camille Gauthier, Majorelle se serait probablement mis en quête d’un autre employé susceptible de remplir ce rôle. Sans Majorelle, Camille Gauthier aurait-il pu trouver l’opportunité lui permettant d’exprimer sa voie dans le domaine artistique ? Là encore, il n’y a pas de réponse définitive face à une telle interrogation et, plutôt que de se lancer dans d’interminables conjectures, on se doit de conclure que la collaboration entre Gauthier et Majorelle s’est effectivement traduite par un résultat mutuellement fructueux.
Après son départ, Camille Gauthier a fondé son propre atelier où il a continué à développer et à réinventer son style personnel, lequel présentait de facto de fortes similitudes avec celui que Majorelle continuait à décliner. Il signe alors « Camille Gauthier » ou « Camil Gauthier » ou « Gauthier le lorrain ».

À gauche : Gauthier Le Lorrain, meuble de collectionneur, publié dans La Lorraine Artiste, 18ème année, n° 10, 1er déc. 1900, p. 157.
Adhérent à l’Alliance Provinciale des Industries d’Art (École de Nancy) au côté de son président Émile Gallé et de son ancien employeur Louis Majorelle, il a exposé avec le groupe nancéien au Pavillon de Marsan à Paris en 1903.

Gauthier & Cie, salle à manger au tulipier, noyer verni. Portfolio Exposition Lorraine/l’École de Nancy/au/Musée de l’Union Centrale des Arts Décoratifs/Pavillon de Marson à Paris/1ère Série : Le Mobilier/Armand Guérinet, Éditeur, 1903, pl. 46. Coll. part.
Son mobilier tend alors vers une certaine simplification car, conformément à ses aspirations sociales, la clientèle recherchée n’est plus celle de l’aristocratie ou de la haute bourgeoisie. Parfois, Gauthier renonce même au décor végétal, omniprésent à Nancy, ne conservant qu’une construction par des lignes souples rapprochant ses créations de celles des parisiens Plumet et Selmersheim.

Camille Gauthier, étagère. Coll. part.
Ce n’est qu’en 1904, en s’associant au tapissier Paul Poinsignon, qu’il peut fonder à Nancy une nouvelle unité de production en série avec vente directe des meubles exposés dans une vaste galerie. En se passant d’intermédiaires et de concessionnaires, par une politique de diffusion de catalogues, de participation à des concours et à des expositions, ses meubles bien exécutés et toujours fidèles à l’esthétique naturaliste de l’École de Nancy vont entrer dans les foyers de la petite et de la moyenne bourgeoisie, bien au-delà de la Lorraine. Mais la société « Gauthier-Poinsignon » a également équipé de nombreux lieux publics, commerces, hôtels et restaurants, tout en restant capable de produire à l’occasion des ensembles plus luxueux.

À gauche : vitrine-casier, acajou et bubinga, sculptures renoncules, marqueteries marguerites, haut ; 1,55 m, larg. 0,65 m, prix 290 F., ateliers Gauthier-Poinsignon, photographie issue du catalogue commercial Gauthier, Poinsignon & Cie, réf. n° 21, 1914, p. 120. Coll. part.
À droite, vitrine-casier à musique – réf. n° 21, signée, haut. 1,58 m, larg. 0,69 m, prof. 0,34 m, vente Millon et associés — Paris, 07 avril 2017, lot n° 76.
En 1909, Gauthier présente à l’Exposition Internationale de l’Est de la France à Nancy un cabinet de travail en chêne lacustre décoré selon la flore et la faune fossile et annonçant l’apparition du style Art Déco ou à tout le moins d’un style post-École de Nancy dont le succès commercial sera considérable. À cette occasion, Majorelle semble à nouveau dépassé stylistiquement et devra s’adapter peu après.

Cabine de travail en chêne lacustre sur l’un des stands de Gauthier-Poinsignon au palais du Génie Civil à l’Exposition Internationale de l’Est de la France à Nancy en 1909. Cliché Henri Bellieni. Coll. part.
La Première Guerre mondiale affecte fortement le moral de Gauthier, d’autant plus que son associé Paul Poinsignon décède brutalement en 1916. La société garde néanmoins le même nom. Désireux de se retirer progressivement, Gauthier cède finalement son entreprise, redevenue prospère, en 1924 au fabricant de meuble toulois Delfour.
Justine Posalski
Notes
[1] Il y côtoie alors le futur décorateur parisien Tony Selmersheim et y croise le nancéien Jacques Gruber. Hector Guimard en est professeur d’octobre 1891 à juillet 1898.
[2] Antonin Daum (1864-1930) ingénieur formé à l’École Centrale à Paris et son frère Auguste Daum (1853-1909), juriste de formation, ont repris la verrerie acquise par leur père et n’ont — contrairement à Louis Majorelle — aucune formation artistique.
[3] Édité par l’imprimerie Camis, sis 59 boulevard Richard Lenoir à Paris.
[4] Catalogue de la maison Majorelle, circa 1892.
[5] Le terme « selle » fait référence à ce qu’aujourd’hui on nomme usuellement sellette.
[6] Inaugurée en 1889, la Salle Poirel est un ensemble culturel situé à Nancy composé d’une salle de spectacle et d’une vaste galerie d’art.
[7] Roselyne Bouvier, Majorelle. Une aventure moderne, Paris-Metz, Éditions Bibliothèque des Arts et Serpenoise, 1991, page 43.
[8] Alfred Lévy (1872-1965) est entré en 1888, à l’âge de 16 ans, chez Majorelle. Sa présence ne semble pas avoir été déterminante dans le virage moderne de la maison Majorelle. Il est resté fidèle à l’entreprise en tant que directeur artistique, assurant la relève de Gauthier après 1900, puis le virage vers l’Art Déco après la Première Guerre mondiale.

Appel à cotisation 2025
Si vous n’avez pas encore renouvelé votre cotisation pour l’année 2025, nous vous invitons à le faire dès à présent.
Vous pouvez adhérer en ligne grâce à Pay Asso, un outil de paiement sécurisé et simple d’utilisation.
Il vous suffit de cliquer sur le lien suivant, puis « J’adhère en ligne », choisir la formule d’adhésion et régler avec votre carte bancaire :

Le 09 avril 2025, dépôt de notre dossier répondant à l’appel d’offre pour l’attribution de l’hôtel Mezzara.
Notre statut d’intérêt général permet au Cercle d’émettre des reçus fiscaux si les adhésions ne bénéficient pas de contreparties. Nous fournissons donc à tous nos adhérents un reçu fiscal. Celui-ci permet aux personnes physiques de déduire 66 % du montant de l’adhésion de ses impôts et aux personnes morales 60 %.
Les adhérents ayant déjà versé leur cotisation en 2025 ont normalement déjà reçu un reçu fiscal par e-mail (ou vont bientôt le recevoir).
Pour rappel : la cotisation couvre la période du 1er janvier au 31 décembre.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse infos@lecercleguimard.fr
Votre adhésion au Cercle Guimard est un soutien indispensable pour mener à bien les actions de recherche et de protection du patrimoine d’Hector Guimard.
Nous vous remercions vivement pour votre soutien et votre fidélité !
Le Bureau du Cercle Guimard
Comment commander ?
Vous pouvez recevoir les objets par colis ou vous déplacer au domicile de Frédéric Descouturelle, secrétaire de l'association.
Recevoir les objets par colis
Prix du transport en sus.
Actuellement, seul le règlement par chèque est possible. Les chèques seront à libeller au nom de : « Le Cercle Guimard ».
Merci d'envoyer un message pour passer commande.
Se déplacer au domicile de notre trésorier, à Montreuil (métro Robespierre).
Vous pouvez prendre rendez-vous par courriel pour venir un vendredi après-midi ou un samedi matin. Dans ce cas, le règlement en espèces est possible.
Vous souhaitez adhérer et bénéficier des tarifs spéciaux ?
Vous pouvez réaliser un règlement unique comprenant l’achat et la cotisation.
